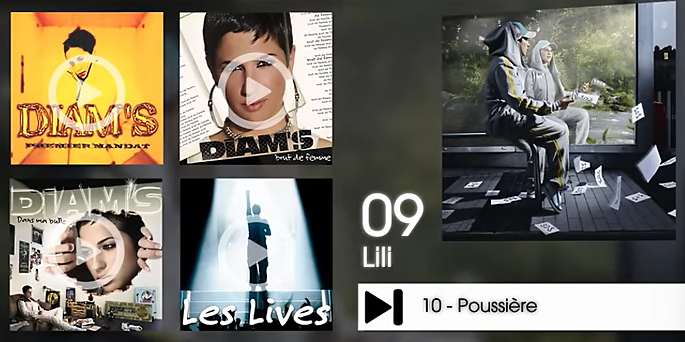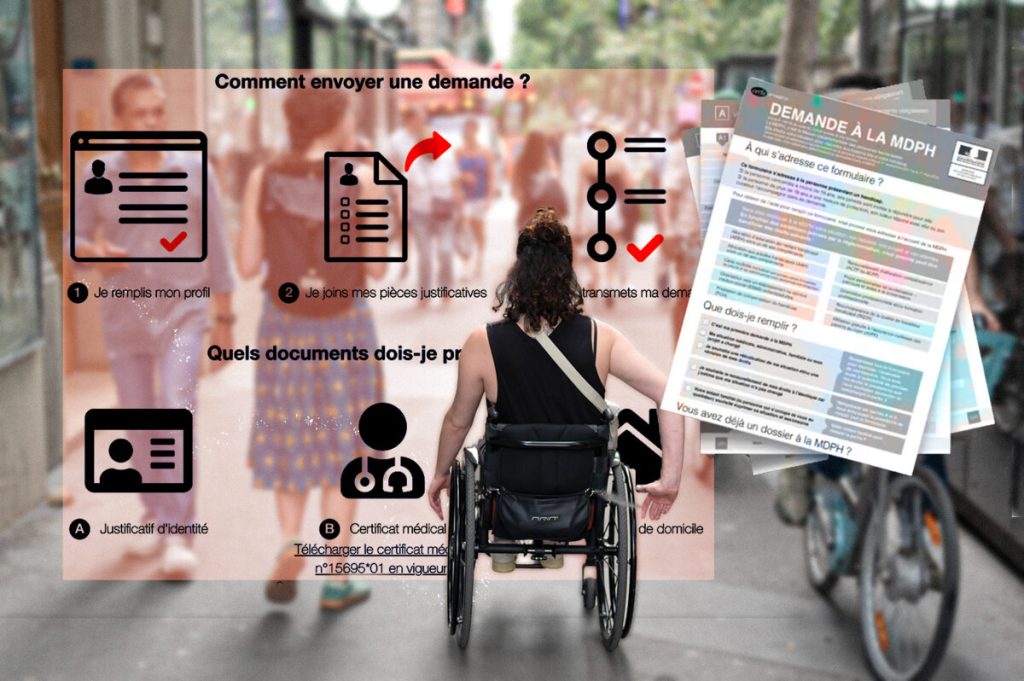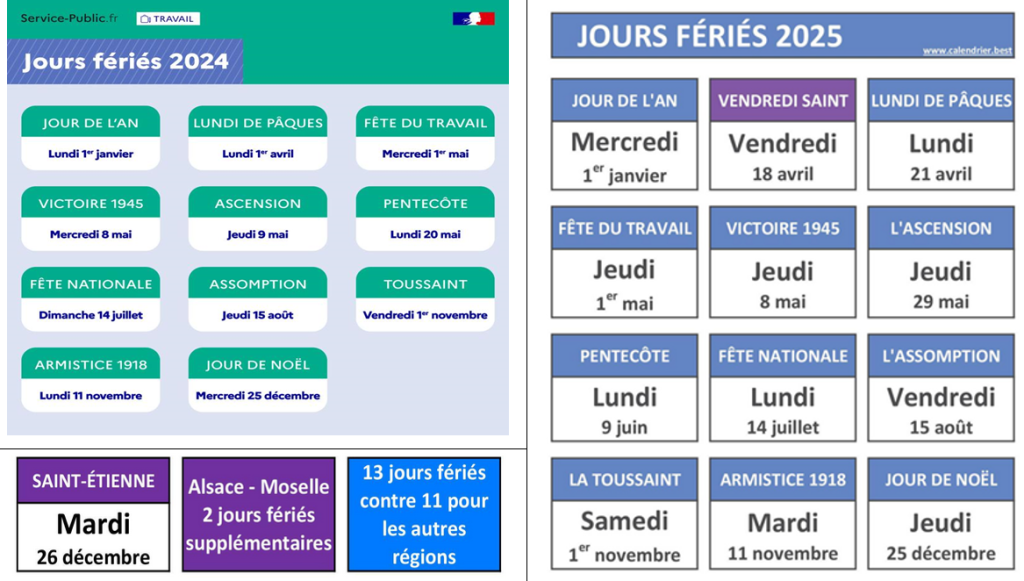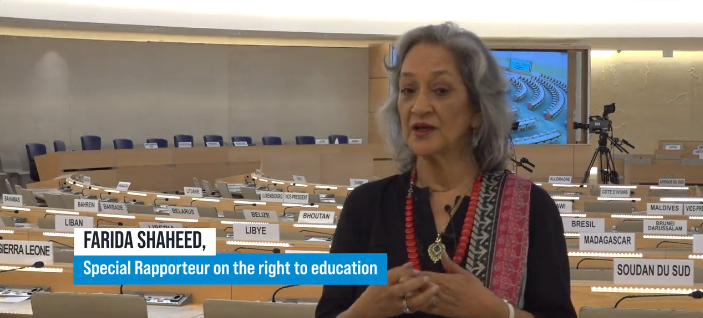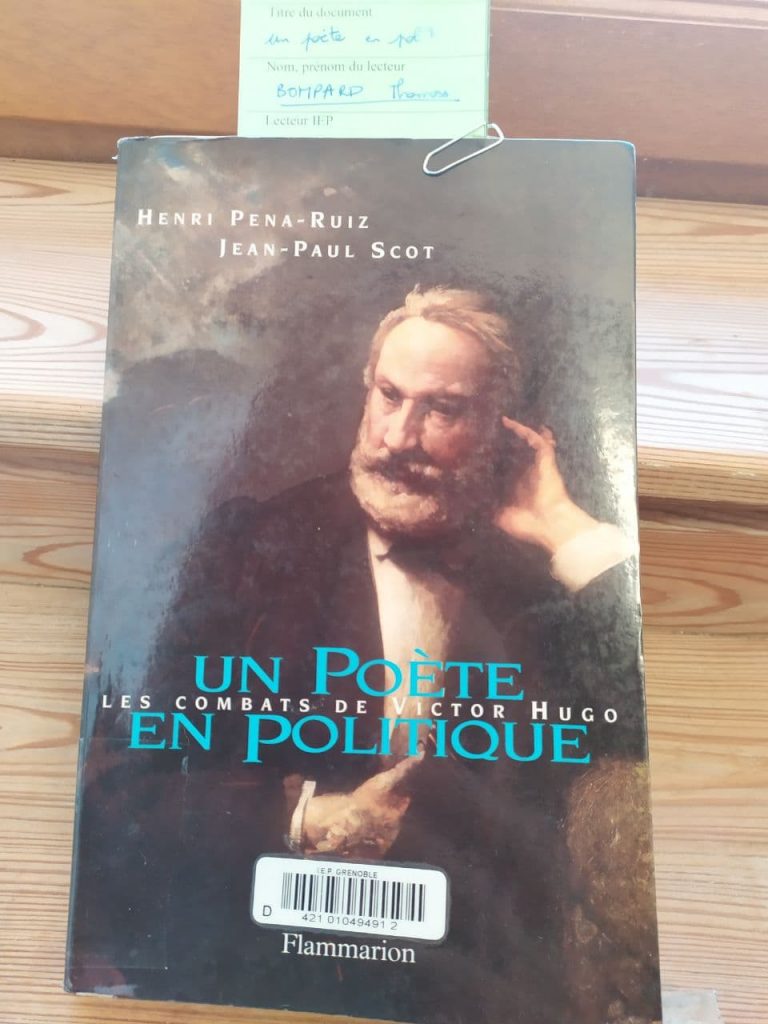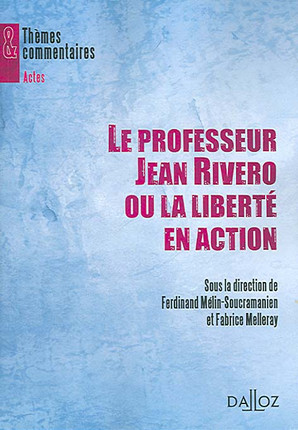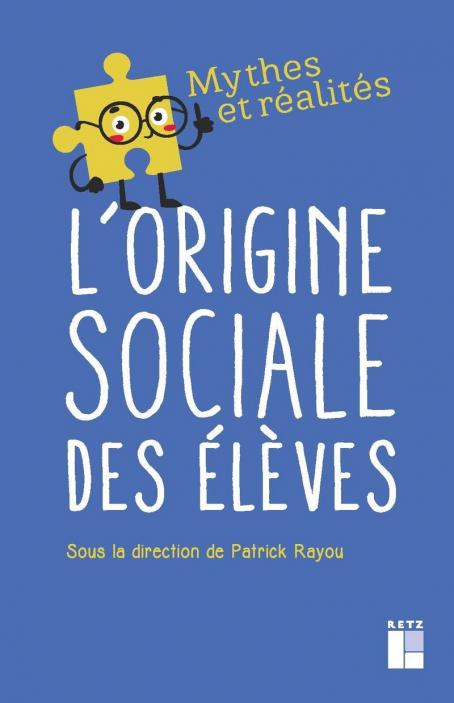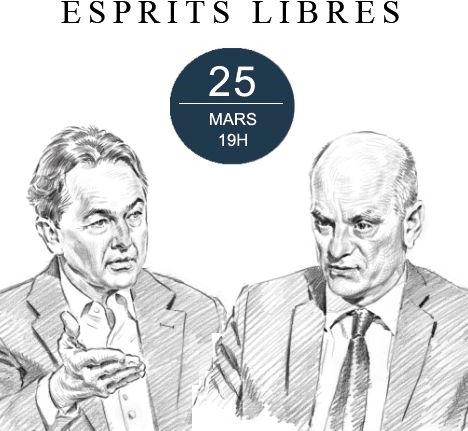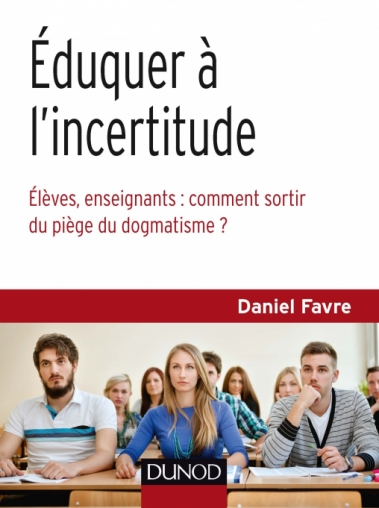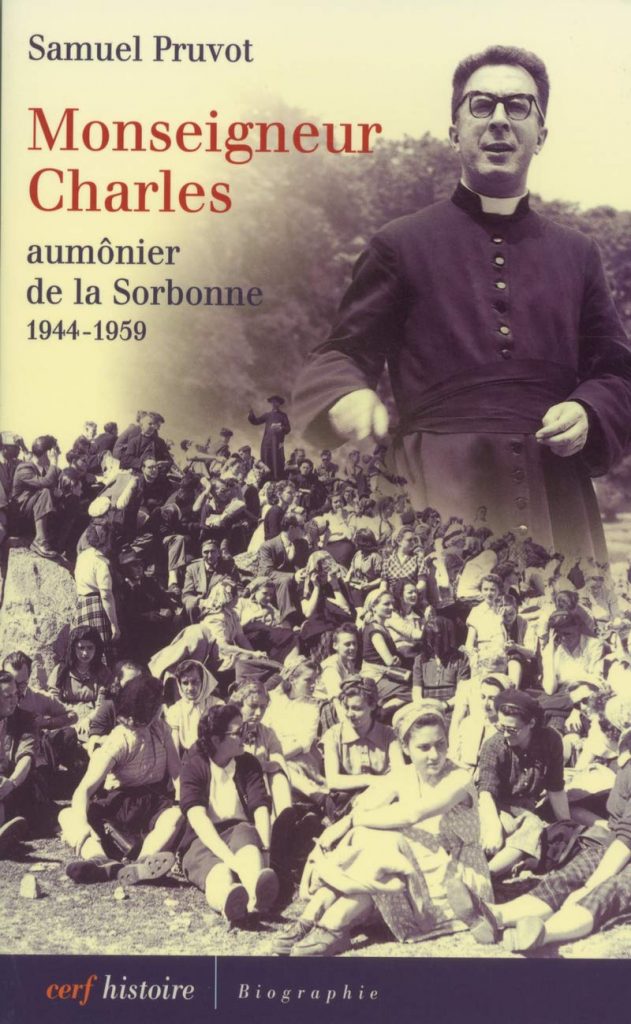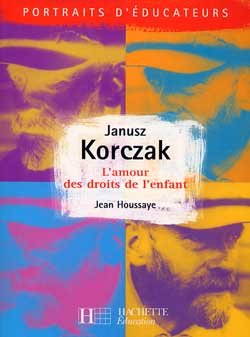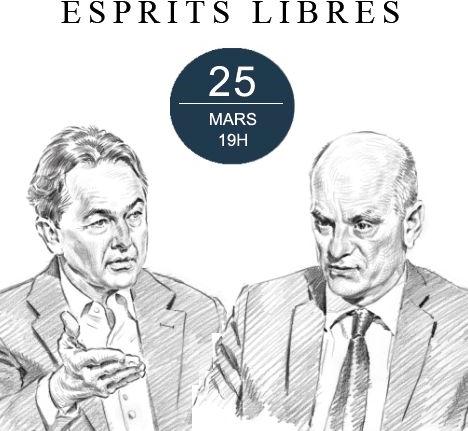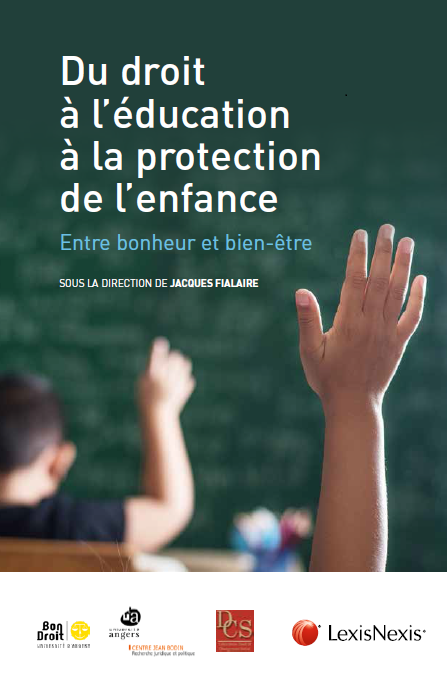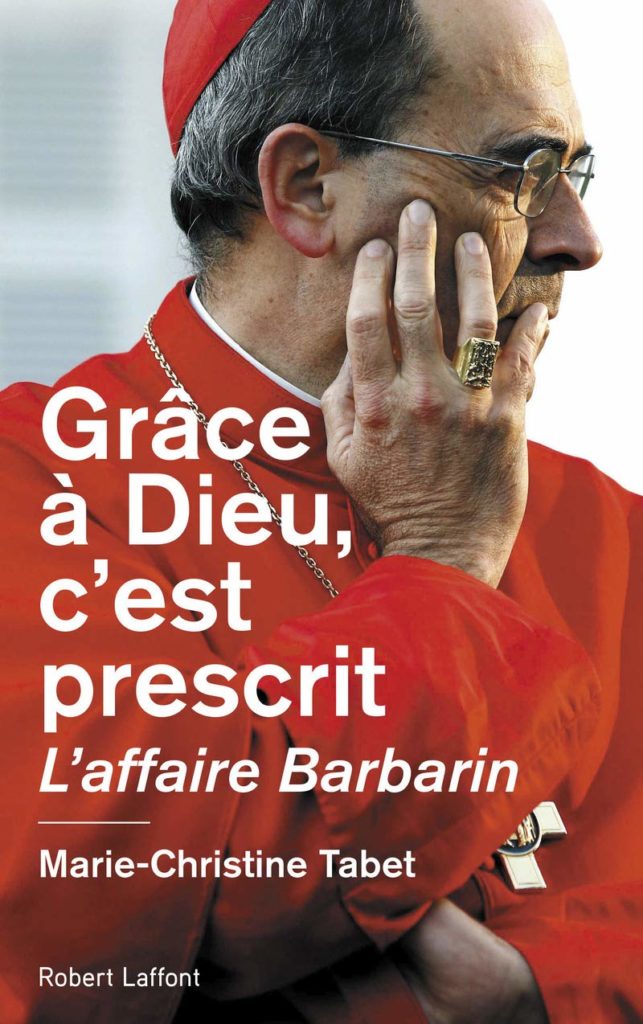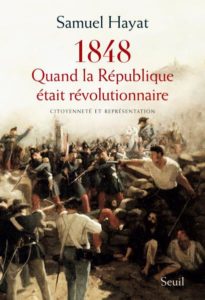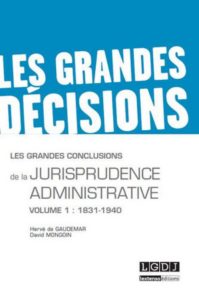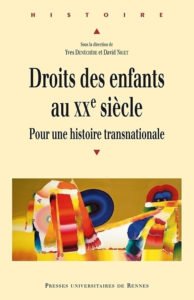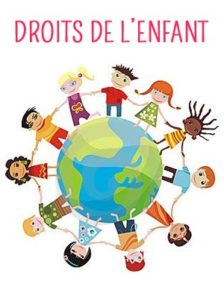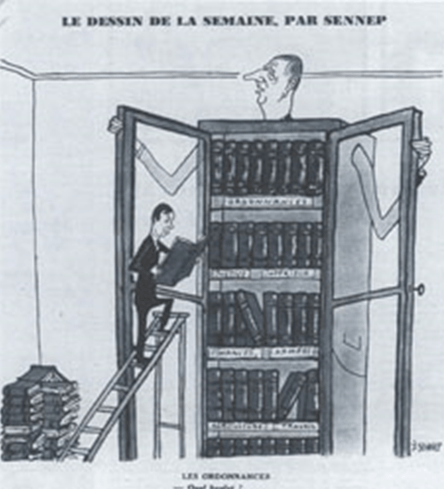
Dans mon billet du 29 septembre 20241Intitulé « Handicap et laïcité : deux postes d’observation du gouvernement Barnier », 29 sept. 2024, en cours d’actualisation sur la question des handicaps2V. mon billet situé à la date des vingt ans de la loi Handicap – en cours d’écriture au 19 mai, qui est également la date de publication d’une première version du présent texte –, 11 févr. 2025, j’écrivais à la note 16 : « l’idée selon laquelle le Secrétariat général de l’Enseignement catholique [SGEC] s’apparenterait à un “ministère bis” de l’Éducation nationale revient à Bernard Toulemonde, l’un des acteurs du dialogue avec cette “administration” »3Et de renvoyer à ma thèse, Le droit à l’éducation. L’émergence d’un discours dans le contexte des laïcités françaises, UGA, 2017, pp. 562-563 ; Stéphanie Hennette Vauchez, L’École et la République. La nouvelle laïcité scolaire, Dalloz, 2023, pp. 46-47 [citée par Jean Baubérot-Vincent, « Enfin une bonne nouvelle : la création d’un ministère de la Laïcité ! », nouvelobs.com 20 sept. 2024], avant de préciser que Bernard Toulemonde s’exprimait dans le cadre d’un dossier dirigé par André Legrand : décédé le 2 juillet 2024, ce dernier a reçu un hommage du ministère, France Universités saluant aussi sa « mémoire » ; en 2017, je le citais vingt-huit fois, notamment pp. 51, 106-107, 163, 627, 1002 – pour s’en tenir à des mises en perspectives juridiques générales (il fait lui aussi partie des « Témoins et acteurs des politiques de l’éducation depuis la Libération », INRP 2008, tome 5, pp. 100-102 ; à propos de cette « grande enquête (…) lancée au début des années 1990 », v. Bénédicte Girault, « Dans les archives orales de l’Éducation nationale, les énarques à la conquête de l’État », theconversation.com 12 sept. 2024)..
Un article de presse publié au début du mois m’a conduit à relire les pages de ma thèse, auxquelles je renvoyais sans m’être souvenu alors que l’auteur cité reprenait une expression de Michel Debré, elle-même reproduite en note de bas de page4Thèse préc., 2017, en note de bas de page 563, n° 3633, avant de citer, à la suivante, Nicole Fontaine, à propos de laquelle v. mon billet en mai 2018 (en signalant en particulier l’ouvrage tiré de sa propre thèse qui, comme je le relevais à la 1671ème note, page 273, renvoie à la déclaration sur l’éducation chrétienne Gravissimum Educationis – publiée au terme du concile Vatican II [1962-1965]) ; pour des nécrologies plus ou moins récentes, v. d’abord celles, décalées, de Pierre-Henri Prélot et Jacques Delors – respectivement en illustration et à la fin de ce billet, à propos du pape François –, puis cet article informant que « Cathy Bernheim, figure emblématique du féminisme, est morte », lesnouvellesnews.fr 10 avr. 2025 : « elle participait, le 26 août 1970, à une action emblématique du mouvement : une tentative de dépôt d’une gerbe, sous l’Arc de Triomphe, pour rendre hommage à la femme du Soldat inconnu » et, l’année suivante, « à l’écriture de l’hymne du MLF » ; Zineb Dryef, « Cathy Bernheim. Écrivaine et féministe », Le Monde le 12, p. 19 : « “Quatre femmes, quatre voix, se distinguaient. On les écoutait plus fort dans les AG [assemblées générales] du mouvement : Christine Delphy, Monique Wittig, Antoinette Fouque et Cathy, raconte la sociologue féministe Liliane Kandel. À cela près ! elle ne voulait pas être un chef”. Frédéric Martel, connu pour son histoire des homosexuels en France (Le Rose et le Noir, 1996) se souvient lui aussi d’une femme qui ne cherchait “pas à se mettre avant. Elle est une des plus grandes figures du féminisme français, mais elle reste méconnue” » ; « elle est une des rares à écrire sur l’homosexualité dans Le torchon brûle » (citant l’un des numéros de ce journal féministe et évoquant l’action de 1970, v. ma thèse, pp. 85 – en note n° 447 – et 884). V. enfin Florence Noiville, « Mario Vargas Llosa. Écrivain péruvien. Prix Nobel de littérature », Le Monde 15 avr. 2025, p. 23 (extrait) ; Ludovic Lamant, « Vargas Llosa, un immense écrivain qui s’est égaré », Mediapart 15 avr. 2025 ; Santiago Amigorena, « Pourquoi diantre ne puis-je pas pardonner à Vargas Llosa ? », Libération 17 avr. 2025, p. 22 (extrait) : « sa mort est là, humaine, terriblement humaine comme toute mort, et je sais que ce soir l’amertume laissera la place à la douceur et que je me coucherai un livre de lui à la main » (Le Paradis – un peu plus loin ouvre mon billet du 20 juin 2018 ; je le cite surtout dans mon portrait de Flora Tristan). : ce dernier rappelait avoir « refusé la création d’une Université concurrente, d’une sorte de ministère bis de l’Éducation nationale » ; il s’exprimait ainsi lors d’une séance de débats parlementaires il y a plus de quarante ans. Comme elle avait déjà pu le faire à propos de ce qui allait devenir la loi Guermeur, en 1977, la gauche venait de rappeler – par la voix du Premier ministre Pierre Mauroy –, un propos de son prédécesseur en 1959.
En tant que député ce 24 mai 1984, Michel Debré tenait à réagir au motif qu’« une citation n’est exacte que si elle est complète et une juste interprétation doit être donnée pour respecter les faits. Il y a vingt-cinq ans [avant le vote5Sous la présidence de Charles de Gaulle qui, revenu en France préparer le concours de l’École militaire de Saint-Cyr au collège Stanislas (v. infra) – après avoir poursuivi sa scolarisation en Belgique –, avait « effectué ses études primaires chez les frères de l’École Saint-Thomas-d’Aquin, rue de Grenelle, entre 1896 et 1900 » ; il fût ensuite scolarisé « au collège de l’Immaculée Conception, rue de Vaugirard à Paris » (Yves-Marie Hilaire, « L’éducation religieuse de Charles de Gaulle », in Charles de Gaulle, la jeunesse et la guerre 1890-1920 [Colloque], Plon, 2001, 5 p., pp. 2 et 3 ; v. déjà Philippe Portier, « Le général de Gaulle et le catholicisme. Pour une autre interprétation de la pensée gaullienne », Revue historique avr.-juin 1997, n° 602, p. 533, disponible sur gallica.bnf.fr, spéc. pp. 561-562) – soit cet « ancien collège de Jésuites, qui comprenait plusieurs ailes » (wikipedia.org au 27 janv. 2025 : l’une « a été détruite pour construire le lycée autogéré de Paris », la chapelle « est désormais utilisée comme amphithéâtre par l’université Panthéon-Assas tandis que les dortoirs sont devenus des salles de travaux dirigés ». Annoncé le 14 mai, le partenariat signé le 24 avril entre cette dernière et le Tribunal administratif de Paris conduira-t-il à de réelles analyses critiques de ses décisions ? À voir…) ; pour d’autres établissements scolaires ainsi nommés, à partir quelques décisions des juges administratifs : CE, 10 janv. 1986, Commune de Tergnier (et Association des écoles primaire et technique de l’Immaculée Conception), n° 57915 (et n° 58011) : « la circonstance que des places disponibles auraient existé dans les écoles publiques de la commune de [Tergnier (Aisne)] n’est pas à elle seule, de nature à établir que l’école de l’Immaculée conception ne répondait pas à un besoin scolaire au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 » (arrêts rendus sur des conclusions de Michel Roux, qui venaient de publier celles prononcées sur CE, 19 juin 1985, Commune de Bouguenais, n° 33120 et 33121 ; RFDA 1985, pp. 553 et s.) ; TA Amiens, 17 avr. 2003, OGEC c. Préfet de l’Oise, n° 00101 ; LIJMEN oct. 2003, n° 78, pp. 23-24 ; CE, 12 mai 2017, Commune de Villeurbanne, n° 391730 ; JCP A 2017, 2147, concl. Vincent Daumas ; CE, 26 juill. 2018, Ministre de l’Éducation nationale, n° 411870, concernant probablement celui de Carpentras ; v. surtout TA Pau Ord., 28 nov. 2024, n° 2402890, rendue par la juge des référés Sylvande Perdu : « L’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 9 septembre 2024, interdisant à [Christian Espeso] l’exercice de fonctions de direction d’un établissement d’enseignement privé, à titre temporaire et pour une durée de trois ans, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond [sur la requête en annulation n° 2402889] » (art. 1er ; « “Atteintes à la laïcité” : un chef d’établissement catholique de Pau rétabli provisoirement dans ses fonctions », liberation.fr avec AFP le 29, renvoyant à l’enquête de Cécile Bourgneuf publiée le 1er février [extrait, signalant un « changement de direction voulu par le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron en 2013 », ayant placé l’établissement « sous le joug de l’évêque ultraconservateur Marc Aillet »] ; datant également d’avant « l’inspection réalisée en avril 2024 », évoquée au cons. 9, la question posée pour titrer un article de Sébastien Lamarque et Marie Berthoumieu le 6 mars le reste au plan contentieux : « à Pau, l’Immac a-t-elle mis des coups de canif dans le contrat avec l’État ? », extrait larepubliquedespyrenees.fr ; ayant pu « consulter de manière informelle » le rapport de juin, David Perrotin et Antton Rouget en ont tiré un article pour Mediapart le 30 mars 2025, suivi d’un « droit de réponse de Christian Espeso » le 17 avril). de la loi appelée à porter son nom6« Le Premier ministre assure l’intérim du ministère et par conséquent défend le projet de loi qui portera son nom » (Bruno Poucet, La liberté sous contrat. Une histoire de l’enseignement privé, Fabert, 2009 [avec une recension d’Yves Verneuil, Histoire de l’éducation 2013, n°139, p. 102], p. 87) ; deux pages auparavant, après avoir cité « Émile Dutreuilh, le représentant de l’enseignement privé au Conseil supérieur de l’Éducation nationale » (le 21 décembre 1959), Bruno Poucet rappelle que « le vice-président de l’association parlementaire pour la liberté d’enseignement, le sénateur Prélot [v. supra], y voit non “une loi d’aide à l’enseignement privé, mais la mise en place d’un secteur semi-public de l’enseignement” ». Page 88, il écrit à propos de Michel Debré : « Au cours du débat (…), il a accepté, comme prévu, le vote d’un amendement parlementaire qui permet d’inverser l’ordre des paragraphes de l’article 1 en donnant ainsi oralement son accord à une interprétation du caractère propre qui ne figure pas dans le texte de la loi, mais uniquement dans la discussion parlementaire : celui-ci porterait aussi sur l’enseignement. Mais ce n’est pas dans la loi. Ce compromis ultime est à la source de bien des débats à venir ! » (v. encore p. 125 : « L’association parlementaire pour la liberté d’enseignement se restructure [après mai 1968] (…). Désormais, son secrétariat administratif est assuré par… le secrétariat général de l’enseignement catholique : le député Guy Guermeur en devient l’actif secrétaire général en 1974 et donnera ainsi son nom à la loi de 1977, modifiant la loi Debré de façon ambiguë »).], le gouvernement et la majorité de l’époque se sont trouvés devant deux mouvements. Le premier (…) tendait à la disparition de l’enseignement privé par intégration dans l’enseignement public (…). Le second consistait à créer une Université catholique, une sorte de ministère bis de l’Éducation nationale (…). J’ai répondu par un refus aux deux mouvements et la citation que vous avez faite doit être replacée dans ce contexte »72ème séance du 24 mai 1984 ; JOAN du 25 (archives.assemblee-nationale.fr), pp. 2638-2639 : suit l’extrait reproduit au paragraphe précédent, puis d’autres développements et la réaction de Pierre Mauroy : « Vous venez, dans une longue intervention, d’évoquer la paix scolaire. Mais c’est un abus de mots que de dire que vous [l’avez établie] (…). Vous avez eu pendant vingt-trois ans la majorité et vous nous avez imposé des lois que les laïques de ce pays n’ont jamais acceptées. (…) ». Rappelant récemment l’implication du Premier ministre, début 1983, dans un évènement construit en référence avec la situation iranienne, Franck Frégosi, « L’islam, une religion d’État en France ? », radiofrance.fr/franceculture 13 févr. podcast La Suite dans les idées, à 13 min. 30 (v. ma thèse préc., 2017, pp. 1005-1006 et, pour 1989, la note 55 de mon billet du 31 mars)..

Le 23 décembre 19598Quelques années plus tôt, « certains politiques de la IVe République, sous l’influence du secrétaire général du Parti Socialiste et député Guy Mollet et du garde des Sceaux Robert Lecourt, entendirent conclure (…) un accord de coopération avec le Pape Pie XII. Les négociations furent entamées en 1952 et se poursuivirent jusqu’en 1957 dans un secret absolu, sans toutefois aboutir à un accord » (Mélanie Lopez, « Les politiques concordataires au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : de Franco à Guy Mollet », RDP 2010, p. 1635, proposant « une analyse comparative de ce projet de convention avec le concordat espagnol dénoncé quelques années auparavant par la France » ; article cité dans ma thèse préc., 2017, en notes de bas de pages 349, 574, 578, 742 et 816)., le Premier ministre déclarait précisément : « Serait cause de trouble et de querelle l’unification par la nationalisation. Serait cause de trouble et de lutte l’édification d’une université qui s’établirait dans son unité face à l’Université nationale »91ère séance du 23 déc. 1959 ; JOAN du 24, p. 3597 (archives.assemblee-nationale.fr). ; c’est sans doute parce que conscient du caractère désuet de ce mot d’Université pour qualifier le ministère10Après que le régime de Vichy l’a remise en cause, l’appellation retenue en 1932 – « de l’Éducation nationale » – avait été rétablie en 1941 (v. ma thèse, p. 104) ; le 23 juillet 2019, suite au rejet de mon appel au groupe 1 pour une qualification extraordinaire aux fonctions de maître de conférences, j’avais écrit un mail qui consigne l’un de mes souvenirs de mon audition du 2 ; historienne du droit (Statut des professeurs et auxiliaires de facultés de 1800 à 1848, thèse Paris II, 1989), Anne-Marie Voutyras-Pierre m’avait demandé de commenter un mot (« corporation ») employé à propos de l’Université impériale, page 68, ce qui m’avait conduit à indiquer aux membres du groupe le contexte de cette citation, en précisant qu’il s’agissait surtout pour moi de situer la gestion publique des activités d’enseignement plus tard (alors que l’expression en italiques, employée par la loi de 1806, peut porter à confusion ; page suivante, je cite le décret de 1808 qui prévoit qu’elle « sera régie et gouvernée par le grand-maître »). Direction du ministère de l’Intérieur depuis 1802, « l’Instruction publique » avait été associée à celui des « Affaires ecclésiastiques » lors de sa création en 1824, avant qu’une autre ordonnance ne l’en émancipe quatre ans plus tard (pp. 70-71)., qu’il ajoutait l’expression reprise dans les années qui suivront11C’est aussi à cette période que Pierre-Henri Prélot a réalisé sa thèse, soutenue et publiée en 1989 ; avec Jean Baubérot, il figure sans doute parmi les auteurs les plus cités dans la mienne, en 2017 (érudits et intègres, je regrette encore qu’ils n’aient pu faire partie du jury ; construite en remerciant les membres de celui finalement réuni, mon introduction de soutenance aurait été différente). En élargissant sa recherche doctorale consacrée aux établissements privés d’enseignement supérieur, il a en effet rédigé la huitième partie du massif Traité de droit français des religions, intitulée « Enseignement et religion ». Je l’avais rencontré la seule fois de ma vie où je suis allé à l’Université de Cergy (désormais CY), pour un séminaire sur les droits dits « sociaux » (organisé par Carlos Miguel Herrera, qui a coordonné les Mélanges à la mémoire de Pierre-Henri Prélot, titrés La vocation du juriste universitaire, IFJD, lgdj.fr 2024) : je l’avais tout de suite apprécié ; nous avions échangé quelques mails en octobre 2014, il avait même eu la gentillesse et la générosité de m’envoyer un ouvrage qu’il a co-dirigé (avec Sébastien Pinon, Le droit constitutionnel d’Adhémar Esmein, Montchrestien, 2009 – lequel n’était pas alors disponible dans les bibliothèques grenobloises). Le 19 novembre 2019, à l’issue de la journée conclusive d’une recherche sur « les situations d’instruction en famille ou dans des écoles privées alternatives hors contrat » (PHEDESCO, à laquelle m’avait invité Françoise Carraud, lle.ens-lyon.fr), Anne Fornerod m’avait encouragé à lui écrire et j’avais une fois encore trop traîné (v. le billet que j’avais prévu de leur adresser et, remontant également à 2018, celui complété en 2021 – avec cette note 21, par cet article de reforme.net le citant, les 16-17 déc. 2020). Touché en apprenant sa disparition, j’avais écrit sur ce site espérer « trouver l’énergie de relater quelques souvenirs de l’homme, bientôt » ; c’est enfin chose faite, en reprenant à mon compte la première page de sa thèse, pointant « les interprétations les plus diverses, parfois les plus hasardeuses, sur la portée (…) de la liberté de l’enseignement » (à propos des décisions du Conseil constitutionnel, mais le propos peut être étendu à celles de la Cour européenne, ainsi que je le remarquais dans ce billet en 2019-2020, spéc. la note n° 19 ; pour un écho « au terme, il est vrai, d’une motivation peu explicite », v. Tanneguy Larzul, « L’enseignement libre : liberté de l’enseignement – liberté d’enseigner », Titre VII. L’enseignement, Les cahiers du Conseil constitutionnel avr. 2024, n° 12, en note n° 53). Rappelant en achevant sa préface qu’il était le « petit-fils » de Marcel Prélot, Yves Gaudemet la commençait par des mots de ce dernier « citant André Philip » (LGDJ, 1989, pp. XVI et XIII, en renvoyant à ce portrait). Si elles sont bien moins nombreuses que les références à « P.-H. Prélot », l’entrée « Marcel Prélot » comprend une petite dizaine de mentions dans ma thèse ; il fût recteur l’Académie de Strasbourg à la Libération, puis secrétaire général de l’Association parlementaire pour la liberté de l’enseignement (v. infra ; je signale en particulier ma note de bas de page 574, n° 3699, pour un échange entre députés que j’avais trouvé assez drôle ; sans aborder l’enseignement, dans un numéro consacré aux « Juristes Catholiques : 1880-1940 », v. Yves Palau, « Les convictions juridiques, un enjeu pour les transformations doctrinales du catholicisme social entre les deux guerres », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques 2008/2, n° 28, p. 369). par Bernard Toulemonde. Ce dernier compte parmi les acteurs du projet de loi Savary12Marie-Thérèse Frank et Pierre Mignaval, « La loi Savary. Le regard des acteurs », in Serge Hurtig (dir.), Alain Savary : politique et honneur, Presses de Sciences Po, 2002 (sommaire), en note de bas de page 243, rappelant que Bernard Toulemonde a été « chargé de mission auprès du Premier ministre Pierre Mauroy en 1981, directeur des affaires générales au ministère de l’Éducation nationale de 1982 à 1987 ». Alain Savary avait pour directeur de cabinet Jean-Paul Costa (v. en 2017 ma note de bas de page 593, n° 3827, citant Claire de Galembert), qui gardera longtemps de l’année 1984 « amertume et tristesse » (Alain Salles, « Jean-Paul Costa, l’ultime recours », lemonde.fr 9 mars 2009, avant de le citer, puis de le présenter comme ayant été « coincé entre les ultras catholiques et laïcs [sic] ». Au moment d’achever ce billet, le « juge français Mattias Guyomar est élu président de la CEDH, succédant à Marko Bosnjak », lemonde.fr (avec AFP) 28 avr. 2025 : il en était juge « depuis juin 2020, et en présidait une des cinq sections depuis mai 2024 » ; les français « Jean-Paul Costa (2007-2011) et René Cassin (1965-1968) ont assumé cette fonction avant lui » [v. mon portrait]). ; c’est précisément à ce texte13Ne pas confondre ce projet de loi Savary avec celle du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur (wikipedia.org, la première page étant, selon son actualisation au 8 mars 2025, rédigée à partir d’un livre de Bernard Toulemonde (Petite histoire d’un grand ministère, 1988 ; comparer ma thèse préc., 2017, pp. 212 à 217). que se réfère la fin de l’article sus-évoqué14Sylvie Lecherbonnier, « Devant les députés, le changement de ton de Philippe Delorme » (extrait) et, avec Éléa Pommiers, « Le Secrétariat général de l’enseignement catholique, influent défenseur du privé [sous contrat auprès du ministère de l’Éducation nationale] », Le Monde 4 avr. 2025, pp. 10-11 (extrait, cette double page comprenant encore l’article de Sarah Belouezzane et Benoît Vitkine, rendant compte de l’élection, mercredi 2, de l’archevêque de Marseille – le cardinal Jean-Marc Aveline – comme président de la Conférence des évêques de France [CEF, extrait])..
Avant d’insérer ici quelques paragraphes15Texte en cours d’écriture ; v. déjà Bruno Poucet, « Chapitre 15. L’enseignement catholique : des structures historiquement marquées », in Jean-François Condette et Marguerite Figeac-Monthus (dir.), Sur les traces du passé de l’éducation… Patrimoines et territoires de la recherche en éducation dans l’espace français, MSH d’Aquitaine, 2014, p. 209, à partir des « archives privées disponibles », notamment celles « du Secrétariat général de l’enseignement catholique pour la période récente », sans que l’on sache à la lecture de cet article quand ce dernier terme (§§ 1 et 39) – utilisé pour déclarer l’association en 2008 – a remplacé le mot « libre » (§ 26 ; ma note de bas de page 189, n° 1102, citant une publication de 1956 à partir de son livre précité, 2009, p. 61) ; v. spéc. son paragraphe 23 : « On sait que des subventions ont été attribuées, par le Gouvernement de Vichy, à partir de 1942, à titre provisoire, pour les écoles primaires. Mais on sait moins que la conséquence en a été double : renforcer la structuration nationale, renforcer le rôle des évêques en matière d’enseignement ». – pour en commenter plusieurs extraits –, je note que, le 23 avril dernier, Paul Vannier a repris l’expression (v. ci-dessous).

Compte tenu des développements qui précèdent, et pour ne pas faire dire à Michel Debré16Dans un entretien récent avec Denis Cosnard, Pierre Mazeaud présente Michel Debré (1912-1996) comme son « père en politique », en rappelant qu’il l’avait appelé comme « chargé de mission à Matignon », mais aussi à dispenser des cours particuliers à ses fils, François et Jean-Louis, lequel allait lui succéder après sa présidence du Conseil constitutionnel – du 9 mars 2004 au 3 mars 2007 (« Je n’aurai pas la chance, moi, de mourir en montagne », Le Monde 27-28 avr. 2025, p. 20, extrait). le contraire de ce qu’il pensait, j’ai opté pour laisser un point d’interrogation dans le titre de ce billet ; du point de vue de la recherche, il y a là a minima une hypothèse de travail, qui nécessiterait de systématiser l’exploration. Elle mériterait en tout cas d’échanger « des arguments et des objections », pour reprendre un élément de définition du « débat d’idées » selon Antoine Vuille17Antoine Vuille (entretien avec, par Cyril Petit), « Le clash, c’est la dérive du débat d’idées », ouest-france.fr 2 nov. 2024, à l’approche de la sortie de son essai Contre la culture du clash. Débat d’idées et démocratie (Éliott éd.) ; v. aussi la recension de Christian Ruby, nonfiction.fr 18 avr. 2025 : « Cette conception du débat rationnel s’inspire d’un modèle positif : les colloques et rencontres scientifiques. Vuille affirme en effet qu’à ces occasions, chaque interlocuteur “considère l’affirmation de l’autre avec attention”, “s’assure de l’avoir bien comprise avant de la critiquer”, etc. On pourrait toutefois nuancer cette description et relativiser le caractère exemplaire de ces formes de discussion – et pourquoi pas renoncer tout bonnement à chercher un modèle paradigmatique pour le débat d’idées ». Lors de ma soutenance de thèse, avant d’en critiquer le caractère « démesuré », le président du jury commençait son propos en soulignant mon « goût des idées » (rapport de soutenance, page 16, en regrettant à la suivante « l’absence d’éclairage philosophique du sujet », notamment de « discussions des positions de Hayek ou Friedman » ou des propositions de « chèques-éducation ») ; dans l’espoir de prolonger l’échange qui avait suivi, après avoir ajouté quelques éléments fin 2017, j’avais noté quelques mois plus tard que la loi Debré se trouvait cité dès la première édition de Capitalism and Freedom (v. mon billet du 30 août 2018, actualisé depuis, en renvoyant à une émission de France culture sur le néolibéralisme en cette fin de mois d’avril)..
[9 juin 2025 : illustrations et développements à venir]
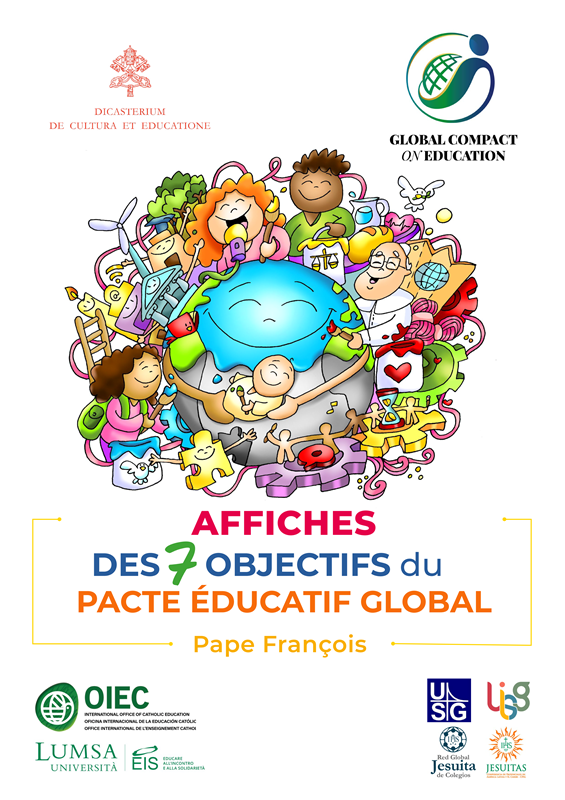
Sur le site du SGEC, l’un des chantiers concerne l’« invitation du Pape François à un “pacte éducatif” »18« Chantier 3. Du “pacte éducatif global” au pacte éducatif local », enseignement-catholique.fr 13 janv.-12 févr. 2021 ; reliant ce PEG au « nouveau contrat social » proposé par l’UNESCO, educatemagis.org juill. 2024, 15 p., rappelant page 4 la participation d’Audrey Azoulay à cette « vidéoconférence », mais aussi que « la rencontre du Pape avec les leaders des religions du monde, le 5 octobre 2021, s’est déroulée en présence de la Sous-directrice générale de l’UNESCO pour l’éducation » (Stefania Giannini, depuis mai 2018, comme je l’indiquais le 31 janvier 2021)., « lancé en septembre 2019 »19Pape François, Discours à la délégation des promoteurs du Pacte éducatif africain », vatican.va 1er juin 2023 ; v. surtout son discours du 15 octobre 2020, (s’)engageant notamment « à voir dans la famille le premier et l’indispensable sujet éducateur » (« Pacte éducatif global : l’appel du pape François aux éducateurs et responsables du monde entier », catechese.catholique.fr ; à propos de l’affirmation du pape que je cite, dans la continuité de Pie XI sur ce point, v. mes pp. 737-738, spéc. la note n° 678 : elle trouve place au début du chapitre 2 de ma seconde partie, transformé en une version « cour(s)te » de 40 p. en 2019, à destination d’un public principalement africain ; s’agissant de ce Master, v. encore Institut Icalde 3 févr. 2024). ; bientôt sur le départ20Il sera remplacé par « Guillaume Prévost, nouveau secrétaire général de l’Enseignement catholique », enseignement-catholique.fr 4-7 avr. 2025 : élu par l’« Assemblée plénière des évêques de France, réunie du 1er au 4 », il « prendra ses fonctions le 1er septembre » ; le lien renvoie à une brève « notice biographique », qui rappelle que cet ancien de la Marine Nationale (2006-2014) est énarque : issu « de la promotion 2016-2017 “Louise Weiss” », il rejoindra le ministère de l’Éducation nationale (arrêté du 22 déc. 2017) et la direction générale de l’enseignement scolaire de Paris, avant d’être nommé délégué général d’un think tank se donnant pour objet de tirer les jeunes « VersLeHaut » (extrait aefinfo.fr 3 sept. 2021)., Philippe Delorme le rappelle dans son hommage21Philippe Delorme, « Le pape des périphéries s’en est allé », enseignement-catholique.fr 21 avr. 2025, rappelant l’invitation « à adhérer au “pacte éducatif mondial” ». À partir du début de l’article d’Anne Jourdain, « Le privé, ou l’école de la sécession. Sous contrat mais sans contrôle » Le Monde diplomatique avr. 2025, pp. 1 et 18-19 (extrait), je place provisoirement ici les éléments suivants : Clément Lanier, Mathilde Montourcy and Eva Sherratt, « Le long chemin de croix de l’Église française. Retours sur le rapport rendu par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église le 5 octobre 2021 », La Revue des Droits de l’Homme ADL 17 janv. 2022, § 33, en conclusion, rappelant que ce texte « ne fait pas l’unanimité. Huit membres de l’Académie catholique de France ont adressé au pape François une analyse du rapport94, révélée au public par le journal La Croix le 25 novembre [2021]95 » (v. toutefois la note 52, citant sa « Lettre au peuple de Dieu », vatican.va 20 août 2018) ; Philippe Portier (entretien avec, par Bernadette Sauvaget), « Les violences physiques et morales constituent souvent le terreau de violences sexuelles », Libération 30 avr. 2025, p. 13 (extrait) : ayant dirigé l’étude socio-historique de la Ciase, l’historien et sociologue souligne qu’elles sont « un fait massif dans l’enseignement catholique pendant la période [étudiée (1950-2020)]. Il y a une nette décélération à partir des années 1980 » (mais pas dans l’établissement qui fait la Une de l’actualité, où « la structure traditionnelle perdure jusqu’aux années 2000 ») ; avant de noter qu’il « est courant historiquement » qu’il faille attendre « un effet dans l’opinion publique », il convient que le « travail de la Ciase aurait pu, il est vrai, donner lieu à des prises de conscience » ; comparer Mathilde Goanec, « Avant Bétharram, l’enseignement catholique s’activait en coulisses pour limiter les contrôles », Mediapart 2 avr. 2025 (v. supra l’une des illustrations du présent billet) : « Sur le caractère inopiné des contrôles, Philippe Delorme avait aussi il y a six mois plusieurs réserves, arguant qu’ils devaient reposer sur une “programmation paisible et cohérente fondée sur une concertation avec la direction diocésaine et les chefs d’établissement” » ; s’il « s’autorisait en novembre 2024 à commenter abondamment la version préparatoire du guide des contrôles qui doivent s’exercer sur son réseau, c’est bien parce que le ministère a ouvert la porte à un tel niveau de dialogue, alors même que légalement l’État ne contracte qu’avec les établissements scolaires privés, et aucunement avec le secrétariat général de l’enseignement catholique. “Il n’y a pas besoin d’une loi pour dialoguer, ce n’est pas institutionnalisé, ce n’est pas une négociation, mais une pratique”, a justifié Guillaume Odinet, chef de direction des affaires juridiques au ministère de l’éducation nationale, auprès de la commission d’enquête lundi 31 mars ».. Alors que j’évoquais pour ma part Jorge Mario Bergoglio deux fois dans ma thèse, en 201722L’entrée « pape » renvoie à une quinzaine de références pertinentes, dont deux relatives à François, en notes de bas de pages 546 et 814, n° 3523 et 1145 – au détour d’une mise en évidence de la façon de lire, en particulier en France, l’article 2 du premier protocole à la Conv.EDH (je ne résiste pas à trouver aujourd’hui assez savoureux l’un des textes cités, challenges.fr 3 oct. 2016 : Bruno Roger-Petit opposait, sur les questions de « genre et laïcité », Manuel Valls à Emmanuel Macron, en invitant à « (re)lire le discours que prononça François Mitterrand [aux cérémonies du tricentenaire de la Révocation de l’Édit de Nantes, elysee.fr 11 oct. 1985] » ; vingt ans plus tard, le premier est ministre du second, qui a progressivement épousé ou cautionné la plupart de ses positions)., je ne l’ai cité depuis ici – et sauf erreur – qu’une seule fois : c’était en 2018, suite à des propos d’inspiration homophobe23En citant Sylvie Chaperon, « Le Vatican semble renouer avec une sombre histoire », Le Monde 11 sept. 2018, p. 22 (extrait, réagissant à ces « propos tenus le 26 août et qui ont ensuite disparu de la retranscription officielle sur le site du Vatican ») ; v. depuis Josselin Tricou, « Le pape agit sur l’homophobie comme il agit sur le sexisme : il use (et abuse ?) de la stratégie des petits pas », Le Monde 30 déc. 2023, p. 23 (unil.ch), suite à « la déclaration Fiducia supplicans publiée le 18 décembre par le dicastère pour la doctrine de la foi » (page 5, dans un article intitulé « La gauche ambivalente sur l’héritage de [Jacques Delors] », Nathalie Segaunes cite à propos de ce dernier le politologue Rémi Lefebvre : « Il était déjà, avant même l’alliance entre Bayrou et Macron, pour une recomposition de la vie politique au centre, et l’un des premiers à vouloir se délester de la fraction trop radicale de la gauche » ; plusieurs pages étaient consacrées à sa disparition dans l’édition de la veille, pp. 13 et s., avec en particulier une tribune de l’historien Denis Pelletier, « Un homme de foi engagé en politique », p. 17 : « en 1995, il affirmait que son double compagnonnage, avec la démocratie chrétienne et avec la social-démocratie, avait été l’une des clefs de son succès à la tête de la Commission européenne, parce que ces deux courants étaient historiquement au centre de la construction de l’Europe ») ; à propos du texte « “Dignitas infinita” (“une infinie dignité”, en latin) », Sarah Belouezzane, « Le Vatican s’émeut de la GPA et de la transidentité », Le Monde 10 avr. 2024, p. 5 : « la vraie nouveauté réside dans les chapitres consacrés à la “théorie du genre” et au “changement de sexe” » ; il convient de rappeler qu’ainsi systématisée, celle-ci résulte d’une importation en France (v. mes notes de bas de pages 1075 et 1076-1077, n° 2274 et 2731, ainsi que le glossaire de la revueladeferlante.fr) ; v. encore lemonde.fr (avec AP et AFP) le 8 (présentant cette « nouvelle déclaration sur la “dignité humaine” » comme le « fruit de cinq ans de travail », ce texte du 2 – « 19e anniversaire de la mort de saint Jean-Paul II » – renvoie en note 104 à « la XIVème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, Relatio finalis (24 octobre 2015) », § 58 ; dix paragraphes plus loin, un extrait ramène au titre de ce billet : « Les écoles catholiques remplissent une fonction vitale pour aider les parents dans leur devoir d’éducation de leurs enfants »)., évoqués dans mon billet sur « (le droit à) “l’éducation à la sexualité” »24V. le premier de mes ajouts, le 30 septembre, à ce texte du 24 avril 2018 ; j’espérais le transformer en une véritable communication (« Éducation et sexualités : approche par les droits d’une question laïque », gsrl-cnrs.fr 10 sept. 2021), mais j’avais dû renoncer, pour des raisons de santé (à propos des actes de ce colloque – dirigé par Anne-Cécile Bégot et Philippe Portier, Éduquer à la sexualité. Religions, laïcités, sexualités, sept. 2024, v. Claire Berest, cafepedagogique.net 10 janv. 2025 ; en lien avec le billet préc., et la note 1 de celui qui précède – le 31 mars –, v. Maxime Macé et Pierre Plottu, « Au lycée de la Légion d’honneur, on tolère les saluts nazis », liberation.fr 20 nov. 2024). Concernant le « nouveau programme d’éducation à la vie affective, relationnelle, et à la sexualité (…), adopté par le Conseil supérieur de l’éducation début 2025 », v. « Évars », revueladeferlante.fr/glossaire/evars.
Rappelant que « [t]reize pays seulement n’ont toujours pas noué de relations diplomatiques avec le Saint-Siège – dont les deux géants que sont la Chine et l’Arabie Saoudite25Concernant ces pays, v. « Le pape évoque pour la première fois la persécution des Ouïghours », Le Figaro avec AFP 24 nov. 2020, à propos de son « livre dévoilé [le 23], intitulé en français Un temps pour changer (Flammarion) » ; écouter Sara, l’une des chansons « qui composent la série de sons Enfant du destin », du rappeur Médine, mouv.fr le 6 ; en janvier-février avait été publié le Rapport pour l’année 2019 du CCIF (99 p.), lequel comprenait cet article de Kareem Salem, « Regards sur l’étranger : pourquoi les puissances du Golfe demeurent silencieuses face à la répression de Pékin contre les Ouïghours ? ». », Jean-Louis de la Vaissière souligne que la « montée en puissance des protestants évangéliques très conservateurs est l’un des grands défis du catholicisme dans le monde entier, mais plus particulièrement en Amérique latine et notamment au Brésil26V. mon billet consacré au Brésil, 5 nov. 2018 (avec une nuance ajoutée in fine, le 17 ; v. depuis Louis Fraysse, « Évangéliques ou évangélistes : quelles différences ? », reforme.net 21-28 avr. 2020). – qui compte désormais 31 % de protestants » ; l’ayant « suivi pour l’AFP à Rome », le journaliste note que, de « la Centrafrique à l’Ouganda et à la République démocratique du Congo27« La RD Congo, plus grand pays catholique d’Afrique, émue par la mort du pape François », france24.com (avec AFP) 21 avr. 2025 : « À Goma, grande ville de l’est de la République démocratique du Congo tombée aux mains du M23 fin janvier [avec le « Rwanda à la manœuvre », comme l’expliquais sur France Inter Pierre Haski le 28] et meurtrie par les combats, les mots du pape en faveur de la paix dans la région sont restés dans les mémoires » (deux ans plus tôt, dans la capitale – à l’ouest –, il « avait célébré une messe en plein air qui, selon les autorités, a rassemblé plus d’un million de fidèles ») ; il aura donc été de ceux ayant tenté d’alerter, tout comme les joueurs de l’équipe nationale lors de la CAN (v. la première illustration de mon billet du 9 avril 2024) et, depuis, plusieurs rappeurs (parmi lesquels Amira Kiziamina qui, ainsi que le rappelle Mehdi Salhi, solidaire.org 12 juill., est « né le 14 février 1995 à Kinshasa », avant d’arriver « en France à un très jeune âge avec sa famille, fuyant les violences et les troubles politiques à la suite de la première guerre du Congo de 1996 » ; resituant cette dernière parmi les conflits qui ravagent la RDC, amnesty.org 29 oct.) : Gradur, Ninho, Josman (qui termine son couplet par des rimes « bien techniques » [genius.com]), Youssoupha, Kalash Criminel et Damso, clip du 21 févr. 2025 (avec dans la descriptions quatre liens documentaires ; pour un extrait du premier et plus long – 12 min. d’Hugo Baiardi –, Brut le 15) ; radiofrance.fr/mouv le 24 ; france24.com le 7 mars ; tissant en lien entre la résistance des adolescentes congolaises et afghanes – à propos desquelles v. la note 56 de mon précédent billet –, v. celui de Carol Mann, blogs.mediapart.fr le 21 ; v. enfin Mathias Jobert, « Devant le Parc des Princes, la colère monte contre Visit Rwanda », sofoot.com 7 avr. et, au lendemain du concert « Solidarité Congo », rfi.fr le 23 (« show à guichets fermé dont les recettes seront reversées à l’association Give Back Charity du chanteur Dadju » : selon une vidéo du 29 oct. 2019, elle s’était « engagée auprès de la Fondation Panzi fondée par le docteur Denis Mukwege pour venir en aide aux femmes victimes de violences sexuelles en RDC » ; à propos de ce dernier, v. cette année-là le 3 mars, en note 3)., sa façon de pointer les problèmes concrets, d’écouter longuement les témoignages des victimes des viols de masse et des guerres internes, a conquis les esprits »28Jean-Louis de la Vaissière, « Géopolitique du pape François : de l’Ukraine aux périphéries, 10 points sur son bilan international », legrandcontinent.eu le 21 avr., avant de souligner que la « déclaration Fiducia Supplicans en 2024 proposant une bénédiction non sacramentelle à des couples non mariés, y compris homosexuels, fut totalement incomprise, au point que le cardinal de Kinshasa, Fridolin Ambongo, qui préside la conférence des évêques du continent, lui opposera une fin de non-recevoir » ; et d’évoquer « le combat du très conservateur cardinal guinéen Robert Sarah, très populaire en France en raison de ses positions dures sur ces questions — aura marqué la relation du Vatican avec l’Afrique sous son pontificat. Pour le Proche et le Moyen Orient, le moment le plus émouvant des années François aura été sa visite en Irak, dans les berceaux de la Bible. Un voyage marqué notamment par sa rencontre avec l’ayatollah Ali Husseini al-Sistani, chef spirituel des chiites irakiens — du jamais vu ». Tout en écrivant que « Francesco n’était pas facho », Paul B. Preciado analyse son « fonctionnement (…) comme un symptôme du glissement des démocraties chrétiennes occidentales, du néolibéralisme multiculturel au fondamentalisme national catholique qui vertèbre le fascisme pop aujourd’hui », ce après avoir noté qu’« il fallait un pape polonais ultraconservateur pour certifier la fin du communisme en Europe ; un pape allemand (affilié aux jeunesses hitlériennes) pour installer le rideau de fer dans la ville papale. (…) Lorsque Benoît XVI a visité la ville de Yad Vashem en 2009, il a préféré ne pas demander pardon pour l’implication de l’Église dans l’extermination des Juifs. Pas la peine de chercher des vertus chez les papes » (« François, un pape sans vertu, comme les autres », Libération les 26-27, p. 19, expliquant en première partie avoir étudié chez les jésuites, ce qui [lui] a permis de suivre la publication des encycliques et les luttes papales comme les amateurs suivent les transferts de pilotes entre les différentes écuries de Formule 1 » ; bien que le philosophe soit « devenu agnostique et anticlérical pratiquant, [il] continue à suivre avec un certain plaisir les changements de pilotes dans la Formule 1 vaticane ». En introduction, il relate avoir « grandi dans une petite ville catholique du nord de l’Espagne où la photo du pape Paul VI était accrochée dans les écoles, juste à côté de celle de Francisco Franco » : s’il avait su alors « qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles Paul VI était gay et qu’il avait eu une relation secrète avec l’acteur italien Paolo Carlini (…), son portrait [lui] aurait inspiré davantage de dévotion » ; v. les références 77 à 79 citées par wikipedia.org, indiquant auparavant qu’en « juin 1918, Giovanni Battista Montini s’attelle à (…) défendre la liberté de l’enseignement. Il lance avec des amis le magazine La Fionda, dans lequel il réclame notamment la création d’une université catholique ». Pour une recherche doctorale jusqu’à la fin de son pontificat, Hubert André, L’évolution de la pensée du Saint-Siège sur l’éducation chrétienne de Pie XI à Paul VI (1929-1978), thèse en sciences de l’éducation, Lyon 2, 2002, résumé) ; sur un autre aspect évoqué dans la tribune précitée, Nina Valbousquet, Les âmes tièdes. Le Vatican face à la Shoah, La Découverte, 2024, recensé par Thomas Vaisset nonfiction.fr le 13 juill. (« titre tiré d’un éditorial d’Albert Camus pour “Combat” au lendemain de Noël 1944 » ; ouvrage réalisé à partir des « archives du pontificat de Pie XII ouvertes en 2020 »).. Il avait aussi pris une position remarquée sur Gaza29« Gaza : dans un ouvrage à paraître, le pape François évoque une enquête pour des faits de “génocide” », rfi.fr 18 nov. 2024, citant « L’espérance ne déçoit jamais. Pèlerins vers un monde meilleur, un livre à paraître le mardi 19 [et dont des extraits ont été publiés] dans le quotidien La Stampa » ; en écho – au moins pour le titre –, v. Rima Hassan (entretien avec, par Denis Sieffert), « Je veux garder espoir », politis.fr 23 avr. 2024 (« J’ai fait des études de droit pour structurer ma pensée et ma colère. La colère, pour moi, n’est pas l’aigreur. Elle peut être saine ») et, outre les liens rassemblés à la note 27 de mon billet du 11 novembre, cette déclaration de Toshiyuki Mimaki, co-président de Nihon Hidankyo (« L’organisation qui a reçu le Nobel de la Paix estime que la situation à Gaza est “comme le Japon il y a 80 ans” », bfmtv.com le 11 oct.), cet entretien de l’historien israélien Amos Goldberg (avec, par Stéphanie Le Bars), « Ce qui se passe à Gaza est un génocide, car Gaza n’existe plus », lemonde.fr le 29 (extrait) et ce compte-rendu de Rachida El Azzouzi, « Israël commet un génocide à Gaza, selon Amnesty International », Mediapart 5 déc. 2024 (extrait, l’ONG ayant réitéré ses accusations dans son rapport annuel, nouvelobs.com (avec AFP) le 29 avr. – article titré avec cette phrase de sa secrétaire générale, Agnès Callamard : « Le monde assiste sur ses écrans à un génocide en direct »). V. encore cet entretien de Faris Lounis avec Stéphanie Dujols, traductrice du texte « parsemé d’éclats poétiques » de Nasser Abu Srour, Je suis ma liberté (Gallimard, 2025) nonfiction.fr le 25 févr. ; Guillaume Duval, « Je faisais partie de ceux qui refusaient d’employer le terme de “génocide” pour désigner la guerre à Gaza, mais il n’y a plus guère de doute », nouvelobs.com le 8 avr. ; Antoine Arjakovsky et al., « Israël, réputé modèle de démocratie, ne respecte plus aucune des règles internationales » et, surtout, Julian Fernandez et Olivier de Frouville, « L’intention génocidaire d’Israël à Gaza est transparente », Le Monde le 12, p. 26 (extrait). V. enfin Corinne Lesnes, « États-Unis : pressions sur les étudiants étrangers », les 13-14 (extrait), p. 3, à partir du cas d’un trentenaire, en Mahmoud Khalil : rapportant son « intention de faire appel » de la décision de la juge de l’immigration Jamee Comans, la journaliste rappelle qu’il « avait été le porte-parole des étudiants qui protestaient, au printemps 2024, “contre le génocide à Gaza” (« Selon la National Lawyers Guild, une association de juristes progressistes, le nombre d’étudiants ciblés pourrait s’approcher du millier ») et ce livre remarqué sur syllepse.net (de l’ex-enseignant à l’Université de Lausanne Joseph Daher)..
S’il est difficile de savoir ce que la mémoire nationale retiendra30V. la tribune de Jean-Louis Schlegel, « L’histoire reconnaîtra que François a remis sur les rails la mise en œuvre de Vatican II », la-croix.com le 22 (à propos de ce concile, qui fait l’objet de sept entrées dans ma thèse, v. supra la note 4). Reprenant in fine une liste de « ceux qui figurent parmi les papes les plus âgés », Midi Libre.fr rappelle le 24 que son prédécesseur, « Joseph Aloisius Ratzinger, décédé à 95 ans, le 31 décembre 2022, (…) a devancé l’ancien “doyen”, le pape Léon XIII, décédé en 1903 à l’âge de 93 ans, après un pontificat d’un quart de siècle » (et de renvoyer à un article publié le jour des 88 ans de Jorge Mario Bergoglio, la-croix.com 17 déc. 2024) résumant son « bilan mitigé », Lénaïg Bredoux, « Le pape François est mort, ses contradictions demeurent au sein de l’Église », Mediapart 21 avr. 2025 (extrait ; au passage, Pierre-Louis Lensel, « Le pape François, né en Argentine, était-il vraiment le premier pape non-européen ? », historia.fr), renvoyant notamment à l’article de Daphné Gastaldi, Mathieu Périsse, Mathieu Martiniere (We Report) et Ali Fegan (SVT1), « Le pape soutient de longue date les intégristes de Saint-Pie-X », Mediapart 6 avr. 2017 : « D’après nos informations, publiées avec le magazine d’investigation suédois Uppdrag granskning de la chaîne SVT1, le pape François, alors encore archevêque de Buenos Aires, a personnellement œuvré en faveur de la reconnaissance de la fraternité en Argentine » (et de révéler « deux lettres au secrétaire du culte, Guillermo Oliveri », datées des 17 mai et 7 juillet 2011, entre lesquels elle « s’est attiré les foudres de Rome en ordonnant vingt nouveaux prêtres » ; « Il faudra attendre 2015 pour que la FSSPX obtienne finalement la reconnaissance des autorités argentines ») ; les journalistes rappelaient plus loin qu’elle a, depuis sa fondation en 1970 – par Marcel Lefebvre en Suisse –, « soigneusement quadrillé le territoire français, en investissant le secteur de l’éducation »., sachant que « c’est aussi en comparaison avec son successeur [que son bilan] s’écrira »31« Et, s’il y a lieu de s’en préoccuper, c’est que la liste des cardinaux, y compris celle des plus papabile, comporte quelques éléments plus proches de Trump et de Vance que de François côté idées, et qui risques, si l’un d’eux est élu, de faire regretter le bilan de ce dernier, fût-il mitigé » (éditorial de Érik Emptaz, « Renvois d’encensoir », Le Canard enchaîné le 23, commençant comme suit : « “Vance au Vatican : le choc de deux catholicismes”, titrait Le Monde des dimanche et lundi de Pâques, sans savoir encore que le choc en question avec le rustique vice-président de Donald Trump, sinon fatal, allait être le dernier auquel le pape François serait soumis » ; v. aussi « D’un François à l’autre », p. 2, indiquant que comme en « 2005, pour les obsèques de Jean-Paul II, (…) les drapeaux seront mis en berne, selon une information de l’Élysée », avant qu’il soit rappelé que François Bayrou, « tout démocrate-chrétien qu’il était, dénonçait une atteinte à la laïcité. En fait, il était surtout en guerre contre Chirac » ; Thomas Legrand, « Laïcité en berne pour le défunt pape », Libération 24 avr. 2025, p. 5 (extrait, citant la communication du Premier ministre) ; Robin D’Angelo, Mariama Darame, Benoît Floc’h et Nathalie Segaunes, « La mort du pape relance les débats sur la laïcité », Le Monde des 27-28, p. 7 (extrait, l’article énumérant les positions, allant de la contestation à la négation de cette question laïque, en passant par les nombreux maires de gauche « tiraillés entre leurs convictions et le devoir d’appliquer les instructions de l’État »). À propos des « convictions catholiques » de l’ancien ministre de l’Éducation, v. mon billet du 15 décembre – précisé dans l’une des premières notes de celui du 31 mars – et depuis cet article d’ Ariane Chemin, « Bayrou, le roman vrai des origines », Le Monde 19 avr. 2025, pp. 20-21 (extrait, renvoyant à « la copie d’une page du quotidien L’Éclair du 2 mai 1936 »), commençant par « Lucien Bayrou (1883-1949), le grand-oncle paternel » ; il a notamment dirigé « un établissement scolaire “libre” à Montpellier, l’Institut Marcadier-Bayrou, 43, rue du Faubourg-Saint-Jaumes, près du Jardin des plantes créé par Henri IV » et, le 26 avril 1936, candidaté « aux législatives – non pas face à Léon Blum à Narbonne, comme le dit la légende familiale, mais dans la 3e circonscription de Montpellier-Sète, sous les couleurs de… l’Action française. (…) Il [sera] largement battu par le candidat socialiste qui représente le Front populaire. (…) [Le prédécesseur de François Bayrou] à la tête de l’Union pour la démocratie française [UDF], François Léotard, racontait que toute enfant de la bourgeoisie catholique de province avait grandi avec un livre de Maurras sur sa table de chevet [et, à] la fac de Bordeaux (…), le jeune Bayrou s’abonne aux publications de l’Action française » (je souligne ; v. mon billet du 28 juin 2024). L’article termine en rappelant « qu’avant de diriger son internat à Montpellier, le grand-oncle Lucien enseignait en 1905 dans (…) l’abbaye-école de Sorèze, dans le Tarn, au pied de la Montagne Noire. Cette même école qui, avec l’affaire des viols et des violences subis à l’établissement catholique de Notre-Dame de Bétharram, vient elle aussi d’entrer dans l’actualité » (v. Sandrine Morin, « Violences à l’Abbaye-école de Sorèze : “que les gens qui ont quelque chose à dire le fassent” plaide l’archevêque d’Albi », francebleu.fr 25 mars 2025 : selon Jean-Louis Balsa, cet établissement « fermé en 1991 n’avait pas de lien formel avec l’enseignement catholique »., il aura été un amateur de football32« “Quel joueur !” : le football argentin rend hommage à son “capitaine” François », france24.comle 23 ; Jacques Vendroux (avec Océane Daniel), « Le pape qui aimait passionnément le football », Le Journal du dimanche le 27, p. 33 (extrait, indiquant lui avoir dit qu’ils avaient « un point commun, le poste de gardien de but », et ce qu’il lui avait rétorqué) : « Il aura vu de son vivant les trois titres de champion du monde de l’Argentine (en 1978 contre les Pays-Bas, en 1986 contre l’Allemagne, en 2022 contre la France) ; avant de conclure sur la paire de gants qu’il lui avait offert, le 22 mars 2023, le célèbre journaliste sportif invite à ne pas oublier « qu’il est allé au stade Vélodrome de Marseille en décembre » de cette année-là : « forcément, son entourage lui a parlé de [l’OM] ». En réaction à une manifestation dans cette ville, Laurence Mildonian, « Profs et assos dénoncent l’argent public versé aux écoles privées », La Provence le 29, p. 2 (extrait) : « Favorables à l’abrogation de la loi Debré, pour laquelle ils ont élaboré un plan de sortie sur cinq ans [fnlp.fr 2 mai 2024], les membres de l’association Libre pensée 13, qui a fait de la laïcité son cheval de bataille, dénoncent les “sommes phénoménales” investies par les pouvoirs publics dans l’école privée : “15 à 17 milliards d’euros sont versés chaque année aux établissements scolaires privés”, rappelle Aminda Huille, trésorière départementale » (pour une autre initiative locale, Philippe Boccara, « LFI dénonce l’utilisation d’argent public pour financer les travaux de la Bonne Mère à Marseille », francebleu.fr les 3-4). et, au plan local, « le pape qui a canonisé Charles de Foucauld et Marie Rivier, deux figures ardéchoises »33RCF Ardèche les 21-22 ; « Mort du pape François : “C’était un pape du peuple”, témoignent les Drômois et Ardéchois qui l’ont rencontré », francebleu.fr le 22, rappelant l’audience qui leur avait été accordée « en mai 2022, à l’occasion de la canonisation de Marie Vivier et Charles de Foucauld » ; à propos de ce dernier, à partir de Civ. 1ère, 21 juin 2005, Fatima X., n° 02-19831, v. mes pp. 607-608 en 2017 (spéc. la note n° 3918) et ma dissertation du 30 avril 2020 (note 43)..
Notes
| ↑1 | Intitulé « Handicap et laïcité : deux postes d’observation du gouvernement Barnier », 29 sept. 2024 |
| ↑2 | V. mon billet situé à la date des vingt ans de la loi Handicap – en cours d’écriture au 19 mai, qui est également la date de publication d’une première version du présent texte –, 11 févr. 2025 |
| ↑3 | Et de renvoyer à ma thèse, Le droit à l’éducation. L’émergence d’un discours dans le contexte des laïcités françaises, UGA, 2017, pp. 562-563 ; Stéphanie Hennette Vauchez, L’École et la République. La nouvelle laïcité scolaire, Dalloz, 2023, pp. 46-47 [citée par Jean Baubérot-Vincent, « Enfin une bonne nouvelle : la création d’un ministère de la Laïcité ! », nouvelobs.com 20 sept. 2024], avant de préciser que Bernard Toulemonde s’exprimait dans le cadre d’un dossier dirigé par André Legrand : décédé le 2 juillet 2024, ce dernier a reçu un hommage du ministère, France Universités saluant aussi sa « mémoire » ; en 2017, je le citais vingt-huit fois, notamment pp. 51, 106-107, 163, 627, 1002 – pour s’en tenir à des mises en perspectives juridiques générales (il fait lui aussi partie des « Témoins et acteurs des politiques de l’éducation depuis la Libération », INRP 2008, tome 5, pp. 100-102 ; à propos de cette « grande enquête (…) lancée au début des années 1990 », v. Bénédicte Girault, « Dans les archives orales de l’Éducation nationale, les énarques à la conquête de l’État », theconversation.com 12 sept. 2024). |
| ↑4 | Thèse préc., 2017, en note de bas de page 563, n° 3633, avant de citer, à la suivante, Nicole Fontaine, à propos de laquelle v. mon billet en mai 2018 (en signalant en particulier l’ouvrage tiré de sa propre thèse qui, comme je le relevais à la 1671ème note, page 273, renvoie à la déclaration sur l’éducation chrétienne Gravissimum Educationis – publiée au terme du concile Vatican II [1962-1965]) ; pour des nécrologies plus ou moins récentes, v. d’abord celles, décalées, de Pierre-Henri Prélot et Jacques Delors – respectivement en illustration et à la fin de ce billet, à propos du pape François –, puis cet article informant que « Cathy Bernheim, figure emblématique du féminisme, est morte », lesnouvellesnews.fr 10 avr. 2025 : « elle participait, le 26 août 1970, à une action emblématique du mouvement : une tentative de dépôt d’une gerbe, sous l’Arc de Triomphe, pour rendre hommage à la femme du Soldat inconnu » et, l’année suivante, « à l’écriture de l’hymne du MLF » ; Zineb Dryef, « Cathy Bernheim. Écrivaine et féministe », Le Monde le 12, p. 19 : « “Quatre femmes, quatre voix, se distinguaient. On les écoutait plus fort dans les AG [assemblées générales] du mouvement : Christine Delphy, Monique Wittig, Antoinette Fouque et Cathy, raconte la sociologue féministe Liliane Kandel. À cela près ! elle ne voulait pas être un chef”. Frédéric Martel, connu pour son histoire des homosexuels en France (Le Rose et le Noir, 1996) se souvient lui aussi d’une femme qui ne cherchait “pas à se mettre avant. Elle est une des plus grandes figures du féminisme français, mais elle reste méconnue” » ; « elle est une des rares à écrire sur l’homosexualité dans Le torchon brûle » (citant l’un des numéros de ce journal féministe et évoquant l’action de 1970, v. ma thèse, pp. 85 – en note n° 447 – et 884). V. enfin Florence Noiville, « Mario Vargas Llosa. Écrivain péruvien. Prix Nobel de littérature », Le Monde 15 avr. 2025, p. 23 (extrait) ; Ludovic Lamant, « Vargas Llosa, un immense écrivain qui s’est égaré », Mediapart 15 avr. 2025 ; Santiago Amigorena, « Pourquoi diantre ne puis-je pas pardonner à Vargas Llosa ? », Libération 17 avr. 2025, p. 22 (extrait) : « sa mort est là, humaine, terriblement humaine comme toute mort, et je sais que ce soir l’amertume laissera la place à la douceur et que je me coucherai un livre de lui à la main » (Le Paradis – un peu plus loin ouvre mon billet du 20 juin 2018 ; je le cite surtout dans mon portrait de Flora Tristan). |
| ↑5 | Sous la présidence de Charles de Gaulle qui, revenu en France préparer le concours de l’École militaire de Saint-Cyr au collège Stanislas (v. infra) – après avoir poursuivi sa scolarisation en Belgique –, avait « effectué ses études primaires chez les frères de l’École Saint-Thomas-d’Aquin, rue de Grenelle, entre 1896 et 1900 » ; il fût ensuite scolarisé « au collège de l’Immaculée Conception, rue de Vaugirard à Paris » (Yves-Marie Hilaire, « L’éducation religieuse de Charles de Gaulle », in Charles de Gaulle, la jeunesse et la guerre 1890-1920 [Colloque], Plon, 2001, 5 p., pp. 2 et 3 ; v. déjà Philippe Portier, « Le général de Gaulle et le catholicisme. Pour une autre interprétation de la pensée gaullienne », Revue historique avr.-juin 1997, n° 602, p. 533, disponible sur gallica.bnf.fr, spéc. pp. 561-562) – soit cet « ancien collège de Jésuites, qui comprenait plusieurs ailes » (wikipedia.org au 27 janv. 2025 : l’une « a été détruite pour construire le lycée autogéré de Paris », la chapelle « est désormais utilisée comme amphithéâtre par l’université Panthéon-Assas tandis que les dortoirs sont devenus des salles de travaux dirigés ». Annoncé le 14 mai, le partenariat signé le 24 avril entre cette dernière et le Tribunal administratif de Paris conduira-t-il à de réelles analyses critiques de ses décisions ? À voir…) ; pour d’autres établissements scolaires ainsi nommés, à partir quelques décisions des juges administratifs : CE, 10 janv. 1986, Commune de Tergnier (et Association des écoles primaire et technique de l’Immaculée Conception), n° 57915 (et n° 58011) : « la circonstance que des places disponibles auraient existé dans les écoles publiques de la commune de [Tergnier (Aisne)] n’est pas à elle seule, de nature à établir que l’école de l’Immaculée conception ne répondait pas à un besoin scolaire au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 » (arrêts rendus sur des conclusions de Michel Roux, qui venaient de publier celles prononcées sur CE, 19 juin 1985, Commune de Bouguenais, n° 33120 et 33121 ; RFDA 1985, pp. 553 et s.) ; TA Amiens, 17 avr. 2003, OGEC c. Préfet de l’Oise, n° 00101 ; LIJMEN oct. 2003, n° 78, pp. 23-24 ; CE, 12 mai 2017, Commune de Villeurbanne, n° 391730 ; JCP A 2017, 2147, concl. Vincent Daumas ; CE, 26 juill. 2018, Ministre de l’Éducation nationale, n° 411870, concernant probablement celui de Carpentras ; v. surtout TA Pau Ord., 28 nov. 2024, n° 2402890, rendue par la juge des référés Sylvande Perdu : « L’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 9 septembre 2024, interdisant à [Christian Espeso] l’exercice de fonctions de direction d’un établissement d’enseignement privé, à titre temporaire et pour une durée de trois ans, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond [sur la requête en annulation n° 2402889] » (art. 1er ; « “Atteintes à la laïcité” : un chef d’établissement catholique de Pau rétabli provisoirement dans ses fonctions », liberation.fr avec AFP le 29, renvoyant à l’enquête de Cécile Bourgneuf publiée le 1er février [extrait, signalant un « changement de direction voulu par le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron en 2013 », ayant placé l’établissement « sous le joug de l’évêque ultraconservateur Marc Aillet »] ; datant également d’avant « l’inspection réalisée en avril 2024 », évoquée au cons. 9, la question posée pour titrer un article de Sébastien Lamarque et Marie Berthoumieu le 6 mars le reste au plan contentieux : « à Pau, l’Immac a-t-elle mis des coups de canif dans le contrat avec l’État ? », extrait larepubliquedespyrenees.fr ; ayant pu « consulter de manière informelle » le rapport de juin, David Perrotin et Antton Rouget en ont tiré un article pour Mediapart le 30 mars 2025, suivi d’un « droit de réponse de Christian Espeso » le 17 avril). |
| ↑6 | « Le Premier ministre assure l’intérim du ministère et par conséquent défend le projet de loi qui portera son nom » (Bruno Poucet, La liberté sous contrat. Une histoire de l’enseignement privé, Fabert, 2009 [avec une recension d’Yves Verneuil, Histoire de l’éducation 2013, n°139, p. 102], p. 87) ; deux pages auparavant, après avoir cité « Émile Dutreuilh, le représentant de l’enseignement privé au Conseil supérieur de l’Éducation nationale » (le 21 décembre 1959), Bruno Poucet rappelle que « le vice-président de l’association parlementaire pour la liberté d’enseignement, le sénateur Prélot [v. supra], y voit non “une loi d’aide à l’enseignement privé, mais la mise en place d’un secteur semi-public de l’enseignement” ». Page 88, il écrit à propos de Michel Debré : « Au cours du débat (…), il a accepté, comme prévu, le vote d’un amendement parlementaire qui permet d’inverser l’ordre des paragraphes de l’article 1 en donnant ainsi oralement son accord à une interprétation du caractère propre qui ne figure pas dans le texte de la loi, mais uniquement dans la discussion parlementaire : celui-ci porterait aussi sur l’enseignement. Mais ce n’est pas dans la loi. Ce compromis ultime est à la source de bien des débats à venir ! » (v. encore p. 125 : « L’association parlementaire pour la liberté d’enseignement se restructure [après mai 1968] (…). Désormais, son secrétariat administratif est assuré par… le secrétariat général de l’enseignement catholique : le député Guy Guermeur en devient l’actif secrétaire général en 1974 et donnera ainsi son nom à la loi de 1977, modifiant la loi Debré de façon ambiguë »). |
| ↑7 | 2ème séance du 24 mai 1984 ; JOAN du 25 (archives.assemblee-nationale.fr), pp. 2638-2639 : suit l’extrait reproduit au paragraphe précédent, puis d’autres développements et la réaction de Pierre Mauroy : « Vous venez, dans une longue intervention, d’évoquer la paix scolaire. Mais c’est un abus de mots que de dire que vous [l’avez établie] (…). Vous avez eu pendant vingt-trois ans la majorité et vous nous avez imposé des lois que les laïques de ce pays n’ont jamais acceptées. (…) ». Rappelant récemment l’implication du Premier ministre, début 1983, dans un évènement construit en référence avec la situation iranienne, Franck Frégosi, « L’islam, une religion d’État en France ? », radiofrance.fr/franceculture 13 févr. podcast La Suite dans les idées, à 13 min. 30 (v. ma thèse préc., 2017, pp. 1005-1006 et, pour 1989, la note 55 de mon billet du 31 mars). |
| ↑8 | Quelques années plus tôt, « certains politiques de la IVe République, sous l’influence du secrétaire général du Parti Socialiste et député Guy Mollet et du garde des Sceaux Robert Lecourt, entendirent conclure (…) un accord de coopération avec le Pape Pie XII. Les négociations furent entamées en 1952 et se poursuivirent jusqu’en 1957 dans un secret absolu, sans toutefois aboutir à un accord » (Mélanie Lopez, « Les politiques concordataires au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : de Franco à Guy Mollet », RDP 2010, p. 1635, proposant « une analyse comparative de ce projet de convention avec le concordat espagnol dénoncé quelques années auparavant par la France » ; article cité dans ma thèse préc., 2017, en notes de bas de pages 349, 574, 578, 742 et 816). |
| ↑9 | 1ère séance du 23 déc. 1959 ; JOAN du 24, p. 3597 (archives.assemblee-nationale.fr). |
| ↑10 | Après que le régime de Vichy l’a remise en cause, l’appellation retenue en 1932 – « de l’Éducation nationale » – avait été rétablie en 1941 (v. ma thèse, p. 104) ; le 23 juillet 2019, suite au rejet de mon appel au groupe 1 pour une qualification extraordinaire aux fonctions de maître de conférences, j’avais écrit un mail qui consigne l’un de mes souvenirs de mon audition du 2 ; historienne du droit (Statut des professeurs et auxiliaires de facultés de 1800 à 1848, thèse Paris II, 1989), Anne-Marie Voutyras-Pierre m’avait demandé de commenter un mot (« corporation ») employé à propos de l’Université impériale, page 68, ce qui m’avait conduit à indiquer aux membres du groupe le contexte de cette citation, en précisant qu’il s’agissait surtout pour moi de situer la gestion publique des activités d’enseignement plus tard (alors que l’expression en italiques, employée par la loi de 1806, peut porter à confusion ; page suivante, je cite le décret de 1808 qui prévoit qu’elle « sera régie et gouvernée par le grand-maître »). Direction du ministère de l’Intérieur depuis 1802, « l’Instruction publique » avait été associée à celui des « Affaires ecclésiastiques » lors de sa création en 1824, avant qu’une autre ordonnance ne l’en émancipe quatre ans plus tard (pp. 70-71). |
| ↑11 | C’est aussi à cette période que Pierre-Henri Prélot a réalisé sa thèse, soutenue et publiée en 1989 ; avec Jean Baubérot, il figure sans doute parmi les auteurs les plus cités dans la mienne, en 2017 (érudits et intègres, je regrette encore qu’ils n’aient pu faire partie du jury ; construite en remerciant les membres de celui finalement réuni, mon introduction de soutenance aurait été différente). En élargissant sa recherche doctorale consacrée aux établissements privés d’enseignement supérieur, il a en effet rédigé la huitième partie du massif Traité de droit français des religions, intitulée « Enseignement et religion ». Je l’avais rencontré la seule fois de ma vie où je suis allé à l’Université de Cergy (désormais CY), pour un séminaire sur les droits dits « sociaux » (organisé par Carlos Miguel Herrera, qui a coordonné les Mélanges à la mémoire de Pierre-Henri Prélot, titrés La vocation du juriste universitaire, IFJD, lgdj.fr 2024) : je l’avais tout de suite apprécié ; nous avions échangé quelques mails en octobre 2014, il avait même eu la gentillesse et la générosité de m’envoyer un ouvrage qu’il a co-dirigé (avec Sébastien Pinon, Le droit constitutionnel d’Adhémar Esmein, Montchrestien, 2009 – lequel n’était pas alors disponible dans les bibliothèques grenobloises). Le 19 novembre 2019, à l’issue de la journée conclusive d’une recherche sur « les situations d’instruction en famille ou dans des écoles privées alternatives hors contrat » (PHEDESCO, à laquelle m’avait invité Françoise Carraud, lle.ens-lyon.fr), Anne Fornerod m’avait encouragé à lui écrire et j’avais une fois encore trop traîné (v. le billet que j’avais prévu de leur adresser et, remontant également à 2018, celui complété en 2021 – avec cette note 21, par cet article de reforme.net le citant, les 16-17 déc. 2020). Touché en apprenant sa disparition, j’avais écrit sur ce site espérer « trouver l’énergie de relater quelques souvenirs de l’homme, bientôt » ; c’est enfin chose faite, en reprenant à mon compte la première page de sa thèse, pointant « les interprétations les plus diverses, parfois les plus hasardeuses, sur la portée (…) de la liberté de l’enseignement » (à propos des décisions du Conseil constitutionnel, mais le propos peut être étendu à celles de la Cour européenne, ainsi que je le remarquais dans ce billet en 2019-2020, spéc. la note n° 19 ; pour un écho « au terme, il est vrai, d’une motivation peu explicite », v. Tanneguy Larzul, « L’enseignement libre : liberté de l’enseignement – liberté d’enseigner », Titre VII. L’enseignement, Les cahiers du Conseil constitutionnel avr. 2024, n° 12, en note n° 53). Rappelant en achevant sa préface qu’il était le « petit-fils » de Marcel Prélot, Yves Gaudemet la commençait par des mots de ce dernier « citant André Philip » (LGDJ, 1989, pp. XVI et XIII, en renvoyant à ce portrait). Si elles sont bien moins nombreuses que les références à « P.-H. Prélot », l’entrée « Marcel Prélot » comprend une petite dizaine de mentions dans ma thèse ; il fût recteur l’Académie de Strasbourg à la Libération, puis secrétaire général de l’Association parlementaire pour la liberté de l’enseignement (v. infra ; je signale en particulier ma note de bas de page 574, n° 3699, pour un échange entre députés que j’avais trouvé assez drôle ; sans aborder l’enseignement, dans un numéro consacré aux « Juristes Catholiques : 1880-1940 », v. Yves Palau, « Les convictions juridiques, un enjeu pour les transformations doctrinales du catholicisme social entre les deux guerres », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques 2008/2, n° 28, p. 369). |
| ↑12 | Marie-Thérèse Frank et Pierre Mignaval, « La loi Savary. Le regard des acteurs », in Serge Hurtig (dir.), Alain Savary : politique et honneur, Presses de Sciences Po, 2002 (sommaire), en note de bas de page 243, rappelant que Bernard Toulemonde a été « chargé de mission auprès du Premier ministre Pierre Mauroy en 1981, directeur des affaires générales au ministère de l’Éducation nationale de 1982 à 1987 ». Alain Savary avait pour directeur de cabinet Jean-Paul Costa (v. en 2017 ma note de bas de page 593, n° 3827, citant Claire de Galembert), qui gardera longtemps de l’année 1984 « amertume et tristesse » (Alain Salles, « Jean-Paul Costa, l’ultime recours », lemonde.fr 9 mars 2009, avant de le citer, puis de le présenter comme ayant été « coincé entre les ultras catholiques et laïcs [sic] ». Au moment d’achever ce billet, le « juge français Mattias Guyomar est élu président de la CEDH, succédant à Marko Bosnjak », lemonde.fr (avec AFP) 28 avr. 2025 : il en était juge « depuis juin 2020, et en présidait une des cinq sections depuis mai 2024 » ; les français « Jean-Paul Costa (2007-2011) et René Cassin (1965-1968) ont assumé cette fonction avant lui » [v. mon portrait]). |
| ↑13 | Ne pas confondre ce projet de loi Savary avec celle du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur (wikipedia.org, la première page étant, selon son actualisation au 8 mars 2025, rédigée à partir d’un livre de Bernard Toulemonde (Petite histoire d’un grand ministère, 1988 ; comparer ma thèse préc., 2017, pp. 212 à 217). |
| ↑14 | Sylvie Lecherbonnier, « Devant les députés, le changement de ton de Philippe Delorme » (extrait) et, avec Éléa Pommiers, « Le Secrétariat général de l’enseignement catholique, influent défenseur du privé [sous contrat auprès du ministère de l’Éducation nationale] », Le Monde 4 avr. 2025, pp. 10-11 (extrait, cette double page comprenant encore l’article de Sarah Belouezzane et Benoît Vitkine, rendant compte de l’élection, mercredi 2, de l’archevêque de Marseille – le cardinal Jean-Marc Aveline – comme président de la Conférence des évêques de France [CEF, extrait]). |
| ↑15 | Texte en cours d’écriture ; v. déjà Bruno Poucet, « Chapitre 15. L’enseignement catholique : des structures historiquement marquées », in Jean-François Condette et Marguerite Figeac-Monthus (dir.), Sur les traces du passé de l’éducation… Patrimoines et territoires de la recherche en éducation dans l’espace français, MSH d’Aquitaine, 2014, p. 209, à partir des « archives privées disponibles », notamment celles « du Secrétariat général de l’enseignement catholique pour la période récente », sans que l’on sache à la lecture de cet article quand ce dernier terme (§§ 1 et 39) – utilisé pour déclarer l’association en 2008 – a remplacé le mot « libre » (§ 26 ; ma note de bas de page 189, n° 1102, citant une publication de 1956 à partir de son livre précité, 2009, p. 61) ; v. spéc. son paragraphe 23 : « On sait que des subventions ont été attribuées, par le Gouvernement de Vichy, à partir de 1942, à titre provisoire, pour les écoles primaires. Mais on sait moins que la conséquence en a été double : renforcer la structuration nationale, renforcer le rôle des évêques en matière d’enseignement ». |
| ↑16 | Dans un entretien récent avec Denis Cosnard, Pierre Mazeaud présente Michel Debré (1912-1996) comme son « père en politique », en rappelant qu’il l’avait appelé comme « chargé de mission à Matignon », mais aussi à dispenser des cours particuliers à ses fils, François et Jean-Louis, lequel allait lui succéder après sa présidence du Conseil constitutionnel – du 9 mars 2004 au 3 mars 2007 (« Je n’aurai pas la chance, moi, de mourir en montagne », Le Monde 27-28 avr. 2025, p. 20, extrait). |
| ↑17 | Antoine Vuille (entretien avec, par Cyril Petit), « Le clash, c’est la dérive du débat d’idées », ouest-france.fr 2 nov. 2024, à l’approche de la sortie de son essai Contre la culture du clash. Débat d’idées et démocratie (Éliott éd.) ; v. aussi la recension de Christian Ruby, nonfiction.fr 18 avr. 2025 : « Cette conception du débat rationnel s’inspire d’un modèle positif : les colloques et rencontres scientifiques. Vuille affirme en effet qu’à ces occasions, chaque interlocuteur “considère l’affirmation de l’autre avec attention”, “s’assure de l’avoir bien comprise avant de la critiquer”, etc. On pourrait toutefois nuancer cette description et relativiser le caractère exemplaire de ces formes de discussion – et pourquoi pas renoncer tout bonnement à chercher un modèle paradigmatique pour le débat d’idées ». Lors de ma soutenance de thèse, avant d’en critiquer le caractère « démesuré », le président du jury commençait son propos en soulignant mon « goût des idées » (rapport de soutenance, page 16, en regrettant à la suivante « l’absence d’éclairage philosophique du sujet », notamment de « discussions des positions de Hayek ou Friedman » ou des propositions de « chèques-éducation ») ; dans l’espoir de prolonger l’échange qui avait suivi, après avoir ajouté quelques éléments fin 2017, j’avais noté quelques mois plus tard que la loi Debré se trouvait cité dès la première édition de Capitalism and Freedom (v. mon billet du 30 août 2018, actualisé depuis, en renvoyant à une émission de France culture sur le néolibéralisme en cette fin de mois d’avril). |
| ↑18 | « Chantier 3. Du “pacte éducatif global” au pacte éducatif local », enseignement-catholique.fr 13 janv.-12 févr. 2021 ; reliant ce PEG au « nouveau contrat social » proposé par l’UNESCO, educatemagis.org juill. 2024, 15 p., rappelant page 4 la participation d’Audrey Azoulay à cette « vidéoconférence », mais aussi que « la rencontre du Pape avec les leaders des religions du monde, le 5 octobre 2021, s’est déroulée en présence de la Sous-directrice générale de l’UNESCO pour l’éducation » (Stefania Giannini, depuis mai 2018, comme je l’indiquais le 31 janvier 2021). |
| ↑19 | Pape François, Discours à la délégation des promoteurs du Pacte éducatif africain », vatican.va 1er juin 2023 ; v. surtout son discours du 15 octobre 2020, (s’)engageant notamment « à voir dans la famille le premier et l’indispensable sujet éducateur » (« Pacte éducatif global : l’appel du pape François aux éducateurs et responsables du monde entier », catechese.catholique.fr ; à propos de l’affirmation du pape que je cite, dans la continuité de Pie XI sur ce point, v. mes pp. 737-738, spéc. la note n° 678 : elle trouve place au début du chapitre 2 de ma seconde partie, transformé en une version « cour(s)te » de 40 p. en 2019, à destination d’un public principalement africain ; s’agissant de ce Master, v. encore Institut Icalde 3 févr. 2024). |
| ↑20 | Il sera remplacé par « Guillaume Prévost, nouveau secrétaire général de l’Enseignement catholique », enseignement-catholique.fr 4-7 avr. 2025 : élu par l’« Assemblée plénière des évêques de France, réunie du 1er au 4 », il « prendra ses fonctions le 1er septembre » ; le lien renvoie à une brève « notice biographique », qui rappelle que cet ancien de la Marine Nationale (2006-2014) est énarque : issu « de la promotion 2016-2017 “Louise Weiss” », il rejoindra le ministère de l’Éducation nationale (arrêté du 22 déc. 2017) et la direction générale de l’enseignement scolaire de Paris, avant d’être nommé délégué général d’un think tank se donnant pour objet de tirer les jeunes « VersLeHaut » (extrait aefinfo.fr 3 sept. 2021). |
| ↑21 | Philippe Delorme, « Le pape des périphéries s’en est allé », enseignement-catholique.fr 21 avr. 2025, rappelant l’invitation « à adhérer au “pacte éducatif mondial” ». À partir du début de l’article d’Anne Jourdain, « Le privé, ou l’école de la sécession. Sous contrat mais sans contrôle » Le Monde diplomatique avr. 2025, pp. 1 et 18-19 (extrait), je place provisoirement ici les éléments suivants : Clément Lanier, Mathilde Montourcy and Eva Sherratt, « Le long chemin de croix de l’Église française. Retours sur le rapport rendu par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église le 5 octobre 2021 », La Revue des Droits de l’Homme ADL 17 janv. 2022, § 33, en conclusion, rappelant que ce texte « ne fait pas l’unanimité. Huit membres de l’Académie catholique de France ont adressé au pape François une analyse du rapport94, révélée au public par le journal La Croix le 25 novembre [2021]95 » (v. toutefois la note 52, citant sa « Lettre au peuple de Dieu », vatican.va 20 août 2018) ; Philippe Portier (entretien avec, par Bernadette Sauvaget), « Les violences physiques et morales constituent souvent le terreau de violences sexuelles », Libération 30 avr. 2025, p. 13 (extrait) : ayant dirigé l’étude socio-historique de la Ciase, l’historien et sociologue souligne qu’elles sont « un fait massif dans l’enseignement catholique pendant la période [étudiée (1950-2020)]. Il y a une nette décélération à partir des années 1980 » (mais pas dans l’établissement qui fait la Une de l’actualité, où « la structure traditionnelle perdure jusqu’aux années 2000 ») ; avant de noter qu’il « est courant historiquement » qu’il faille attendre « un effet dans l’opinion publique », il convient que le « travail de la Ciase aurait pu, il est vrai, donner lieu à des prises de conscience » ; comparer Mathilde Goanec, « Avant Bétharram, l’enseignement catholique s’activait en coulisses pour limiter les contrôles », Mediapart 2 avr. 2025 (v. supra l’une des illustrations du présent billet) : « Sur le caractère inopiné des contrôles, Philippe Delorme avait aussi il y a six mois plusieurs réserves, arguant qu’ils devaient reposer sur une “programmation paisible et cohérente fondée sur une concertation avec la direction diocésaine et les chefs d’établissement” » ; s’il « s’autorisait en novembre 2024 à commenter abondamment la version préparatoire du guide des contrôles qui doivent s’exercer sur son réseau, c’est bien parce que le ministère a ouvert la porte à un tel niveau de dialogue, alors même que légalement l’État ne contracte qu’avec les établissements scolaires privés, et aucunement avec le secrétariat général de l’enseignement catholique. “Il n’y a pas besoin d’une loi pour dialoguer, ce n’est pas institutionnalisé, ce n’est pas une négociation, mais une pratique”, a justifié Guillaume Odinet, chef de direction des affaires juridiques au ministère de l’éducation nationale, auprès de la commission d’enquête lundi 31 mars ». |
| ↑22 | L’entrée « pape » renvoie à une quinzaine de références pertinentes, dont deux relatives à François, en notes de bas de pages 546 et 814, n° 3523 et 1145 – au détour d’une mise en évidence de la façon de lire, en particulier en France, l’article 2 du premier protocole à la Conv.EDH (je ne résiste pas à trouver aujourd’hui assez savoureux l’un des textes cités, challenges.fr 3 oct. 2016 : Bruno Roger-Petit opposait, sur les questions de « genre et laïcité », Manuel Valls à Emmanuel Macron, en invitant à « (re)lire le discours que prononça François Mitterrand [aux cérémonies du tricentenaire de la Révocation de l’Édit de Nantes, elysee.fr 11 oct. 1985] » ; vingt ans plus tard, le premier est ministre du second, qui a progressivement épousé ou cautionné la plupart de ses positions). |
| ↑23 | En citant Sylvie Chaperon, « Le Vatican semble renouer avec une sombre histoire », Le Monde 11 sept. 2018, p. 22 (extrait, réagissant à ces « propos tenus le 26 août et qui ont ensuite disparu de la retranscription officielle sur le site du Vatican ») ; v. depuis Josselin Tricou, « Le pape agit sur l’homophobie comme il agit sur le sexisme : il use (et abuse ?) de la stratégie des petits pas », Le Monde 30 déc. 2023, p. 23 (unil.ch), suite à « la déclaration Fiducia supplicans publiée le 18 décembre par le dicastère pour la doctrine de la foi » (page 5, dans un article intitulé « La gauche ambivalente sur l’héritage de [Jacques Delors] », Nathalie Segaunes cite à propos de ce dernier le politologue Rémi Lefebvre : « Il était déjà, avant même l’alliance entre Bayrou et Macron, pour une recomposition de la vie politique au centre, et l’un des premiers à vouloir se délester de la fraction trop radicale de la gauche » ; plusieurs pages étaient consacrées à sa disparition dans l’édition de la veille, pp. 13 et s., avec en particulier une tribune de l’historien Denis Pelletier, « Un homme de foi engagé en politique », p. 17 : « en 1995, il affirmait que son double compagnonnage, avec la démocratie chrétienne et avec la social-démocratie, avait été l’une des clefs de son succès à la tête de la Commission européenne, parce que ces deux courants étaient historiquement au centre de la construction de l’Europe ») ; à propos du texte « “Dignitas infinita” (“une infinie dignité”, en latin) », Sarah Belouezzane, « Le Vatican s’émeut de la GPA et de la transidentité », Le Monde 10 avr. 2024, p. 5 : « la vraie nouveauté réside dans les chapitres consacrés à la “théorie du genre” et au “changement de sexe” » ; il convient de rappeler qu’ainsi systématisée, celle-ci résulte d’une importation en France (v. mes notes de bas de pages 1075 et 1076-1077, n° 2274 et 2731, ainsi que le glossaire de la revueladeferlante.fr) ; v. encore lemonde.fr (avec AP et AFP) le 8 (présentant cette « nouvelle déclaration sur la “dignité humaine” » comme le « fruit de cinq ans de travail », ce texte du 2 – « 19e anniversaire de la mort de saint Jean-Paul II » – renvoie en note 104 à « la XIVème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, Relatio finalis (24 octobre 2015) », § 58 ; dix paragraphes plus loin, un extrait ramène au titre de ce billet : « Les écoles catholiques remplissent une fonction vitale pour aider les parents dans leur devoir d’éducation de leurs enfants »). |
| ↑24 | V. le premier de mes ajouts, le 30 septembre, à ce texte du 24 avril 2018 ; j’espérais le transformer en une véritable communication (« Éducation et sexualités : approche par les droits d’une question laïque », gsrl-cnrs.fr 10 sept. 2021), mais j’avais dû renoncer, pour des raisons de santé (à propos des actes de ce colloque – dirigé par Anne-Cécile Bégot et Philippe Portier, Éduquer à la sexualité. Religions, laïcités, sexualités, sept. 2024, v. Claire Berest, cafepedagogique.net 10 janv. 2025 ; en lien avec le billet préc., et la note 1 de celui qui précède – le 31 mars –, v. Maxime Macé et Pierre Plottu, « Au lycée de la Légion d’honneur, on tolère les saluts nazis », liberation.fr 20 nov. 2024). Concernant le « nouveau programme d’éducation à la vie affective, relationnelle, et à la sexualité (…), adopté par le Conseil supérieur de l’éducation début 2025 », v. « Évars », revueladeferlante.fr/glossaire/evars |
| ↑25 | Concernant ces pays, v. « Le pape évoque pour la première fois la persécution des Ouïghours », Le Figaro avec AFP 24 nov. 2020, à propos de son « livre dévoilé [le 23], intitulé en français Un temps pour changer (Flammarion) » ; écouter Sara, l’une des chansons « qui composent la série de sons Enfant du destin », du rappeur Médine, mouv.fr le 6 ; en janvier-février avait été publié le Rapport pour l’année 2019 du CCIF (99 p.), lequel comprenait cet article de Kareem Salem, « Regards sur l’étranger : pourquoi les puissances du Golfe demeurent silencieuses face à la répression de Pékin contre les Ouïghours ? ». |
| ↑26 | V. mon billet consacré au Brésil, 5 nov. 2018 (avec une nuance ajoutée in fine, le 17 ; v. depuis Louis Fraysse, « Évangéliques ou évangélistes : quelles différences ? », reforme.net 21-28 avr. 2020). |
| ↑27 | « La RD Congo, plus grand pays catholique d’Afrique, émue par la mort du pape François », france24.com (avec AFP) 21 avr. 2025 : « À Goma, grande ville de l’est de la République démocratique du Congo tombée aux mains du M23 fin janvier [avec le « Rwanda à la manœuvre », comme l’expliquais sur France Inter Pierre Haski le 28] et meurtrie par les combats, les mots du pape en faveur de la paix dans la région sont restés dans les mémoires » (deux ans plus tôt, dans la capitale – à l’ouest –, il « avait célébré une messe en plein air qui, selon les autorités, a rassemblé plus d’un million de fidèles ») ; il aura donc été de ceux ayant tenté d’alerter, tout comme les joueurs de l’équipe nationale lors de la CAN (v. la première illustration de mon billet du 9 avril 2024) et, depuis, plusieurs rappeurs (parmi lesquels Amira Kiziamina qui, ainsi que le rappelle Mehdi Salhi, solidaire.org 12 juill., est « né le 14 février 1995 à Kinshasa », avant d’arriver « en France à un très jeune âge avec sa famille, fuyant les violences et les troubles politiques à la suite de la première guerre du Congo de 1996 » ; resituant cette dernière parmi les conflits qui ravagent la RDC, amnesty.org 29 oct.) : Gradur, Ninho, Josman (qui termine son couplet par des rimes « bien techniques » [genius.com]), Youssoupha, Kalash Criminel et Damso, clip du 21 févr. 2025 (avec dans la descriptions quatre liens documentaires ; pour un extrait du premier et plus long – 12 min. d’Hugo Baiardi –, Brut le 15) ; radiofrance.fr/mouv le 24 ; france24.com le 7 mars ; tissant en lien entre la résistance des adolescentes congolaises et afghanes – à propos desquelles v. la note 56 de mon précédent billet –, v. celui de Carol Mann, blogs.mediapart.fr le 21 ; v. enfin Mathias Jobert, « Devant le Parc des Princes, la colère monte contre Visit Rwanda », sofoot.com 7 avr. et, au lendemain du concert « Solidarité Congo », rfi.fr le 23 (« show à guichets fermé dont les recettes seront reversées à l’association Give Back Charity du chanteur Dadju » : selon une vidéo du 29 oct. 2019, elle s’était « engagée auprès de la Fondation Panzi fondée par le docteur Denis Mukwege pour venir en aide aux femmes victimes de violences sexuelles en RDC » ; à propos de ce dernier, v. cette année-là le 3 mars, en note 3). |
| ↑28 | Jean-Louis de la Vaissière, « Géopolitique du pape François : de l’Ukraine aux périphéries, 10 points sur son bilan international », legrandcontinent.eu le 21 avr., avant de souligner que la « déclaration Fiducia Supplicans en 2024 proposant une bénédiction non sacramentelle à des couples non mariés, y compris homosexuels, fut totalement incomprise, au point que le cardinal de Kinshasa, Fridolin Ambongo, qui préside la conférence des évêques du continent, lui opposera une fin de non-recevoir » ; et d’évoquer « le combat du très conservateur cardinal guinéen Robert Sarah, très populaire en France en raison de ses positions dures sur ces questions — aura marqué la relation du Vatican avec l’Afrique sous son pontificat. Pour le Proche et le Moyen Orient, le moment le plus émouvant des années François aura été sa visite en Irak, dans les berceaux de la Bible. Un voyage marqué notamment par sa rencontre avec l’ayatollah Ali Husseini al-Sistani, chef spirituel des chiites irakiens — du jamais vu ». Tout en écrivant que « Francesco n’était pas facho », Paul B. Preciado analyse son « fonctionnement (…) comme un symptôme du glissement des démocraties chrétiennes occidentales, du néolibéralisme multiculturel au fondamentalisme national catholique qui vertèbre le fascisme pop aujourd’hui », ce après avoir noté qu’« il fallait un pape polonais ultraconservateur pour certifier la fin du communisme en Europe ; un pape allemand (affilié aux jeunesses hitlériennes) pour installer le rideau de fer dans la ville papale. (…) Lorsque Benoît XVI a visité la ville de Yad Vashem en 2009, il a préféré ne pas demander pardon pour l’implication de l’Église dans l’extermination des Juifs. Pas la peine de chercher des vertus chez les papes » (« François, un pape sans vertu, comme les autres », Libération les 26-27, p. 19, expliquant en première partie avoir étudié chez les jésuites, ce qui [lui] a permis de suivre la publication des encycliques et les luttes papales comme les amateurs suivent les transferts de pilotes entre les différentes écuries de Formule 1 » ; bien que le philosophe soit « devenu agnostique et anticlérical pratiquant, [il] continue à suivre avec un certain plaisir les changements de pilotes dans la Formule 1 vaticane ». En introduction, il relate avoir « grandi dans une petite ville catholique du nord de l’Espagne où la photo du pape Paul VI était accrochée dans les écoles, juste à côté de celle de Francisco Franco » : s’il avait su alors « qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles Paul VI était gay et qu’il avait eu une relation secrète avec l’acteur italien Paolo Carlini (…), son portrait [lui] aurait inspiré davantage de dévotion » ; v. les références 77 à 79 citées par wikipedia.org, indiquant auparavant qu’en « juin 1918, Giovanni Battista Montini s’attelle à (…) défendre la liberté de l’enseignement. Il lance avec des amis le magazine La Fionda, dans lequel il réclame notamment la création d’une université catholique ». Pour une recherche doctorale jusqu’à la fin de son pontificat, Hubert André, L’évolution de la pensée du Saint-Siège sur l’éducation chrétienne de Pie XI à Paul VI (1929-1978), thèse en sciences de l’éducation, Lyon 2, 2002, résumé) ; sur un autre aspect évoqué dans la tribune précitée, Nina Valbousquet, Les âmes tièdes. Le Vatican face à la Shoah, La Découverte, 2024, recensé par Thomas Vaisset nonfiction.fr le 13 juill. (« titre tiré d’un éditorial d’Albert Camus pour “Combat” au lendemain de Noël 1944 » ; ouvrage réalisé à partir des « archives du pontificat de Pie XII ouvertes en 2020 »). |
| ↑29 | « Gaza : dans un ouvrage à paraître, le pape François évoque une enquête pour des faits de “génocide” », rfi.fr 18 nov. 2024, citant « L’espérance ne déçoit jamais. Pèlerins vers un monde meilleur, un livre à paraître le mardi 19 [et dont des extraits ont été publiés] dans le quotidien La Stampa » ; en écho – au moins pour le titre –, v. Rima Hassan (entretien avec, par Denis Sieffert), « Je veux garder espoir », politis.fr 23 avr. 2024 (« J’ai fait des études de droit pour structurer ma pensée et ma colère. La colère, pour moi, n’est pas l’aigreur. Elle peut être saine ») et, outre les liens rassemblés à la note 27 de mon billet du 11 novembre, cette déclaration de Toshiyuki Mimaki, co-président de Nihon Hidankyo (« L’organisation qui a reçu le Nobel de la Paix estime que la situation à Gaza est “comme le Japon il y a 80 ans” », bfmtv.com le 11 oct.), cet entretien de l’historien israélien Amos Goldberg (avec, par Stéphanie Le Bars), « Ce qui se passe à Gaza est un génocide, car Gaza n’existe plus », lemonde.fr le 29 (extrait) et ce compte-rendu de Rachida El Azzouzi, « Israël commet un génocide à Gaza, selon Amnesty International », Mediapart 5 déc. 2024 (extrait, l’ONG ayant réitéré ses accusations dans son rapport annuel, nouvelobs.com (avec AFP) le 29 avr. – article titré avec cette phrase de sa secrétaire générale, Agnès Callamard : « Le monde assiste sur ses écrans à un génocide en direct »). V. encore cet entretien de Faris Lounis avec Stéphanie Dujols, traductrice du texte « parsemé d’éclats poétiques » de Nasser Abu Srour, Je suis ma liberté (Gallimard, 2025) nonfiction.fr le 25 févr. ; Guillaume Duval, « Je faisais partie de ceux qui refusaient d’employer le terme de “génocide” pour désigner la guerre à Gaza, mais il n’y a plus guère de doute », nouvelobs.com le 8 avr. ; Antoine Arjakovsky et al., « Israël, réputé modèle de démocratie, ne respecte plus aucune des règles internationales » et, surtout, Julian Fernandez et Olivier de Frouville, « L’intention génocidaire d’Israël à Gaza est transparente », Le Monde le 12, p. 26 (extrait). V. enfin Corinne Lesnes, « États-Unis : pressions sur les étudiants étrangers », les 13-14 (extrait), p. 3, à partir du cas d’un trentenaire, en Mahmoud Khalil : rapportant son « intention de faire appel » de la décision de la juge de l’immigration Jamee Comans, la journaliste rappelle qu’il « avait été le porte-parole des étudiants qui protestaient, au printemps 2024, “contre le génocide à Gaza” (« Selon la National Lawyers Guild, une association de juristes progressistes, le nombre d’étudiants ciblés pourrait s’approcher du millier ») et ce livre remarqué sur syllepse.net (de l’ex-enseignant à l’Université de Lausanne Joseph Daher). |
| ↑30 | V. la tribune de Jean-Louis Schlegel, « L’histoire reconnaîtra que François a remis sur les rails la mise en œuvre de Vatican II », la-croix.com le 22 (à propos de ce concile, qui fait l’objet de sept entrées dans ma thèse, v. supra la note 4). Reprenant in fine une liste de « ceux qui figurent parmi les papes les plus âgés », Midi Libre.fr rappelle le 24 que son prédécesseur, « Joseph Aloisius Ratzinger, décédé à 95 ans, le 31 décembre 2022, (…) a devancé l’ancien “doyen”, le pape Léon XIII, décédé en 1903 à l’âge de 93 ans, après un pontificat d’un quart de siècle » (et de renvoyer à un article publié le jour des 88 ans de Jorge Mario Bergoglio, la-croix.com 17 déc. 2024) résumant son « bilan mitigé », Lénaïg Bredoux, « Le pape François est mort, ses contradictions demeurent au sein de l’Église », Mediapart 21 avr. 2025 (extrait ; au passage, Pierre-Louis Lensel, « Le pape François, né en Argentine, était-il vraiment le premier pape non-européen ? », historia.fr), renvoyant notamment à l’article de Daphné Gastaldi, Mathieu Périsse, Mathieu Martiniere (We Report) et Ali Fegan (SVT1), « Le pape soutient de longue date les intégristes de Saint-Pie-X », Mediapart 6 avr. 2017 : « D’après nos informations, publiées avec le magazine d’investigation suédois Uppdrag granskning de la chaîne SVT1, le pape François, alors encore archevêque de Buenos Aires, a personnellement œuvré en faveur de la reconnaissance de la fraternité en Argentine » (et de révéler « deux lettres au secrétaire du culte, Guillermo Oliveri », datées des 17 mai et 7 juillet 2011, entre lesquels elle « s’est attiré les foudres de Rome en ordonnant vingt nouveaux prêtres » ; « Il faudra attendre 2015 pour que la FSSPX obtienne finalement la reconnaissance des autorités argentines ») ; les journalistes rappelaient plus loin qu’elle a, depuis sa fondation en 1970 – par Marcel Lefebvre en Suisse –, « soigneusement quadrillé le territoire français, en investissant le secteur de l’éducation ». |
| ↑31 | « Et, s’il y a lieu de s’en préoccuper, c’est que la liste des cardinaux, y compris celle des plus papabile, comporte quelques éléments plus proches de Trump et de Vance que de François côté idées, et qui risques, si l’un d’eux est élu, de faire regretter le bilan de ce dernier, fût-il mitigé » (éditorial de Érik Emptaz, « Renvois d’encensoir », Le Canard enchaîné le 23, commençant comme suit : « “Vance au Vatican : le choc de deux catholicismes”, titrait Le Monde des dimanche et lundi de Pâques, sans savoir encore que le choc en question avec le rustique vice-président de Donald Trump, sinon fatal, allait être le dernier auquel le pape François serait soumis » ; v. aussi « D’un François à l’autre », p. 2, indiquant que comme en « 2005, pour les obsèques de Jean-Paul II, (…) les drapeaux seront mis en berne, selon une information de l’Élysée », avant qu’il soit rappelé que François Bayrou, « tout démocrate-chrétien qu’il était, dénonçait une atteinte à la laïcité. En fait, il était surtout en guerre contre Chirac » ; Thomas Legrand, « Laïcité en berne pour le défunt pape », Libération 24 avr. 2025, p. 5 (extrait, citant la communication du Premier ministre) ; Robin D’Angelo, Mariama Darame, Benoît Floc’h et Nathalie Segaunes, « La mort du pape relance les débats sur la laïcité », Le Monde des 27-28, p. 7 (extrait, l’article énumérant les positions, allant de la contestation à la négation de cette question laïque, en passant par les nombreux maires de gauche « tiraillés entre leurs convictions et le devoir d’appliquer les instructions de l’État »). À propos des « convictions catholiques » de l’ancien ministre de l’Éducation, v. mon billet du 15 décembre – précisé dans l’une des premières notes de celui du 31 mars – et depuis cet article d’ Ariane Chemin, « Bayrou, le roman vrai des origines », Le Monde 19 avr. 2025, pp. 20-21 (extrait, renvoyant à « la copie d’une page du quotidien L’Éclair du 2 mai 1936 »), commençant par « Lucien Bayrou (1883-1949), le grand-oncle paternel » ; il a notamment dirigé « un établissement scolaire “libre” à Montpellier, l’Institut Marcadier-Bayrou, 43, rue du Faubourg-Saint-Jaumes, près du Jardin des plantes créé par Henri IV » et, le 26 avril 1936, candidaté « aux législatives – non pas face à Léon Blum à Narbonne, comme le dit la légende familiale, mais dans la 3e circonscription de Montpellier-Sète, sous les couleurs de… l’Action française. (…) Il [sera] largement battu par le candidat socialiste qui représente le Front populaire. (…) [Le prédécesseur de François Bayrou] à la tête de l’Union pour la démocratie française [UDF], François Léotard, racontait que toute enfant de la bourgeoisie catholique de province avait grandi avec un livre de Maurras sur sa table de chevet [et, à] la fac de Bordeaux (…), le jeune Bayrou s’abonne aux publications de l’Action française » (je souligne ; v. mon billet du 28 juin 2024). L’article termine en rappelant « qu’avant de diriger son internat à Montpellier, le grand-oncle Lucien enseignait en 1905 dans (…) l’abbaye-école de Sorèze, dans le Tarn, au pied de la Montagne Noire. Cette même école qui, avec l’affaire des viols et des violences subis à l’établissement catholique de Notre-Dame de Bétharram, vient elle aussi d’entrer dans l’actualité » (v. Sandrine Morin, « Violences à l’Abbaye-école de Sorèze : “que les gens qui ont quelque chose à dire le fassent” plaide l’archevêque d’Albi », francebleu.fr 25 mars 2025 : selon Jean-Louis Balsa, cet établissement « fermé en 1991 n’avait pas de lien formel avec l’enseignement catholique ». |
| ↑32 | « “Quel joueur !” : le football argentin rend hommage à son “capitaine” François », france24.comle 23 ; Jacques Vendroux (avec Océane Daniel), « Le pape qui aimait passionnément le football », Le Journal du dimanche le 27, p. 33 (extrait, indiquant lui avoir dit qu’ils avaient « un point commun, le poste de gardien de but », et ce qu’il lui avait rétorqué) : « Il aura vu de son vivant les trois titres de champion du monde de l’Argentine (en 1978 contre les Pays-Bas, en 1986 contre l’Allemagne, en 2022 contre la France) ; avant de conclure sur la paire de gants qu’il lui avait offert, le 22 mars 2023, le célèbre journaliste sportif invite à ne pas oublier « qu’il est allé au stade Vélodrome de Marseille en décembre » de cette année-là : « forcément, son entourage lui a parlé de [l’OM] ». En réaction à une manifestation dans cette ville, Laurence Mildonian, « Profs et assos dénoncent l’argent public versé aux écoles privées », La Provence le 29, p. 2 (extrait) : « Favorables à l’abrogation de la loi Debré, pour laquelle ils ont élaboré un plan de sortie sur cinq ans [fnlp.fr 2 mai 2024], les membres de l’association Libre pensée 13, qui a fait de la laïcité son cheval de bataille, dénoncent les “sommes phénoménales” investies par les pouvoirs publics dans l’école privée : “15 à 17 milliards d’euros sont versés chaque année aux établissements scolaires privés”, rappelle Aminda Huille, trésorière départementale » (pour une autre initiative locale, Philippe Boccara, « LFI dénonce l’utilisation d’argent public pour financer les travaux de la Bonne Mère à Marseille », francebleu.fr les 3-4). |
| ↑33 | RCF Ardèche les 21-22 ; « Mort du pape François : “C’était un pape du peuple”, témoignent les Drômois et Ardéchois qui l’ont rencontré », francebleu.fr le 22, rappelant l’audience qui leur avait été accordée « en mai 2022, à l’occasion de la canonisation de Marie Vivier et Charles de Foucauld » ; à propos de ce dernier, à partir de Civ. 1ère, 21 juin 2005, Fatima X., n° 02-19831, v. mes pp. 607-608 en 2017 (spéc. la note n° 3918) et ma dissertation du 30 avril 2020 (note 43). |