Pensé comme un document de travail en vue d’un projet professionnel, ce billet semble avoir contribué à ce que je sois, le 21 octobre, invité à l’hôtel de ville de Grenoble pour une table ronde associative le 13 novembre (v. mon billet du 30) ; si vous avez des références à partager, notamment des décisions de justice, n’hésitez pas à me les transmettre en utilisant le formulaire de contact. Mon parti pris a été de m’autoriser quelques références postérieures au 11 février, à l’exception de ces décisions – sauf oubli –, tout comme d’en insérer éventuellement ici à l’avenir qui auraient été rendues auparavant (en effet, je n’ai toujours pas trouvé le temps d’insérer toutes celles que j’ai pu réunir au fil de mes recherches et veilles documentaires ; le présent texte a été retravaillé en fin d’année, en déplaçant certains éléments en notes et une partie d’entre elles dans des pages dédiées – listées pour la plupart là – ou le premier billet complémentaire précité).
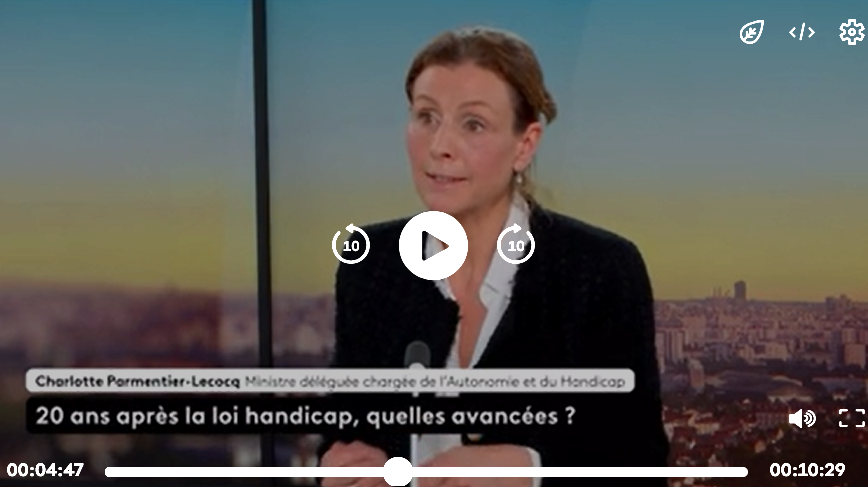
« Le 23 décembre 2024, trois mois après [sa] première nomination1V. mon billet intitulé « Handicap et laïcité : deux postes d’observation du gouvernement Barnier », 29 sept. 2024 (note 31) ; un an après les JOP, évoqués dans la troisième illustration et à la note 26, ajout le 15 août 2025 de cet entretien avec Aurélie Aubert, « Paralympiques de Paris 2024 : c’est « génial que ça ait suscité des vocations », se réjouit la championne de Boccia » (radiofrance.fr)., [Charlotte Parmentier-Lecocq (v. ci-contre) a] été nommée ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, chargée de l’Autonomie et du Handicap »2Cassandre Rogeret, introduisant son entretien avec « Charlotte Parmentier : handicap, quels défis majeurs en 2025 ? », informations.handicap.fr 29 janv. 2025 ; modification de cette note en fin d’année, pour l’alléger après avoir ajouté le 12 novembre un renvoi à la page de la ministre déléguée, dont le ton « trop promotionnel ou publicitaire » n’affecte pas cette précision : « Ses fonctions s’interrompent le 5 octobre 2025 puis elle est reconduite à cette fonction dans le gouvernement Lecornu II le 12 octobre suivant » (wikipedia.org au 29 oct.).. Fin janvier, elle s’est affirmée « très satisfaite de l’élargissement de [s]on périmètre ministériel car il y a des ponts assez évidents entre « handicap » et « autonomie » » ; elle invitait surtout à « regarder tout le chemin parcouru car, en 20 ans, beaucoup de choses ont été faites », en suggérant de se « servir » de « la colère provoquée par le fait que [la loi du 11 février 2005] ne soit pas encore pleinement appliquée »3Entretien préc., après qu’il lui a été demandé sa réaction alors que le « Collectif handicaps, qui regroupe 54 associations, publiait il y a quelques jours son « bilan » (Loi de 2005 toujours pas appliquée : place à l’action !) »..
« Pire, elle est appliquée de manière très hétérogène selon les départements », complétait le président du Collectif Handicaps le 14 janvier : ayant « questionné ses associations membres, représentant tous les types de handicaps », il appelait à « se concentrer » sur « l’effectivité des droits et la concrétisation des promesses du titre de la loi de 2005 » ; « complétée depuis par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et la cinquième branche de la Sécurité Sociale dédiée à l’autonomie quels que soient l’âge, l’état de santé et le handicap de la personne, [cette loi] ne semble pas dépassée »4Arnaud de Broca, « Mot du président », Loi du 11 février 2005 : quel bilan 20 ans plus tard ?, collectifhandicaps.fr 14 janv. 2025 (161 p.), pp. 4-5 ; à propos de l’autonomie – évoquée en note 2 de mon billet du 11 nov. 2024 –, il écrit que « cette nouvelle branche a été créée il n’y a que quelques années et reste à ce jour une coquille vide. Se doter d’une programmation budgétaire pluriannuelle est dorénavant indispensable pour avancer » (v. aussi les pp. 140 et 20-21, renvoyant à un lien pour « une contribution détaillée sur le sujet »). Pour un aperçu de ce « document », il y est indiqué page 12 qu’il « montre l’incapacité de l’État et des acteurs concernés à appliquer les mesures prévues par la loi et le droit international » ; « malgré ces constats mitigés, notre bilan met en lumière des initiatives locales et sectorielles qui ont montré des résultats prometteurs »)..

« Créé en septembre 2019 »5Bilan préc., dernière page du pdf (avec la liste des « 54 associations nationales »)., le Collectif s’arrête néanmoins sur la « définition du handicap » : notant qu’elle « doit être analysée de près », il oppose une « interprétation limitée du handicap, centrée sur les incapacités de la personne », au « modèle social du handicap » consacré au plan onusien en 2006 (v. ci-contre) ; et de défendre cette entrée « par les droits (…) plutôt qu’une approche médicale »6Bilan préc., pp. 16 et 17-18, tout en remarquant que, si « les gouvernements successifs n’ont pas harmonisé la définition de loi de 2005 avec le droit international comme ils auraient dû (…)[,] la réécriture de la loi est simple et n’assurera pas, à elle seule, l’effectivité du droit à compensation ». Dans le même sens, Maxence Kagni, « Handicap : la loi de 2005 est « une promesse non tenue », selon un rapport parlementaire », lcp.fr 9 juill. 2025 ; présenté ce jour par « Christine Le Nabour (Ensemble pour la République) et Sébastien Peytavie (Écologiste et Social) », avec les premier et dernier des extraits vidéos associés.. Lors du dixième anniversaire de la loi, elle était critiquée comme telle par l’Association des paralysés de France7APF, Loi handicap, 10 ans après. Le temps des actes concrets et ambitieux dans une approche inclusive, févr. 2015, 20 p. (a priori plus en ligne), pp. 3 et 18 : « La définition du handicap est réductrice » ; « elle (…) ne prend pas suffisamment en compte les limites apportées par l’environnement. Ainsi, la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées (2006) précise que le handicap n’est pas seulement dû à « une altération de différentes fonctions… » mais à l’interaction entre « incapacités et diverses barrières » ». (désormais nommée APF France handicap8Alain Rochon et Prosper Teboul, « APF change de nom et s’ouvre à d’autres handicaps », informations.handicap.fr 24 avr. 2018 (suite à l’annonce du 18).) ; le 26 mars 2021, Claire Hédon faisait de même devant le Comité européen des droits sociaux9Pièce n° 6, observations de la Défenseure des droits (décision n° 2021-078 du 26 mars, p. 3 : « Une définition du handicap fondée sur une approche médicale » ; v. aussi Comité des droits des personnes handicapées, Observations finales concernant le rapport initial de la France, CRPD/C/FRA/CO/1, 4 oct. 2021, § 7, s’affirmant « préoccupé par (…) ses lois et politiques fondées sur le modèle médical ou une vision paternaliste du handicap, notamment la définition du handicap figurant dans la loi du 11 février 2005 (…), qui est axée sur la prévention du handicap et le traitement médical des incapacités, y compris des handicaps psychosociaux et de l’autisme, et le modèle de la « prise en charge médico-sociale », qui perpétue le placement systématique des personnes handicapées en institution »). (datée du 19 octobre 2022, la décision rendue publique le 17 avril 2023 par ce dernier n’est bien sûr pas ignorée10CEDS, 19 oct. 2022, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe c. France, n° 168/2018, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 17 avr. 2023 ; v. la note 6 de mon billet du 31 déc.) ; page 17, avant de renvoyer à la présentation faite sur le « site de la campagne « Pas si douce France » », le bilan précise que cette réclamation collective « soutenue par » les organisations précitées a été « portée par plusieurs associations membres du Collectif Handicaps (APF France handicap, FNATH, Unafam et Unapei) ». Concernant cette dernière association, v. ce communiqué publié le 7 juillet, déplacé dans mon billet du 30 nov. (note 26).).
Fin 2011, parce que mes premiers travaux de recherche avaient notamment porté sur la question, j’avais été invité à intervenir pour une conférence sur le droit à l’éducation des personnes en situation de handicap11V. la page de mon site consacré à ces travaux de recherche ; c’était précisément le 13 décembre 2011, en Amphi H du bâtiment CLV (v. enseignementsup-recherche.gouv.fr, renvoyant à videos.univ-grenoble-alpes.fr). ; filmée, ce qui était assez stressant pour le jeune chercheur que j’étais 12Pour l’anecdote, j’ai participé à un mouvement collectif assez rapide ayant consisté à se détendre, sur le plan vestimentaire, en abandonnant le costume cravate ; au début des années 2010, son port par les enseignants était encore assez systématique à la faculté de droit de Grenoble., cette communication relaie quelques approximations et lieux communs de la pensée politico-juridique13J’expliquais ainsi en introduction que cette thèse (commencée en 2008) consistait « en une Contribution à l’étude des droits fondamentaux que l’on appelle « droits-créances », en ce qu’ils impliquent l’intervention de l’État pour trouver à se réaliser » ; c’était déjà prendre quelques distance avec ma note sous l’arrêt CE, 8 avr. 2009, Laruelle, n° 311434 ; RDP 2010, n° 1, p. 197, « Éducation des enfants handicapés : droit-créance et carence de l’État » (que j’avais titrée en cédant à cet anagramme, suite à une conversation avec un ancien camarade de Master, destiné à la profession d’avocat), avec une conclusion l’envisageant comme « une illustration de la contribution du recours en responsabilité à la réalisation d’un droit-créance ». Dès mon premier billet sur ce site, j’écrivais à propos de cet arrêt qu’une approche renouvelée figure dans ma thèse pp. 1043 et s. ; s’inscrivant dans le prolongement d’une étude dirigée par Diane Roman, l’argument relatif au « corset doctrinal » des « droits-créances » est développé pp. 1168 et s. (expression dont il est proposé l’abandon pp. 1174 et s.). Le lien vers ma thèse (2017) renvoie à ce billet du 5 janvier 2018, qui reste cependant moins citée que mon commentaire de 2010 (y compris par celui qui l’a dirigée : v. récemment la note 5 de Xavier Dupré de Boulois, « La protection des droits fondamentaux par le recours en responsabilité administrative », RDLF 2024 chron., n° 82) [suivait un passage déplacé à l’avant-dernière de mes notes, intitulée Soutenance et évaluations ultérieures – en cours de rédaction fin 2025]., tout en restant assez pertinente dans une perspective de vulgarisation scientifique14Je m’étais efforcé de répondre au projet de l’Université Ouverte des Humanités (UOH) : « Approches sensibles, pratiques et théoriques du handicap » ; dans la page dédiée à la vulgarisation (actualisée au 1er janv. 2025), wikipedia.org cite le Comité d’éthique du CNRS, Réflexion scientifique sur les résultats de la recherche : les faire connaître « est une des missions du chercheur et des institutions qui le financent » (1er alinéa de l’introduction de l’avis n° 2007-16)..
À partir de la sixième minute, après être revenu sur les « limites de mon propos (…), celui d’un juriste ne travaillant pas exclusivement sur le handicap » et dont l’« approche de terrain est très limitée », je soulignais le « contexte de (…) judiciarisation visant à mettre l’État face à ses engagements (…). Pour éviter une simple succession d’études de cas [concrets15Dans les dernières minutes, je présentais quelques décisions relatives aux étudiant·es, en m’autorisant une remarque « en tant qu’enseignant » : v. Sara E. Witmer et al., « The extended time test accommodation conundrum. Accessing test process data to help improve decision-making », Journal of Applied School Psychology 2024/4, vol. 40, p. 340, recensé par Béatrice Kammerer, « Le tiers-temps est-il vraiment utile aux élèves ? », scienceshumaines.com 13-16 janv. 2025 (Sciences Humaines févr. 2025, n° 375, p. 24), notant que les chercheuses plaident « pour un meilleur ciblage des élèves les plus susceptibles d’en bénéficier », sachant « que des travaux antérieurs ont montré la présence d’effets pervers, notamment pour les enfants souffrant de TDA/H » (v. cette note)., j’avais tenu] au préalable [à] resituer ce mouvement de judiciarisation dans l’histoire nationale (…) des politiques publiques d’éducation en matière de handicap » ; « trois temps peuvent schématiquement être distingués :
1. Le temps du débat sur l’éducabilité où, à renfort de recherches se prétendant scientifiques, [la démarche était de] catégoriser les personnes en situation de handicap selon qu’elles seraient éducables, semi-éducables ou inéducables. Ce temps [commence avec les lois Ferry de 1881-1882 rendant l’instruction obligatoire, gratuite et laïque et il faudra attendre les deux guerres mondiales 16Si – comme je l’évoquais fin 2011 – les mutilés de guerre ont amené à une réflexion sur le handicap, celle-ci s’est doublée d’une autre remise en cause : Olivia Gazalé rappelle ainsi que la « figure du guerrier est complètement fragilisée dans les deux grandes guerres mondiales du vingtième siècle, mais surtout la première, qui est un évènement et une rupture fondamentale » (« Viril – La masculinité mise à mâle », arte.tv 2025, à partir de la septième minute ; à propos de cette belle – et brève – série documentaire, disponible jusqu’au 26 nov. 2027, v. aussi cette note). pour] que la situation évolue (…)17Pour plus de précisions, à partir d’un amendement du 24 décembre 1880, relatif aux sourds-muets et aveugles, v. ma thèse, 2017, pp. 1037 et s..
2. Le temps de l’affirmation de l’éducabilité. Il est consacré par deux lois du 30 juin 1975, l’une « relative aux institutions sociales et médico-sociales » (n° 75-535), l’autre dite « d’orientation en faveur des personnes handicapées » (n° 75-534)18Dans ma contribution à l’ouvrage dirigé par Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif (mare & martin, 2019), je fais observer que « le législateur avait bien mentionné deux obligations en 1975, mais non scolaires » (p. 44), en précisant en note n° 33 : « L’une des deux lois du 30 juin 1975 fait référence à « l’obligation éducative » (art. 4, repris le 15 juin 2000 à l’art. L. 112-1 du Code de l’éducation), l’autre faisant référence à « une obligation nationale » (art. 1er ; comparer celle du 11 juill. 1975 [dite loi Haby, qui affirmait le « droit à une formation scolaire » de l’enfant, avant qu’il ne devienne une déclinaison du droit « à l’éducation » avec la loi Jospin du 10 juillet 1989]) » ; plus récemment, Hervé Rihal écrit dans le même sens que la loi n° 75-534 du 30 juin « ne créé pas une véritable obligation scolaire mais une obligation éducative » (« École inclusive », in Pascale Bertoni et Raphaël Matta-Duvignau (dir.), Dictionnaire critique du droit de l’éducation. Tome 1. Droit de l’enseignement scolaire, mare & martin, 2021, p. 245, spéc. p. 246 ; deux pages plus loin, il cite le décret [Philippe-Blanquer-Cluzel] n° 2020-515 du 4 mai relatif au comité départemental de suivi de l’école inclusive. Cette notice s’ouvre avec la loi n° 2019-791 du 26 juillet ; pour actualiser mes propres développements relatifs à la loi [Peillon] n° 2013-595 – avec pp. 1055 et s. un balancement A. et B. qui pourrait être reconduit –, v. Dominique Momiron, « Comment la loi pour une école de la confiance entend renforcer l’école inclusive », domomir.tumblr.com le 30).. [Tous les enfants sont désormais postulés éducables, ce principe ne se discute plus19En tout cas du point de vue des sciences de l’éducation ; en 2009, j’avais passé une partie de l’été à lire pour critiquer deux phrases du rapporteur public Rémi Keller qui, dans ses conclusions sur l’arrêt Laruelle et pour « exclure dans tous les cas le régime de la responsabilité sans faute », arguait d’une éventuelle éducation impossible ; v. mon commentaire préc. à la RDP 2010, avec les références citées aux notes 35 à 48, en en ajoutant au terme de la présente note. Ces développements terminaient ceux consacrés à cette « consécration équivoque du droit à l’éducation des enfants handicapés » (I) ; après avoir souligné « l’absence de référence aux fondements supra-législatifs du droit à l’éducation (A) », je montrais qu’elle laissait persister des « doutes sur la détermination des titulaires [de ce droit (B)] », en envisageant d’abord une restriction liée à « l’âge des enfants concernés » (v. à cet égard Sébastien Davesne, concl. sur CAA Versailles, 4 juin 2010, citées dans ma thèse en note de bas de page 1031, n° 2480 ; il se référait aussi à la jurisprudence Giraud, que je présente pp. 176 et s. en faisant observer, page 1200, que cet arrêt n° 64076 rendu par le Conseil d’État en 1988, concernait des élèves en section d’enseignement spécialisé). Jugeant que les dispositions législatives n’interdisent pas « à l’État de recourir à des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), formés au codage en langue française parlée complétée, afin d’assurer un accompagnement des enfants déficients auditifs et de favoriser le caractère effectif de leur scolarisation en milieu ordinaire » (CAA Nantes, 16 juill. 2024, Association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados (APEDAC) et a., n° 24NT00001 ; LIJMEN nov. 2024, n° 232, cons. 8) ; v. au sujet de ce handicap cette tribune récente de l’historien Yann Cantin, « Les sourds n’ont pas attendu la langue des signes pour communiquer », Libération 15 mai 2025, p. 19 : « Avant même l’intervention des abbés éclairés [comme celui de l’Épée (1712-1789)] et son successeur à Paris, l’abbé Sicard (1742-1822), les sourds se transmettaient leur langue dans les centres urbains, et en particulier Paris qui offrait un creuset rare à partir du Moyen Âge (…). À cette racine urbaine cruciale s’ajoute une source monastique (…). La troisième racine plonge dans la pantomine romaine, chez Térence (env.190-env.159 av. J.-C.), qui usait de gestes codés pour évoquer des émotions ». S’appuyant notamment sur Pierre Desloges (1747-1792 ?), Observations d’un sourd et muet, 1779, l’auteur s’inscrit donc en faux avec la présentation de la langue des signes française (LSF) comme « surgie d’un éclair de générosité en 1760. (…) La réduire à une création savante, c’est oublier qu’elle s’est construite par et pour les sourds, dans les plis de l’histoire. Il reste beaucoup à faire dans l’étude de l’histoire de la LSF qui est non seulement l’histoire d’une communauté silencieuse, mais aussi celle de l’humanité ».).. Seules restaient en discussion] la question des modalités de l’éducation de ces enfants : soit en milieu dit ordinaire, soit, à défaut, en établissement spécialisé. (…)
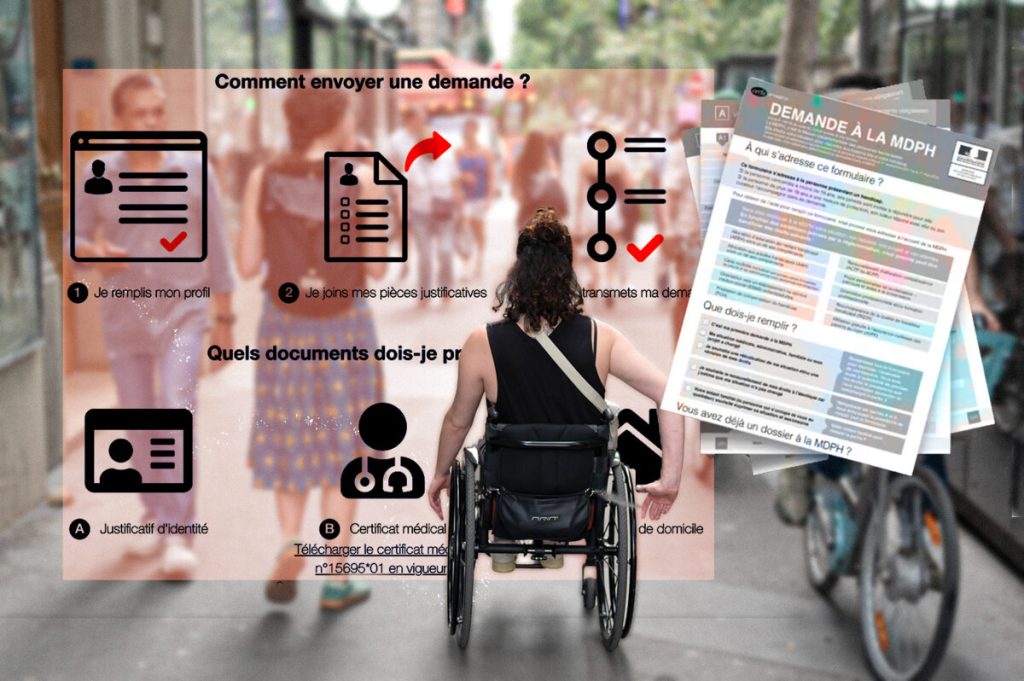
3. Le temps du principe de la scolarisation en milieu ordinaire. Il est consacré trente ans plus tard, avec la loi [n° 2005-102, du 11 février (dite « pour l’égalité des droits et des chances, la participation20Pour un dossier sur cette « notion désormais au cœur de la définition du handicap », Benoît Eyraud, Sébastien Saetta et Tonya Tartour, « Introduction. Rendre effective la participation des personnes en situation de handicap », Participations 2018/3, n° 22, p. 7, spéc. p. 10 et la citoyenneté des personnes handicapées »)]. (…) Tout enfant est inscrit dans l’établissement le plus proche de son domicile. Il y sera en principe accueilli. En principe seulement, car il pourra toujours être orienté en établissement spécialisé si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), au sein de la Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH), décide que ses besoins seront mieux satisfaits [dans un tel établissement] ».
Nonobstant certaines évolutions, encouragées par un rapport récent de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), c’est toujours le cas vingt ans plus tard : « S’agissant des jeunes en âge scolaire, la décision de la CDAPH, en vertu du code de l’éducation [art. L. 351-1 et s.], concerne à la fois les établissements scolaires ordinaires et les [établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)]. Le principe d’une orientation générique vers des structures d’éducation adaptée semble donc devoir être conservé, du moins tant que la CDAPH est amenée à se prononcer sur le principe même d’une scolarisation en milieu ordinaire »21Magali Guegan, Yannick Le Guillou, Franck Le Morvan (avec le concours de Juliette Berthe et Haoyue Yuan Even), Handicap : comment transformer l’offre sociale et médico-sociale pour mieux répondre aux attentes des personnes ? Rapport IGAS n° 2024-017R, janv. 2025, 121 p. (igas.gouv.fr 24 mars 2025), p. 41, avant de préciser à propos du Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) que « la notion désormais couramment employée de troubles du développement intellectuel (TDI) devrait remplacer celle de « déficience intellectuelle » [à propos de sa construction sociale, v. la thèse récente de Céline Lefebvre, Rennes II, 2024, 460 p., pp. 19 et s., spéc. 66 à 79] ; la catégorie plus globale des troubles du neuro développement (TND) n’apparaît pas dans la liste des publics ». Cette « Mission s’inscrit dans la suite de la conférence nationale du handicap (CNH) du 26 avril 2023, qui a défini les objectifs de cette transformation : d’ici 2030, tous les [ESSMS] dédiés aux personnes en situation de handicap (PSH) devront « passer d’une logique de place à une logique d’offre de services coordonnés (…), cette démarche s’imposant dans un premier temps aux ESSMS dédiés aux enfants » (p. 16 ; v. aussi pp. 2, 20-21 et 55-56, au niveau de l’« équation tarifaire ») ; v. aussi pp. 22 et 77-78 : « par leur expertise, les ESSMS sont amenés à jouer un nouveau rôle, celui de ressource pour le droit commun » ; « les modalités de scolarisation (au site de l’ESSMS ou en unité externalisée) doivent être réfléchies en lien étroit avec l’Éducation nationale pour offrir des possibilités d’adaptation et d’évolution au regard des compétences des enfants, lorsque l’inclusion au sein de la classe ordinaire n’est pas possible ». À propos des décrets n° 2017-620 du 24 avril et du 5 juillet 2024, évoqués page 19, v. Virginie Fauvel, « Handicap : un décret renforce le dispositif intégré des établissements et services médicosociaux », banquedesterritoires.fr le 12 ; concernant la circulaire du 3, « Déploiement des pôles d’appui à la scolarité préfigurateurs » (à compter du 1er sept.), Jean Damien Lesay rappelle sur le même site, le 5 mars 2025, qu’elle reprend « une partie des propositions » pour un Acte II de l’école inclusive. Rapport IGAS n° 2022-114R/IGÉSR n° 22-23 107B, août 2023, 77 p. : page 50, il était indiqué que la « mise en place des [PAS] à partir des PIAL suppose une évolution législative (article L. 351-3 du code de l’éducation) » ; malgré l’échec de la tentative rappelée dans mon billet du 31 déc., 100 PAS ont été expérimentés à la rentrée 2024 selon Anne-Aël Durand, « École inclusive : un nouveau dispositif en test », Le Monde 11 juin 2025, p. 10 (extrait ; suite déplacée dans ma note AESH, créée en déc.). Dans une contribution, le Conseil national consultatif des personnes handicapées déplorait l’oubli de ce milieu dit « ordinaire : si les deux [secteurs] ne sont pas transformés en même temps, la société a peu de chance d’évoluer en profondeur et de rendre le droit commun accessible » (CNCPH, Assemblée plénière du 25 oct. 2024, pp. 2 et 4)..
À partir de la 26ème minute de cette conférence fin 2011, j’abordais d’une manière assez générale des éléments que je développerai dans ma thèse en 201722V. spéc. mes pp. 1046 à 1053, en synthétisant ces pages assez denses comme suit, dans mon article précité publié deux ans plus tard : « « l’obligation scolaire s’appliquant à tous » – selon une autre formule de l’arrêt [Laruelle] de 2009 – a bien été un trompe-l’œil » (2019, p. 45, avec deux exemples dans la continuité de l’arrêt n° 318501 de 2011, Beaufils : CAA Marseille, 11 avr. 2014, Mme C., n° 12MA01767, cons. 2 ; TA Rennes, 17 mars 2016, n° 1302758, mis en ligne par Jean Vinçot (ASPERANSA) le 15 déc.). ; le 8 décembre, je résumais par contre la jurisprudence Beaufils – du nom d’un arrêt rendu le 16 mai 2011 – par cette phrase de mon introduction de soutenance : le droit à l’éducation « est toujours susceptible de disparaître, comme en témoignent certaines décisions à propos des troubles autistiques »23V. la fin du premier paragraphe de cette introduction de soutenance (3 p. ; ajout le 17 déc. 2025 d’un exemple postérieur à 2017 : CAA Bordeaux, 12 mai 2020, n° 18BX00272).. Sauf à l’aménager, ce que des juges administratifs ont su faire (à partir de 2015 selon mes recherches24La combinaison des droits « à l’éducation » et « à une prise en charge pluridisciplinaire » a été opérée par TA Paris, 15 juill. 2015 ; AJDA 2015, p. 2327, concl. Pierre Le Garzic (extraits), huit jugements, cons. 2 ou 3 ; CAA Bordeaux, 16 mai 2017, M. A. et Mme C., n° 15BX00309, cons. 3 et 4 (le premier allait toutefois disparaître en cassation : CE, 8 nov. 2019, M. A. et Mme C., n° 412440, rejetant à nouveau le recours des « parents de [Camille, qui] souhaitaient qu’elle reste à l’Institut régional des jeunes sourds », l’IRJS de Poitiers) ; CAA Paris, 10 juill. 2018, n° 17PA01993, cons. 4 et 5 ; TA Lille, 27 mars 2019, n° 1700462, cons. 15, et n° 1702046, cons. 9, jugements mis en ligne par Jean Vinçot le 30 avr. (avec ses suggestions aux parents) ; CAA Versailles, 21 oct. 2021, n° 19VE02418, cons. 4 et 5 ; TA Nantes, 26 août 2022, n° 1912479 (lexbase.fr) ; obs. louislefoyerdecostil.fr le 9 sept., cons. 7 (après avoir mentionné le droit à l’éducation au 4) ; CE Ord., 27 juill. 2023, Ministre de la santé et de la prévention, n° 476203, cons. 4 et 5 (en se bornant toutefois à citer l’article cité à la note suivante).), cette jurisprudence est en effet fondée sur le seul droit à « une prise en charge pluridisciplinaire » des personnes concernées et, depuis la loi n° 2005-102 du 11 février, de celles « atteintes de polyhandicap »25Alinéa 3 de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, ajouté par l’article 90 de la loi de 2005 (sans insérer l’expression « droit à », qui est le fait du Conseil d’État en 2011 : v. ma page 1047 en 2017). J’ajoute ici trois références dont la dernière aurait mérité de figurer dans ma thèse : TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2013, n° 1307736 ; François Béguin, « Affaire Amélie Loquet : l’État devra bien trouver un hébergement à une jeune handicapée », lemonde.fr les 24-28 ; à partir de cette affaire, avant de juger « nécessaire de faire évoluer l’article L. 246-1 afin qu’il couvre plus largement toutes les situations de handicap d’une certaine gravité », Denis Piveteau (avec Saïd Acef, François-Xavier Debrabant, Didier Jaffre et Antoine Perrin), « Zéro sans solution ». Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches, Tome 1 du Rapport du 10 juin 2014 (96 p.), pp. 7 et 10 (proposition soulignée dans le texte) ; présentant entretemps les « deux arrêts de principe [précités] (M. et Mme Laruelle du 8 avril 2009 et Mme Beaufils du 16 mai 2011) »), ce rapport fréquemment cité rappelait que « la réponse judiciaire ne rejoint pas toujours la « vraie vie » (…). Le contentieux indemnitaire n’apporte qu’une réponse tardive [avec,] de manière courante, cinq à six ans de procès (et de frais d’avocat) » (p. 8)..

Il n’en demeure pas moins que cette loi, d’un point de vue scolaire, « élargissait grandement le champ des possibles »26Marc Belpois, « École inclusive, vingt ans de lutte », Télérama 19 févr. 2025, n° 3919, p. 35, à partir d’« une riposte indignée – et sans nuance, le propre de notre époque » à une manifestation contre « l’inclusion systématique et forcée » et pour « la défense de l’enseignement spécialisé », organisée le 25 janvier 2024 « sous les fenêtres de la ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra ».. « Selon un sondage fait pour l’Unapei [par OpinionWay en août 202427V. aussi ce communiqué de presse du 28 et les Résultats de l’enquête réalisée par l’IFOP du 21 au 27 juin 2024, pour le Collectif « Ma place c’est en classe » (ANPEA, APF France handicap, ASEI, Droit au savoir, Gapas, FCPE, FISAF, FNASEPH, Fédération PEEP, Fédération Générale des PEP, Trisomie 21 France, UNANIMES) ; comparer celle de 2025 résumée deux notes plus loin.], l’un des principaux réseaux d’associations consacrés au handicap mental, « huit Français sur dix ont connaissance des difficultés persistantes dans la mise en œuvre de l’école inclusive » »28Marc Belpois, art. préc., 2025, pp. 36 et 37 : « Deux décennies plus tard, « sur le plan quantitatif, la réussite est indéniable », assure un rapport de la Cour des comptes publié en septembre dernier », écrit le journaliste avant de développer cette opposition entre approches chiffrées et qualitative ; page suivante, il note que ce texte souligne que « beaucoup d’orientations préconisées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) vers des établissements médico-sociaux « n’aboutissent pas [toujours], faute de places » » (v. en effet L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, 16 sept. 2024, 159 p., spéc. pp. 18 et 22 : la « mise en œuvre [de leurs] prescriptions » est donc, « d’un point de vue quantitatif, insuffisante » ; page 18, la citation exacte est : « De telles situations conduisent les écoles et les établissements scolaires, en raison de l’obligation de scolarisation qui incombe au ministère de l’[É]ducation nationale, à accueillir des élèves présentant des troubles face auxquels les intervenants éducatifs se sentent démunis »).. S’étant intéressé en 2023 au « climat scolaire » dans les écoles primaires, les chercheurs Benjamin Moignard et Éric Debarbieux sont parvenus à des résultats qui « témoignent du sentiment d’impuissance des professionnels qui estiment que l’inclusion scolaire se fait à l’économie, avec trop peu d’aide spécialisée réelle »29Cités page 36, Marc Belpois concluant à la suivante : « De toute évidence, la politique d’inclusion menée en France depuis vingt ans nécessite davantage de moyens matériels et humains. Mais également une véritable reconnaissance des difficultés des uns et des autres (…) » (la suite de cette note, complétée au cours de l’année, a été déplacée dans mon billet daté du 30 nov., publié le 22 déc.)..
Dans le panorama jurisprudentiel que j’avais publié dix ans après l’arrêt Laruelle30J’avais soigné ce billet, rédigé alors que mes travaux faisaient l’objet d’une évaluation par le CNU ; j’espérais naïvement qu’il soit lu et puisse démontrer ma volonté de diffuser mes résultats de recherche (v. supra les notes 13 et 14 ; cette conférence n’a par ailleurs malheureusement pas été filmée). La première note précise que ce texte reprenait des éléments exposés le jeudi 28 mars 2019 lors de « regards croisés » avec Sandrine Amaré, docteure en sciences de l’éducation et alors directrice pédagogique au CCAURA (quelques mois avant cette information d’Hélène Borie et Pierre Merle, « Dissolution du Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes », cnahes.org 15-29 janv. 2020) ; v. depuis « Faire l’apprentissage de la rencontre dans le cadre d’une coopération interprofessionnelle. Vers une culture en commun », La nouvelle revue – Éducation et société inclusives 2023/1, n° 95, p. 111 ; l’année précédente, avec Louis Bourgois, « Chapitre 8. La reconnaissance des savoirs expérientiels et professionnels dans la formation des travailleurs sociaux : quels effets de la co-formation sur la fonction de formateur dans une institution de formation en travail social ? », in Patrick Lechaux (dir.), Les défis de la formation des travailleurs sociaux, Champ social, 2022, p. 229 (extrait : « depuis une dizaine d’années émerge progressivement un nouveau type d’intervenants dans ces formations : l’usager des services, ou la « personne concernée » »). Plus largement et spécifiquement, Ève Gardien, « Qu’apportent les savoirs expérientiels à la recherche en sciences humaines et sociales », Vie sociale 2017/4, n° 20, p. 31 ; Cécile Philit Arletti, À chacun son savoir ? Recherche participative sur la reconnaissance des multiples expertises au sein d’un parcours d’accompagnement, Mémoire de Master 2 Sciences de l’éducation, Parcours Référent Handicap, Lyon 2 (2022-2023), soutenu le 5 sept. 2024 (137 p.), pp. 17 et s., je concluais que le Rapport spécial de Catalina Devandas-Aguilar, publié trois mois plus tôt, faisait écho au plan international à l’Observation générale consacrée au droit à l’éducation inclusive ; fin 2016, le Comité des droits des personnes handicapées invitait « les États parties à ratifier et à mettre en œuvre sans délai le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées » 31OG n° 4 sur le droit à l’éducation inclusive, 25 nov. 2016, citée dans ma thèse préc., en note de bas de page 1193 ; v. plus largement p. 798, en précisant que le Rapport initial du gouvernement français sur l’application de la CDPH avait été remis le 21 mars de la même année, soit avec retard comme le remarqueront Benoît Eyraud et Arnaud Béal, « Le processus d’ancrage territorial des droits humains : l’exemple de la convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées », Annales de géographie 2021/1, n° 737, p. 86, spéc. p. 101 (étude visant surtout l’article 12) ; précitées, les Observations finales du Comité datent du 4 oct. 2021 (§§ 50-51 concernant l’article 24, en mentionnant « particulièrement les enfants autistes et ceux ayant une trisomie 21 », les « roms, demandeurs d’asile, réfugiés ou en situation irrégulière » et les « personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle ou un handicap intellectuel »)..

Selon le considérant 2 du Préambule de ce texte, administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), les « Parties contractantes [s’affirment c]onscientes des obstacles préjudiciables au plein épanouissement [de ces personnes], qui limitent leur liberté d’expression (…), leur jouissance du droit à l’éducation et la possibilité de faire de la recherche »32Traité « adopté à Marrakech, le 27 juin 2013, par la Conférence diplomatique pour la conclusion d’un traité visant à faciliter l’accès des déficients visuels et des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées » (wipo.int).. La France avait apposé sa signature le 30 avril 2014, sans faire partie des vingt premiers pays à l’avoir ratifié, provoquant pour eux son entrée « en vigueur le 30 septembre 2016, exactement trois mois après »33Union Mondiale des Aveugles (UMA, worldblindunion.org). ; un an et un jour après un avis de la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, concluant à sa compétence exclusive (de celle de ses propres États membres)34CJUE G.C., 14 févr. 2017, avis 3/15, reproduisant son Préambule au § 8, en y renvoyant aussi au § 65 (le résumant, Margaux Bierme, « Compétence exclusive de l’Union européenne pour conclure le traité de Marrakech », ceje.ch le 9 mars)., le Conseil « a approuvé la conclusion du traité avant sa ratification complète » en octobre 201835Conseil de l’Union européenne, décision (UE) 2018/254 du 15 février (eur-lex.europa.eu le 6 nov., y renvoyant en précisant que la ratification « a suivi le 12 octobre » ; le 1er selon wipo.int, avec une entrée en vigueur au 1er janv. 2019 ; ce lien officiel dénombre 100 « membres » au 29 mai 2025). Ce traité international ne doit pas être confondu avec le « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » ; une réponse du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères rappelle qu’il a quant à lui « été adopté le 10 décembre 2018 à Marrakech et définitivement endossé par une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU le 19 décembre 2018 » (JO Sénat 25 avr. 2019, p. 2280). Claire Rodier remarquait alors que, « du fait de l’hystérie conspirationniste confortée par les exagérations des gouvernements souverainistes qui s’est déclenchée contre le pacte, les ONG se retrouvent à défendre un texte à l’égard duquel elles sont très critiques » (entretien avec, par Nicolas Truong, « Le « pacte de Marrakech » n’impose aucune obligation à la France », Le Monde 18 déc. 2018, p. 22) ; à propos du « dernier rapport biennal du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres » (présenté le 5 déc. 2024), v. « Pacte mondial sur les migrations : un rapport des Nations Unies souligne l’urgence d’une gouvernance fondée sur les droits », ituc-csi.org 14 janv. 2025 (renvoyant à « une déclaration commune avec d’autres syndicats mondiaux ».
Au plan interne et bien que le lien avec le droit à l’éducation ne soit pas fait directement, un jugement rendu le 21 mai 2024 mérite d’être signalé à propos des personnes concernées par un handicap visuel36TA Paris, 21 mai 2024, Assoc. Accompagner, Promouvoir, Intégrer les Déficients Visuels (apiDV), n° 2209142/1-3 ; Lettre de jurisprudence du tribunal administratif de Paris sept. 2024, n° 68, p. 20 ; concl. Vincent Guiader (8 p.), spéc. p. 5, le rapporteur public notant en premier lieu que les parties lui semblent s’égarer « un temps dans un débat sur le statut de la société Index éducation, l’éditeur du logiciel Pronote » ; « ce qui importe, c’est la qualification des organismes qui [l’utilisent, soit] des milliers d’EPLE de l’enseignement secondaire » (« environ 10 000 selon l’association requérante », d’après le considérant 7 du jugement, selon lequel elle « démontre par des éléments suffisamment circonstanciés que [c]e service de communication au public en ligne (…) ne respecte pas les obligations prévues par le IV de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 ; annulation – pour « erreur manifeste d’appréciation » – de « la décision implicite de refus » de la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, remontant à 2022). En second lieu et « au vu du transfert de compétence opéré au profit de l’ARCOM depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2023-859 du 6 septembre », il proposait de l’enjoindre à « mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue » (par les articles précité et 8 du décret n° 2019-768 du 24 juill.) dans un délai de deux mois ; le tribunal optera pour trois « à compter de la notification du présent jugement », sans « assortir cette injonction d’une astreinte » (cons. 9). « Il est évidemment très probable que l’ARCOM – une entité indépendante – souligne à son tour les carences et qu’elle formule des injonctions pour les combler », commentait « Édouard Bédarrides, entrepreneur, membre d’Intérêt à Agir » (interviewé avec Pierre Marragou, président d’apiDV, par Yann Gourvennec, visionarymarketing.com 11 oct., avec le communiqué de presse publié le 2 septembre par les « deux associations à l’origine du recours », dont est membre « Hervé Rihal, professeur émérite de droit public à l’Université d’Angers ». En juin 2022, à partir de la 54ème min., il communiquait sur la question ; remerciant Erwann Robbe et Élise Rouillé pour leur aide, v. son texte « Le droit face à l’inaccessibilité des applications logicielles de vie scolaire », in Pascale Bertoni, Olivia Bui-Xuan et Raphaël Matta-Duvignau (dir.), Le droit à l’éducation, mare & martin, 2024, p. 151, spéc. pp. 152-153 : « il convient que chacun comprenne que l’inaccessibilité numérique est aussi gênante pour les déficients visuels qu’une marche pour les personnes atteintes d’un handicap moteur »). Sans apporter plus de précisions à ce propos, ce jugement est évoqué par Anne-Aël Durand, « Handicap : sur Internet, l’accessibilité numérique est médiocre », Le Monde 1er juill. 2025, p. 10, recensant de la part de l’ARCOM, en 2024, « 583 vérifications de sites, et 22 « interventions » à la suite de signalements, sans amende ». ; un autre peut l’être à partir d’une procédure d’urgence37TA Rennes Ord., 5 août 2022, n° 2203615 (dalloz.fr) : selon le compte rendu des observations à l’audience du 2, le requérant précisait notamment « les spécificités qu’il compte apporter au mode d’instruction pour tenir compte du handicap visuel de son fils D qui est évolutif. Il admet[tait cependant] qu’il est préférable, s’il y a un risque que le régime scolaire change en cours d’année après la décision au fond du tribunal, que ce soit pour revenir vers l’instruction à la maison au bout de quelques mois, plutôt que de passer de celle-ci à une scolarisation en cours d’année ». Estimant au considérant 4 qu’il n’expliquait pas « en quoi cette atteinte pourrait perturber durablement son enfant », le juge des référés rejetait son référé-suspension pour défaut d’urgence, tout en envisageant qu’il lui soit donné raison en octobre, soit « quelques semaines » après la rentrée de septembre, « la requête en annulation étant inscrite au rôle de l’audience du tribunal du 29 » (c’est ce qui s’est passé lors du jugement n° 2203596 du 10 octobre (v. dalloz.fr, cons. 8) – joint avec le n° 2203614 (visant également l’ordonnance rendue le 15 juill. 2022, n° 2203597)., qui permet en outre d’illustrer le lien entre handicaps et instruction en famille (IEF)38V. déjà les pages du Rapport Hugues/Portier signalées dans mon billet du 29 sept. 2024 (spéc. à la note 22). à partir du contentieux39Outre l’ordonnance précitée, v. déjà celle rendue quelques semaines plus tôt par la juge des référés Mme Ach : TA Dijon Ord., 12 juill. 2022, n° 2201657 et 2201757 (doctrine.fr), rejetant également pour défaut d’urgence une demande de suspension d’un refus d’IEF pour un enfant de trois ans ; ses parents faisaient « état de son hypersensibilité, d’une suspicion de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de leur volonté de lui permettre d’évoluer à son rythme au moyen de la pédagogie Montessori » (cons. 9) ; absence d’« erreur manifeste d’appréciation » selon le jugement au fond du 13 avr. 2023, n° 2201658 et 2201758 (dalloz.fr, cons. 12). : à cet égard, un rapporteur public a tenu à indiquer : « Une instruction à domicile dont l’insuffisance a été constatée ne saurait constituer une quelconque réponse aux difficultés que rencontre l’administration pour mettre en place les aides nécessaires à la scolarisation adaptée aux enfants atteint[s] de handicap »40Jean-François de Montgolfier, p. 5 (sur 7) des concl. sur CE, 6 févr. 2024, Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, n° 476988 et 487634 ; LIJMEN mai 2024, n° 230, après s’être montré sensible au « combat – administratif certes mais épuisant – que des parents doivent mener ». Annulant l’ordonnance du 8 août 2023, n° 2305118, en ce que « la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit » en retenant un « défaut d’urgence », le Conseil d’État ne donnait toutefois pas raison aux parents qui refusaient « de scolariser, dans un délai de quinze jours, leur fille A…, née en 2013, souffrant de troubles de l’attention et de l’apprentissage, et leur fils B…, né en 2016, atteint d’une surdité bilatérale sévère, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, sous peine de poursuites pénales » (cons. 9 et 7 de la seconde décision préc.) ; en effet, réglant « l’affaire au titre de la procédure de référé engagée », il balayait d’un revers de main les moyens invoqués contre les décisions du DASEN de l’Isère qui, le 1er juin 2023, les avaient mis en demeure (cons. 10, 11 et 12)..

Une situation locale a quant à elle fait l’objet d’une médiatisation récente : « Début octobre, Sylvie Cavé, énergique maman ardéchoise, a écrit une lettre ouverte au président de la République » ; cette habitante de Plats41V. son témoignage recueilli par Dolores Mazzola, « Les enfants hors normes n’ont plus de place en France, ils dérangent et coûtent cher, c’est une triste réalité », france3-regions.franceinfo.fr 8 oct. 2024 (v. plus récemment Guillaume Sockeel, « Ardèche : Elle se bat pour que sa fille trouve une structure adaptée », cheriefmvalleedurhone.fr 10 avr. 2025)., une petite commune située sur les hauteurs de Tournon-sur-Rhône, « se démène pour que sa fille (…) soit scolarisée » ; sa maladie génétique, la neurofibromatose, « affecte son système nerveux. L’adolescente de 16 ans est aussi en décrochage scolaire après deux années de chimiothérapie. (…) Après le travail et le marché, cette maman solo récupère Gabrielle à l’hôpital psychiatrique pour adolescent de Montéléger. L’adolescente est suivie par cet établissement de santé depuis septembre. C’est dans cette institution que l’adolescente passe toute la semaine, à trois quarts d’heure de route de [chez elle]. La préfète de l’Ardèche a orienté cette famille vers des établissements hors secteur. Pour la Tournonaise, ce sont des solutions « incohérentes » qui lui ont été proposées. Une place dans des instituts pour personnes mal voyantes à Paris, Lille ou encore Mulhouse », ou « dans des instituts sectorisés, donc inaccessibles pour l’adolescente ardéchoise [comme à l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Beauvallon (lui aussi dans la Drôme, mais à ne pas confondre avec la commune éponyme, voisine du Centre hospitalier Drôme Vivarais où est accueillie Gabrielle42V. mon billet du 17 février 2024 et « Organisation des pôles cliniques », ch-dromevivarais.fr, avec une carte situant Montéléger à équidistance de Tournon-sur-Rhône et Dieulefit : « L’École de Beauvallon accueille environ 70 enfants en structure ITEP et SESSAD » (wikipedia.org au 23 oct. 2024, rappelant qu’elle a été « fondée en 1929 » par Marguerite Soubeyran, à propos de laquelle v. ma première illustration le 30 avril 2020 ; ajout le 29 oct. 2025 d’un renvoi à la page consacrée au château du même nom, au 17 mai : il le doit à un ancien juge et député de l’Ardèche, et héberge un institut médico-éducatif à Saint-Barthélemy-Grozon – entre Alboussière et Lamastre –, géré par la Fédération des Œuvres Laïques [action-sociale.folardeche.org/ime]).] »43Dolores Mazzola (à partir du reportage de Ozlem Unal et Hugo Chapelon), « « On met ces enfants hors normes au placard, il n’y a pas assez de structures » : Gabrielle, malvoyante et hyperactive, privée d’établissement scolaire », france3-regions.francetvinfo.fr 26 mars 2025 : « Quid de la prise en charge de son hyperactivité dans ces structures ? (…) « Elle va régresser dans un IME (Institut médico-éducatif). Ce n’est pas sa place », assure » Sylvie, qui « aimerait que sa fille soit prise en charge par « Les Primevères ». Cet établissement lyonnais pour déficients visuels est complet. Face au manque de places, Gabrielle [était] sur liste d’attente. Sa famille attend[ait] une réponse pour cette fin du mois de mars » ; je n’ai pas trouvé d’article postérieur qui permette de savoir si cette médiatisation, qui n’est pas donnée à tout le monde, a été efficace. Avant de préciser que « Gabrielle ne souffre d’aucune déficience intellectuelle » (v. supra la note 21), il comprenait une autre citation, développée dans ma note relative aux fondations Perce-Neige et Un ptit truc en plus..

Postérieurement à mon billet précité du 8 avril 2019, le Conseil d’État est venu annuler deux arrêts qui s’y trouvaient présentés, rendus en appel l’année précédente : le premier était défavorable au ministère et à sa direction des affaires juridiques44Note DAJ A1 n° 2018-007 du 5 janv. 2018 ; LIJMEN mai 2018, n° 202 (en s’appuyant sur TA Pau, 5 oct. 2017, n° 1600287 ; LIJMEN nov. 2017, n° 200)., la Cour s’inscrivant dans le prolongement de deux décisions rendues le 20 avril 2011 par la Haute juridiction45V. mon billet (et la chronique) sous CAA Nantes, 15 mai 2018, n° 16NT02951, le 30 sept. ; le 20 novembre 2020, sa Section a considéré que sa jurisprudence n’était pas « réellement engagée »46Raphaël Chambon, concl. sur CE Sect., 20 nov. 2020, Ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 422248 (24 p.), spéc. p. 9, avant de noter que les solutions de 2011 « ont naturellement été remarquées par les associations de défense des personnes handicapées et sont parfois présentées comme ayant fixé l’interprétation à retenir des dispositions en vigueur » ; et de citer « par exemple » en note une décision rendue l’année suivante par le Défenseur des droits (DDD ; v. ma thèse, 2017, pp. 1129 et 1204), puis de préciser entre parenthèses qu’« il ressort des conclusions de Rémi Keller qu’était en cause essentiellement l’accompagnement à la cantine pendant la pause méridienne et durant la garderie organisée avant ou après la classe mais les décisions ne le précisent nullement et leur rédaction est de portée très générale ».. Alors qu’était en cause la prise en charge financière de « l’accompagnement humain [des enfants pour des] activités situées hors du temps scolaire proprement dit », le rapporteur public rappelait d’abord qu’il repose sur des personnes parfois encore appelées « dans le langage courant auxiliaires de vie scolaire (AVS), bien que cette locution n’ait à [sa] connaissance jamais figuré dans une quelconque disposition législative ou règlementaire », contrairement aux « assistants d’éducation créés par la loi n° 2003-400 du 30 avril » et aux « accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) » depuis 2013-201447Concl. préc., pp. 4 et 3 (souligné dans le texte), avec la loi de finances pour 2014 (n° 2013-1278 du 29 déc.) ; v. aussi le décret n° 2014-724 du 27 juin, mentionné en 2017 dans ma note de bas de page 1202, n° 3547, avant de citer le jugement rendu dans cette affaire par le TA Rennes le 30 juin 2016, n° 1600150)..
Plus loin, il ajoutait que « l’aide humaine à la charge de l’État prévue par l’article L. 351-3 du code de l’éducation (…) est une exception au droit commun de la compensation du handicap (…), qui pour les enfants handicapés combine l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et la prestation de compensation du handicap (PCH) » (sachant qu’un éventuel « cumul s’effectue à l’exclusion du complément de [l’allocation précitée, sauf pour certains frais]) ; « Si le législateur a prévu que les AESH puissent intervenir également durant ces temps [d’activités « non scolaires »], c’est bien qu’il a identifié un besoin non satisfait par le droit commun »48Concl. préc., pp. 17-18 et 19 (14 ; souligné dans le texte) ; correction de la parenthèse précédente le 29 oct. 2025, en précisant que le rapporteur public citait alors le 1° du III de l’art. L. 245-1 du CASF, avant de résumer le 2° en note, elle-même rédigée à partir du 3° de l’art. L. 245-3 : les charges « [l]iées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport » et auxquelles la PCH peut se trouver affectée, n’empêchent pas de la cumuler avec le complément de l’AEEH prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale..
Après avoir envisagé plusieurs solutions et en précisant néanmoins que sa « conviction est fermement établie », il concluait à une « obligation pour l’État que pour ce qui relève de sa compétence, à savoir la scolarité de l’élève, soit pour l’essentiel le temps scolaire, même si certaines activités relevant de l’Éducation nationale comme les sorties scolaires peuvent déborder du temps scolaire. Si un AESH peut être mis à disposition d’une collectivité par son employeur qu’est l’État pour accompagner un élève durant une activité que cette collectivité organise sur des temps non scolaires, ou être recruté directement par cette collectivité à cette fin dans le cadre d’un cumul d’activités ou encore co-recruté par l’État et la collectivité, l’État n’est pas tenu d’assurer sa prise en charge financière pour les temps en cause. L’arrêt attaqué, qui a jugé l’inverse, est donc entaché d’erreur de droit et doit être annulé ».

Le rapporteur public allait jusqu’à douter « qu’il soit même loisible à l’État d’assurer une telle prise en charge financière, comme ce fut le cas en l’espèce s’agissant de la pause méridienne : la légalité d’une telle pratique [lui paraissait] en effet incertaine au regard des dispositions de l’article L. 917-1 du code de l’éducation renvoyant indirectement à celles de l’article L. 216-1 du même code prévoyant expressément que la rémunération des agents de l’État mis à disposition des collectivités pour les activités complémentaires à la scolarité qu’elles organisent incombe à ces dernières »49Concl. préc., p. 16 (souligné dans le texte) ; ajout les 17 et 22 décembre 2025 d’un arrêt postérieur à la jurisprudence ici présentée, et qui lui résistait sur ce point : « Les dispositions de l’article L. 216-1 précité ne sauraient décharger l’État de ses obligations en la matière, dès lors que la restauration scolaire ne constitue pas une activité éducative, sportive ou culturelle à leur sens. Au demeurant, si l’organisation matérielle de la restauration scolaire relève de la compétence des communes, départements ou régions, elle ne se confond pas avec l’accès adapté à ce service pour les élèves en situation de handicap, lequel relève de la responsabilité de l’État » (CAA Nancy, 2 févr. 2021, n° 18NC03259, cons. 11-12, répondant « au ministre » dont l’argumentation était rappelée au 6 in fine). Listant plusieurs fautes à propos d’un enfant qui, « né le 3 avril 2011, est porteur d’une trisomie 21 », et aurait dû être accompagné « par un auxiliaire de vie scolaire individuel (AVSI) sur tout le temps scolaire pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2016 » (cons. 1 et 5), cet arrêt est par ailleurs décevant, d’une part au considérant 7 : d’abord en ce qu’il persiste à parler d’« accueil à temps complet », alors même qu’il reconnaît immédiatement que ce ne fût pas le cas ; ensuite en ce qu’il semble en revenir opportunément à une approche formelle du principe d’égalité pour relativiser « les absences pour raisons de santé de l’enseignante de l’enfant » ; enfin en n’expliquant pas la négation qu’« il aurait été imposé aux requérants, en méconnaissance de ses modalités d’accueil, de ne pas amener leur fils à son école les après-midi » (mais pourquoi donc ne l’auraient-ils pas fait, s’ils n’avaient pas été découragé de le faire ?) ; au cons. 9, d’autre part, la CAA de Nancy rejette la demande indemnitaire des parents concernant « l’absence de place disponible au sein du SESSAD Le Tremplin, vers lequel la CDPAH du Bas-Rhin les avait orientés, et dont a résulté leur attente », en considérant qu’il serait aux parents de compléter la liste des structures à contacter impérativement (il est vrai que cette liste était limitée à ce seul Service d’éducation spéciale et de soins à domicile). Intervenant lors d’un colloque à Lyon 3 cette année-là, l’un des vice-présidents du tribunal administratif de Grenoble envisageait, au regard du considérant 10 de l’arrêt de Section préc. (20 nov. 2020, n° 422248), que « l’abstention de l’État à se rapprocher de la commune pour assurer la continuité de l’aide apportée » soit considérée comme fautive (Vincent L’Hôte, « La responsabilité de l’État du fait de l’absence de scolarisation des enfants handicapés », in Jérôme Travard (dir.), La protection des droits fondamentaux par le recours en responsabilité, mare & martin, 2023, p. 139, spéc. pp. 150 et 146)..
En suivant ces conclusions, la Section a donc provoqué un retour en arrière50Alors que le rapporteur public laissait envisager une position médiane, consistant soit à ne pas répondre à cette question qui ne lui était pas posée, soit à « étendre la responsabilité de l’État s’agissant de l’accompagnement humain des élèves handicapés à la seule pause méridienne, dès lors qu’un service de restauration ou des activités sont organisés pendant cette pause bien entendu » (concl. préc., p. 15, avant d’envisager qu’il soit jugé « qu’il appartient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les activités périscolaires en cause, dans l’acception large du terme, sont ou non, dans les circonstances de chaque espèce, de nature à garantir l’effectivité du droit à l’éducation de l’élève handicapé. Mais cette approche casuistique aurait l’inconvénient majeur de conduire à une solution peu lisible alors que votre décision est très attendue par tous les acteurs et cela nous paraît peu opportun »). par rapport à ce qui avait été la pratique de certaines DASEN comme celle d’Ille-et-Vilaine sur ce point en 2015-201651CE Sect., 20 nov. 2020 préc., spéc. les cons. (1,) 9-10 et 11 (cités dans cette réponse ministérielle publiée au JO Sénat 19 mai 2022, p. 2709) et, pour l’arrêt de renvoi de la CAA Nantes, rendu entretemps le 15 février, n° 20NT03661, mêmes considérants (avant toutefois de juger, aux 12 à 17, que la « décision ne devait être annulée qu’en tant qu’elle laisse aux seuls parents de Sama Maxo le soin de se rapprocher de la commune de Bruz pour organiser l’accompagnement de leur enfant lors des temps d’accueil ou des activités périscolaires »). ; même après qu’une loi a été adoptée le 27 mai 2024, la situation est restée compliquée (v. ci-contre).
Si cela a permis à la ministre de l’Éducation nationale d’en faire l’une de ses annonces pour l’anniversaire de la loi de 200552Tania Robieu, « 20 ans de la loi Handicap : Élisabeth Borne dévoile de nouvelles mesures pour une école inclusive », vousnousils.fr 18 févr. 2025 : « 2 000 AESH supplémentaires ainsi que leur prise en charge financière sur le temps de la pause méridienne. La ministre a aussi annoncé sur son compte X l’accélération de la création des pôles d’appui à la scolarité, avec 500 nouveaux pôles en septembre 2025, afin d’atteindre 3 000 pôles en 2027 » ; Sandra Ktourza, « Comité National de Suivi de l’École Inclusive : ni AESH, ni profs », le 25, suite au CNSEI de la veille, avec le « mécontentement sur X » du collectif AESH en action. Lundi 5 mai, la rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l’éducation Julie Delpech, porteuse de la PPL visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers, saluait l’engagement pris par les ministres de l’éducation nationale et du handicap, qui coprésident ce « lieu d’impulsion de la politique d’inclusion scolaire[,] de réunir ce comité tous les six mois » (assemblee-nationale.fr : le CNSEI « a pâti, depuis sa création en 2019, du manque de régularité de ses réunions ») ; les AESH étaient abordés lors de la discussion générale ouverte par Anaïs Belouassa-Cherifi (v. déjà l’intervention de François Ruffin le 11 mars et ma note AESH, créée en déc.)., avec un nouveau décret53Décret n° 2025-137 du 14 févr. relatif à l’intervention des accompagnants des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, JORF du 16 ; LIJMEN mai 2025, n° 235, précisant qu’il complète l’article 1er du décret du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des AESH, après que la loi du 27 mai « visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne a transféré à l’État la rémunération des [AESH] assurant cet accompagnement pendant la pause méridienne, auparavant prise en charge par les collectivités territoriales »., il n’est alors question que de la pause méridienne. Dans le texte en discussion au Parlement, l’insertion de deux alinéas relatifs à l’affectation des AESH est prévue avant le dernier de l’article L. 351-3 du code de l’éducation ; selon le premier, lorsque la décision de la MDPH « mentionne la nécessité d’un accompagnement sur les temps périscolaires, la collectivité territoriale compétente est informée sans délai »54PPL visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers, modifié par le Sénat le 19 juin 2025, art. 1er ter (je souligne)..
Dans ses conclusions précitées, avant d’avancer l’impossibilité pour le juge administratif de « faire seul l’œuvre que le législateur n’a pas encore faite », le rapporteur public concédait à la Cour administrative d’appel qu’« il existe bien un continuum éducatif de l’accueil du matin aux activités périscolaires en passant par les deux demi-journées d’école et la pause méridienne, qui participe à l’effectivité du droit à l’éducation de l’enfant »55Concl. préc., pp. 26 et 13, avant une longue note commençant comme suit : « La lecture des textes faite par la cour peut par ailleurs sembler trouver quelque appui dans la décision n° 2003-471 DC du 24 avril » (v. toutefois mes pp. 1097-1098 et 1103-1104).. N’envisageant les conventions internationales qu’« à travers la jurisprudence de la Cour européenne », elle-même réduite à un arrêt, ces normes ne sont mobilisées pour protéger ce droit que très indirectement56Comparer Béatrice Boissard, « Conventions internationales et le droit de l’éducation », in Pascale Bertoni et Raphaël Matta-Duvignau (dir.), Dictionnaire critique préc., 2021, p. 186, spéc. p. 188 : « Le PIDESC et la CIDE font passer le droit à l’école de droit « mou » à celui de droit positif, contraignant, comportant des obligations pour l’État » (v. cependant sa note de bas de page 190, citant à propos de cette dernière Convention quelques-unes des références répertoriées dans ma thèse en notes de bas de page 1157, n° 3264 et 3265 ; relatives à l’absence d’effet direct de ses dispositions, selon le juge administratif, elles figurent à la suite de développements rappelant la faiblesse des critiques tournées contre l’affirmation des droits dits « sociaux », pp. 1146 et s.). : « Les communes organisant des temps périscolaires sont donc incontestablement redevables, comme toute personne organisant un service public, de l’obligation d’accessibilité aux personnes handicapées de ce service public facultatif »57Concl. préc., pp. 23-24, en citant CE, 4 juill. 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, n° 341533 (v. en 2017 ma [note de bas de] page 1184 [n° 3442]) et CEDH, 23 févr. 2016, Çam c. Turquie, n° 51500/08 (v. mes pp. 872, 982 et 1161)..
Un an et demi plus tard, sur les conclusions du même rapporteur public, le Conseil d’État a cette fois renversé une solution initialement défavorable aux parents58Le 31 décembre 2023, j’avais opéré un rapide renvoi vers mon billet signalant cette annulation de CAA Lyon, 8 nov. 2018, n° 16LY04217, par CE, 19 juill. 2022, n° 428311 ; j’ajoute ici les conclusions de Raphaël Chambon (11 p.) et les observations de Raphaël Matta-Duvignau (entretien avec, par Yann Le Foll, lexbase.fr oct. pour La lettre juridique n° 921 du 20).. S’inscrivant alors dans les pas de son prédécesseur Rémi Keller, concluant sur l’arrêt Laruelle, Raphaël Chambon rappelait qu’« était [alors] précisément en cause le défaut de scolarisation dans un institut médico-éducatif désigné par la [commission, renommée CDAPH en 2005 (v. supra)], faute de place disponible », ce qui n’avait pas empêché l’engagement de la responsabilité de l’État, au nom de qui l’agence régionale de santé (ARS) intervient 59Concl. préc., p. 4, avec cette précision à cet égard : « Depuis janvier 2016, les établissements et services pour personnes en situation de handicap doivent conclure avec l’ARS un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens [CPOM. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)] leur alloue chaque année les crédits nécessaires à leur fonctionnement, par l’intermédiaire des ARS » ; « écarter par principe [cette] responsabilité de l’État » au motif que l’ARS n’a « pas le pouvoir d’imposer à un établissement médico-social la prise en charge d’une personne (…), ce serait potentiellement réduire à peu de chose, s’agissant de la scolarisation hors du milieu ordinaire, la portée de [cette] jurisprudence pourtant si exigeante en apparence » (à propos de l’arrêt Laruelle, v. supra les notes 13 et 19)..

« Le problème se pose toutefois de façon un peu différente lorsque, comme au cas d’espèce, un établissement médico-social désigné par la CDAPH refuse d’accueillir l’enfant au motif qu’il considère ne pouvoir [le faire] au regard de ses difficultés » ; c’est probablement « commettre là une faute », non imputable directement à l’État, mais obliger à « une multitude d’actions en responsabilité distinctes, le cas échéant devant un juge différent selon le statut public ou privé des établissements médico-sociaux, ne semble guère raisonnable ». C’est pourquoi fût proposé, avec succès, « de faire primer la responsabilité de l’État y compris dans un tel cas, dans une logique de guichet unique pour les parents »60Concl. préc., pp. 4-5 : « faute présumée de l’État, charge à ce dernier, le cas échéant, d’engager une action récursoire contre les personnes ayant concouru au préjudice, par exemple l’établissement médico-social désigné par la commission ayant de manière fautive refusé d’accueillir l’enfant handicapé. On peut rapprocher une telle solution de celle adoptée en matière de DALO ». À partir des travaux qui « portent surtout sur des droits de solidarités (ou droits-créances) [v. supra la note 13] tels que le droit au logement [opposable] et le droit à l’éducation », Xavier Dupré de Boulois pousse la comparaison en percevant « une forme de hiérarchisation des victimes », au profit des personnes en situation de handicap (rapport de synthèse préc., juin 2021 ; mare & martin, 2023 ; RDLF 2024 chron., n° 82) ; auparavant, il cite toutefois à la note 52 un arrêt rendu moins d’un mois avant celui ici commenté, qui illustre que l’analyse selon laquelle la jurisprudence repose sur « une obligation de résultat plutôt qu’une simple obligation de moyen (…) n’est pas dénuée d’ambiguïté » : à propos d’un enfant souffrant de TDA/H (v. supra les notes 15 et 39), « né le 16 janvier 2003, dont les parents sont séparés depuis 2004 », le recours de son père est rejeté après analyse d’une situation due « en particulier à l’attitude de [s]a mère » ; parce que son absence de scolarisation « au titre de l’année 2015/2016 (…) n’est pas la conséquence d’un refus des services de l’éducation nationale de l’accueillir en milieu ordinaire ou de l’absence de place dans un établissement spécialisé », la responsabilité de l’État ne saurait être engagée pour faute. Au lieu de s’en tenir à l’affirmation que ce régime est exclusif « de la responsabilité sans faute », la CAA de Nancy croit bon d’écrire dans ce contexte que « l’État est tenu à une obligation de résultat concernant la mise en œuvre du droit à l’éducation » (23 juin 2020, n° 18NC02607, cons. 1 et 13 à 16)….
Avant d’inviter à « être réaliste quant à ce qui peut raisonnablement être exigé des parents d’enfants en situation de handicap »61Concl. préc., p. 10 ; dans le même sens, Vincent L’Hôte doutait qu’il soit « acceptable que des parents soient obligés de prendre contact avec parfois plus d’une dizaine d’établissements » (communication de 2021 préc., publiée sous la direction de Jérôme Travard en 2023, p. 150 ; texte parcouru le 13 nov. 2025, cité le 22 déc.). Dans un article publié quelques mois après le 11 février, Mathilde Goanec rappelle qu’« il arrive encore fréquemment que les parents n’entament pas les démarches, car dépassés ou en difficulté pour accepter la situation de leur enfant » (« Handicap à l’école : « Nous sommes tous désarmés » », Mediapart 17 juin)., le rapporteur public pointait une « erreur de droit en inversant l’ordre d’examen des questions : la cour aurait dû se prononcer d’abord sur l’engagement de la responsabilité de l’État avant d’examiner si, le cas échéant, le comportement des parents du jeune Hocine était de nature à exonérer l’État, en tout ou partie, de sa responsabilité »62Concl. préc., p. 6, appliquant à l’espèce ce qui allait devenir un considérant de principe, avec cette formule reprise mot pour mot au cons. 5 : « la responsabilité de l’État doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité » ; au considérant suivant, le Conseil d’État ne reprenait toutefois pas l’« erreur de droit » mais optait pour une erreur de qualification juridique des faits (QJF) : « En en déduisant que les dommages invoqués trouvaient leur cause exclusive dans le comportement des parents de cet enfant, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce qui lui étaient soumis » (cons. 6). ; en l’occurrence non, concluait-il plus loin – en étant à nouveau suivi : « si Mme D… et M. C… n’ont pas immédiatement contacté, après chacune des décisions de la CDAPH, l’ensemble des structures vers lesquelles celle-ci avait orienté leur enfant (…), leur comportement n’est pas de nature à exonérer l’État de sa responsabilité »63CE, 19 juill. 2022, n° 428311, cons. 11, avant de statuer, « par l’effet dévolutif de l’appel », « sur l’étendue de la réparation » (cons. 12 à 15 : « l’absence de scolarisation de l’enfant E… C… pendant la période mentionnée courant du 9 septembre 2011 au 8 janvier 2013 a causé à cet enfant un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence » ; concernant aussi ses parents et sœurs, le Conseil d’État parvient à une « somme globale de 27 000 euros » ; au cons. 14, conformément aux conclusions page 11, il estime cependant qu’« il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice patrimonial allégué s’agissant de E… C…, tiré de ce qu’il a été privé de la possibilité d’élever son niveau de formation pendant la période en cause, soit établi »)..
Version retravaillée le 22 décembre 2025 (en publiant ce billet daté du 30 nov. ; précédente stabilisation le 23 juin, en insérant le lendemain la quatrième illustration), avant d’avoir l’occasion d’insérer d’autres décisions de justice antérieures au 11 février ; ajouts notamment les 11, 9 et 3 juillet (aux notes 6, 10 et 36 ; v. aussi la n° 28 de mon billet du 30 juin sur l’éducation à la sexualité, complétée le 15 août, tout comme la première note de ces « éléments pour un bilan », en citant ci-après une « artiste et chercheuse » pour finir) : No Anger (entretien avec, par Marie Kirschen [le 19 oct. 2022]), « La sexualité des personnes handicapées est infantilisée »64La Déferlante févr. 2023, n° 9, p. 88, spéc. pp. 90-91 : « Quand j’étais enfant, mon neuropédiatre disait à mes parents que je ne pourrais jamais apprendre la syntaxe ni le calcul. Si mes parents avaient écouté cette parole d’autorité – car parole médicale –, ils auraient délaissé les activités d’éveil, ne m’auraient pas scolarisée, et je n’aurais effectivement pas appris à écrire et à compter, confirmant ainsi l’imaginaire du médecin ». Plus loin, elle évoque l’une de ses « performances [dans le domaine des Arts] ».(extrait évoquant son blog amongestedefendant.wordpress.com65Le 22 janvier 2015, son premier billet s’intitulait « La prise en charge du handicap par l’Éducation nationale » ; v. aussi « De la masturbation et autres considérations sexuelles », 24 févr. 2015 : « Le débat sur l’assistance sexuelle est important, voire nécessaire, car il rend pensable ce qui est demeuré impensé », mais il a « tendance à parler de la question sexuelle en des termes de besoin, évacuant ainsi la question du désir » au risque «, à terme, de médicaliser la sexualité. (…) La légende du prince charmant peut s’appliquer au vécu handicapé (…) : l’image de passivité est commune [et l]’activité du valide ou de l’homme va permettre l’exploration d’un corps passif qui se méconnaît » ; « que faire de l’appropriation de soi et du corps dans tout cela ? » (plus récemment, « Coup de gueule à propos de l’inclusion », 11 juin 2022 ; « Quand je serai grande, tout ira mieux », 2 juill. 2025) ; en lien avec le deuxième texte, Pascale Ribes, « Assistance sexuelle : qu’attendons-nous pour essayer ? », liberation.fr 5 sept. 2025 – à propos d(e la présidente d)’APF France handicap, v. mon billet daté du 30 nov., publié le 22 déc., le texte relevant du dossier : « Baiser. Pour une sexualité qui libère », pp. 68 et s.).
Notes
| ↑1 | V. mon billet intitulé « Handicap et laïcité : deux postes d’observation du gouvernement Barnier », 29 sept. 2024 (note 31) ; un an après les JOP, évoqués dans la troisième illustration et à la note 26, ajout le 15 août 2025 de cet entretien avec Aurélie Aubert, « Paralympiques de Paris 2024 : c’est « génial que ça ait suscité des vocations », se réjouit la championne de Boccia » (radiofrance.fr). |
| ↑2 | Cassandre Rogeret, introduisant son entretien avec « Charlotte Parmentier : handicap, quels défis majeurs en 2025 ? », informations.handicap.fr 29 janv. 2025 ; modification de cette note en fin d’année, pour l’alléger après avoir ajouté le 12 novembre un renvoi à la page de la ministre déléguée, dont le ton « trop promotionnel ou publicitaire » n’affecte pas cette précision : « Ses fonctions s’interrompent le 5 octobre 2025 puis elle est reconduite à cette fonction dans le gouvernement Lecornu II le 12 octobre suivant » (wikipedia.org au 29 oct.). |
| ↑3 | Entretien préc., après qu’il lui a été demandé sa réaction alors que le « Collectif handicaps, qui regroupe 54 associations, publiait il y a quelques jours son « bilan » (Loi de 2005 toujours pas appliquée : place à l’action !) ». |
| ↑4 | Arnaud de Broca, « Mot du président », Loi du 11 février 2005 : quel bilan 20 ans plus tard ?, collectifhandicaps.fr 14 janv. 2025 (161 p.), pp. 4-5 ; à propos de l’autonomie – évoquée en note 2 de mon billet du 11 nov. 2024 –, il écrit que « cette nouvelle branche a été créée il n’y a que quelques années et reste à ce jour une coquille vide. Se doter d’une programmation budgétaire pluriannuelle est dorénavant indispensable pour avancer » (v. aussi les pp. 140 et 20-21, renvoyant à un lien pour « une contribution détaillée sur le sujet »). Pour un aperçu de ce « document », il y est indiqué page 12 qu’il « montre l’incapacité de l’État et des acteurs concernés à appliquer les mesures prévues par la loi et le droit international » ; « malgré ces constats mitigés, notre bilan met en lumière des initiatives locales et sectorielles qui ont montré des résultats prometteurs »). |
| ↑5 | Bilan préc., dernière page du pdf (avec la liste des « 54 associations nationales »). |
| ↑6 | Bilan préc., pp. 16 et 17-18, tout en remarquant que, si « les gouvernements successifs n’ont pas harmonisé la définition de loi de 2005 avec le droit international comme ils auraient dû (…)[,] la réécriture de la loi est simple et n’assurera pas, à elle seule, l’effectivité du droit à compensation ». Dans le même sens, Maxence Kagni, « Handicap : la loi de 2005 est « une promesse non tenue », selon un rapport parlementaire », lcp.fr 9 juill. 2025 ; présenté ce jour par « Christine Le Nabour (Ensemble pour la République) et Sébastien Peytavie (Écologiste et Social) », avec les premier et dernier des extraits vidéos associés. |
| ↑7 | APF, Loi handicap, 10 ans après. Le temps des actes concrets et ambitieux dans une approche inclusive, févr. 2015, 20 p. (a priori plus en ligne), pp. 3 et 18 : « La définition du handicap est réductrice » ; « elle (…) ne prend pas suffisamment en compte les limites apportées par l’environnement. Ainsi, la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées (2006) précise que le handicap n’est pas seulement dû à « une altération de différentes fonctions… » mais à l’interaction entre « incapacités et diverses barrières » ». |
| ↑8 | Alain Rochon et Prosper Teboul, « APF change de nom et s’ouvre à d’autres handicaps », informations.handicap.fr 24 avr. 2018 (suite à l’annonce du 18). |
| ↑9 | Pièce n° 6, observations de la Défenseure des droits (décision n° 2021-078 du 26 mars, p. 3 : « Une définition du handicap fondée sur une approche médicale » ; v. aussi Comité des droits des personnes handicapées, Observations finales concernant le rapport initial de la France, CRPD/C/FRA/CO/1, 4 oct. 2021, § 7, s’affirmant « préoccupé par (…) ses lois et politiques fondées sur le modèle médical ou une vision paternaliste du handicap, notamment la définition du handicap figurant dans la loi du 11 février 2005 (…), qui est axée sur la prévention du handicap et le traitement médical des incapacités, y compris des handicaps psychosociaux et de l’autisme, et le modèle de la « prise en charge médico-sociale », qui perpétue le placement systématique des personnes handicapées en institution »). |
| ↑10 | CEDS, 19 oct. 2022, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe c. France, n° 168/2018, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 17 avr. 2023 ; v. la note 6 de mon billet du 31 déc.) ; page 17, avant de renvoyer à la présentation faite sur le « site de la campagne « Pas si douce France » », le bilan précise que cette réclamation collective « soutenue par » les organisations précitées a été « portée par plusieurs associations membres du Collectif Handicaps (APF France handicap, FNATH, Unafam et Unapei) ». Concernant cette dernière association, v. ce communiqué publié le 7 juillet, déplacé dans mon billet du 30 nov. (note 26). |
| ↑11 | V. la page de mon site consacré à ces travaux de recherche ; c’était précisément le 13 décembre 2011, en Amphi H du bâtiment CLV (v. enseignementsup-recherche.gouv.fr, renvoyant à videos.univ-grenoble-alpes.fr). |
| ↑12 | Pour l’anecdote, j’ai participé à un mouvement collectif assez rapide ayant consisté à se détendre, sur le plan vestimentaire, en abandonnant le costume cravate ; au début des années 2010, son port par les enseignants était encore assez systématique à la faculté de droit de Grenoble. |
| ↑13 | J’expliquais ainsi en introduction que cette thèse (commencée en 2008) consistait « en une Contribution à l’étude des droits fondamentaux que l’on appelle « droits-créances », en ce qu’ils impliquent l’intervention de l’État pour trouver à se réaliser » ; c’était déjà prendre quelques distance avec ma note sous l’arrêt CE, 8 avr. 2009, Laruelle, n° 311434 ; RDP 2010, n° 1, p. 197, « Éducation des enfants handicapés : droit-créance et carence de l’État » (que j’avais titrée en cédant à cet anagramme, suite à une conversation avec un ancien camarade de Master, destiné à la profession d’avocat), avec une conclusion l’envisageant comme « une illustration de la contribution du recours en responsabilité à la réalisation d’un droit-créance ». Dès mon premier billet sur ce site, j’écrivais à propos de cet arrêt qu’une approche renouvelée figure dans ma thèse pp. 1043 et s. ; s’inscrivant dans le prolongement d’une étude dirigée par Diane Roman, l’argument relatif au « corset doctrinal » des « droits-créances » est développé pp. 1168 et s. (expression dont il est proposé l’abandon pp. 1174 et s.). Le lien vers ma thèse (2017) renvoie à ce billet du 5 janvier 2018, qui reste cependant moins citée que mon commentaire de 2010 (y compris par celui qui l’a dirigée : v. récemment la note 5 de Xavier Dupré de Boulois, « La protection des droits fondamentaux par le recours en responsabilité administrative », RDLF 2024 chron., n° 82) [suivait un passage déplacé à l’avant-dernière de mes notes, intitulée Soutenance et évaluations ultérieures – en cours de rédaction fin 2025]. |
| ↑14 | Je m’étais efforcé de répondre au projet de l’Université Ouverte des Humanités (UOH) : « Approches sensibles, pratiques et théoriques du handicap » ; dans la page dédiée à la vulgarisation (actualisée au 1er janv. 2025), wikipedia.org cite le Comité d’éthique du CNRS, Réflexion scientifique sur les résultats de la recherche : les faire connaître « est une des missions du chercheur et des institutions qui le financent » (1er alinéa de l’introduction de l’avis n° 2007-16). |
| ↑15 | Dans les dernières minutes, je présentais quelques décisions relatives aux étudiant·es, en m’autorisant une remarque « en tant qu’enseignant » : v. Sara E. Witmer et al., « The extended time test accommodation conundrum. Accessing test process data to help improve decision-making », Journal of Applied School Psychology 2024/4, vol. 40, p. 340, recensé par Béatrice Kammerer, « Le tiers-temps est-il vraiment utile aux élèves ? », scienceshumaines.com 13-16 janv. 2025 (Sciences Humaines févr. 2025, n° 375, p. 24), notant que les chercheuses plaident « pour un meilleur ciblage des élèves les plus susceptibles d’en bénéficier », sachant « que des travaux antérieurs ont montré la présence d’effets pervers, notamment pour les enfants souffrant de TDA/H » (v. cette note). |
| ↑16 | Si – comme je l’évoquais fin 2011 – les mutilés de guerre ont amené à une réflexion sur le handicap, celle-ci s’est doublée d’une autre remise en cause : Olivia Gazalé rappelle ainsi que la « figure du guerrier est complètement fragilisée dans les deux grandes guerres mondiales du vingtième siècle, mais surtout la première, qui est un évènement et une rupture fondamentale » (« Viril – La masculinité mise à mâle », arte.tv 2025, à partir de la septième minute ; à propos de cette belle – et brève – série documentaire, disponible jusqu’au 26 nov. 2027, v. aussi cette note). |
| ↑17 | Pour plus de précisions, à partir d’un amendement du 24 décembre 1880, relatif aux sourds-muets et aveugles, v. ma thèse, 2017, pp. 1037 et s. |
| ↑18 | Dans ma contribution à l’ouvrage dirigé par Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif (mare & martin, 2019), je fais observer que « le législateur avait bien mentionné deux obligations en 1975, mais non scolaires » (p. 44), en précisant en note n° 33 : « L’une des deux lois du 30 juin 1975 fait référence à « l’obligation éducative » (art. 4, repris le 15 juin 2000 à l’art. L. 112-1 du Code de l’éducation), l’autre faisant référence à « une obligation nationale » (art. 1er ; comparer celle du 11 juill. 1975 [dite loi Haby, qui affirmait le « droit à une formation scolaire » de l’enfant, avant qu’il ne devienne une déclinaison du droit « à l’éducation » avec la loi Jospin du 10 juillet 1989]) » ; plus récemment, Hervé Rihal écrit dans le même sens que la loi n° 75-534 du 30 juin « ne créé pas une véritable obligation scolaire mais une obligation éducative » (« École inclusive », in Pascale Bertoni et Raphaël Matta-Duvignau (dir.), Dictionnaire critique du droit de l’éducation. Tome 1. Droit de l’enseignement scolaire, mare & martin, 2021, p. 245, spéc. p. 246 ; deux pages plus loin, il cite le décret [Philippe-Blanquer-Cluzel] n° 2020-515 du 4 mai relatif au comité départemental de suivi de l’école inclusive. Cette notice s’ouvre avec la loi n° 2019-791 du 26 juillet ; pour actualiser mes propres développements relatifs à la loi [Peillon] n° 2013-595 – avec pp. 1055 et s. un balancement A. et B. qui pourrait être reconduit –, v. Dominique Momiron, « Comment la loi pour une école de la confiance entend renforcer l’école inclusive », domomir.tumblr.com le 30). |
| ↑19 | En tout cas du point de vue des sciences de l’éducation ; en 2009, j’avais passé une partie de l’été à lire pour critiquer deux phrases du rapporteur public Rémi Keller qui, dans ses conclusions sur l’arrêt Laruelle et pour « exclure dans tous les cas le régime de la responsabilité sans faute », arguait d’une éventuelle éducation impossible ; v. mon commentaire préc. à la RDP 2010, avec les références citées aux notes 35 à 48, en en ajoutant au terme de la présente note. Ces développements terminaient ceux consacrés à cette « consécration équivoque du droit à l’éducation des enfants handicapés » (I) ; après avoir souligné « l’absence de référence aux fondements supra-législatifs du droit à l’éducation (A) », je montrais qu’elle laissait persister des « doutes sur la détermination des titulaires [de ce droit (B)] », en envisageant d’abord une restriction liée à « l’âge des enfants concernés » (v. à cet égard Sébastien Davesne, concl. sur CAA Versailles, 4 juin 2010, citées dans ma thèse en note de bas de page 1031, n° 2480 ; il se référait aussi à la jurisprudence Giraud, que je présente pp. 176 et s. en faisant observer, page 1200, que cet arrêt n° 64076 rendu par le Conseil d’État en 1988, concernait des élèves en section d’enseignement spécialisé). Jugeant que les dispositions législatives n’interdisent pas « à l’État de recourir à des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), formés au codage en langue française parlée complétée, afin d’assurer un accompagnement des enfants déficients auditifs et de favoriser le caractère effectif de leur scolarisation en milieu ordinaire » (CAA Nantes, 16 juill. 2024, Association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados (APEDAC) et a., n° 24NT00001 ; LIJMEN nov. 2024, n° 232, cons. 8) ; v. au sujet de ce handicap cette tribune récente de l’historien Yann Cantin, « Les sourds n’ont pas attendu la langue des signes pour communiquer », Libération 15 mai 2025, p. 19 : « Avant même l’intervention des abbés éclairés [comme celui de l’Épée (1712-1789)] et son successeur à Paris, l’abbé Sicard (1742-1822), les sourds se transmettaient leur langue dans les centres urbains, et en particulier Paris qui offrait un creuset rare à partir du Moyen Âge (…). À cette racine urbaine cruciale s’ajoute une source monastique (…). La troisième racine plonge dans la pantomine romaine, chez Térence (env.190-env.159 av. J.-C.), qui usait de gestes codés pour évoquer des émotions ». S’appuyant notamment sur Pierre Desloges (1747-1792 ?), Observations d’un sourd et muet, 1779, l’auteur s’inscrit donc en faux avec la présentation de la langue des signes française (LSF) comme « surgie d’un éclair de générosité en 1760. (…) La réduire à une création savante, c’est oublier qu’elle s’est construite par et pour les sourds, dans les plis de l’histoire. Il reste beaucoup à faire dans l’étude de l’histoire de la LSF qui est non seulement l’histoire d’une communauté silencieuse, mais aussi celle de l’humanité ».). |
| ↑20 | Pour un dossier sur cette « notion désormais au cœur de la définition du handicap », Benoît Eyraud, Sébastien Saetta et Tonya Tartour, « Introduction. Rendre effective la participation des personnes en situation de handicap », Participations 2018/3, n° 22, p. 7, spéc. p. 10 |
| ↑21 | Magali Guegan, Yannick Le Guillou, Franck Le Morvan (avec le concours de Juliette Berthe et Haoyue Yuan Even), Handicap : comment transformer l’offre sociale et médico-sociale pour mieux répondre aux attentes des personnes ? Rapport IGAS n° 2024-017R, janv. 2025, 121 p. (igas.gouv.fr 24 mars 2025), p. 41, avant de préciser à propos du Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) que « la notion désormais couramment employée de troubles du développement intellectuel (TDI) devrait remplacer celle de « déficience intellectuelle » [à propos de sa construction sociale, v. la thèse récente de Céline Lefebvre, Rennes II, 2024, 460 p., pp. 19 et s., spéc. 66 à 79] ; la catégorie plus globale des troubles du neuro développement (TND) n’apparaît pas dans la liste des publics ». Cette « Mission s’inscrit dans la suite de la conférence nationale du handicap (CNH) du 26 avril 2023, qui a défini les objectifs de cette transformation : d’ici 2030, tous les [ESSMS] dédiés aux personnes en situation de handicap (PSH) devront « passer d’une logique de place à une logique d’offre de services coordonnés (…), cette démarche s’imposant dans un premier temps aux ESSMS dédiés aux enfants » (p. 16 ; v. aussi pp. 2, 20-21 et 55-56, au niveau de l’« équation tarifaire ») ; v. aussi pp. 22 et 77-78 : « par leur expertise, les ESSMS sont amenés à jouer un nouveau rôle, celui de ressource pour le droit commun » ; « les modalités de scolarisation (au site de l’ESSMS ou en unité externalisée) doivent être réfléchies en lien étroit avec l’Éducation nationale pour offrir des possibilités d’adaptation et d’évolution au regard des compétences des enfants, lorsque l’inclusion au sein de la classe ordinaire n’est pas possible ». À propos des décrets n° 2017-620 du 24 avril et du 5 juillet 2024, évoqués page 19, v. Virginie Fauvel, « Handicap : un décret renforce le dispositif intégré des établissements et services médicosociaux », banquedesterritoires.fr le 12 ; concernant la circulaire du 3, « Déploiement des pôles d’appui à la scolarité préfigurateurs » (à compter du 1er sept.), Jean Damien Lesay rappelle sur le même site, le 5 mars 2025, qu’elle reprend « une partie des propositions » pour un Acte II de l’école inclusive. Rapport IGAS n° 2022-114R/IGÉSR n° 22-23 107B, août 2023, 77 p. : page 50, il était indiqué que la « mise en place des [PAS] à partir des PIAL suppose une évolution législative (article L. 351-3 du code de l’éducation) » ; malgré l’échec de la tentative rappelée dans mon billet du 31 déc., 100 PAS ont été expérimentés à la rentrée 2024 selon Anne-Aël Durand, « École inclusive : un nouveau dispositif en test », Le Monde 11 juin 2025, p. 10 (extrait ; suite déplacée dans ma note AESH, créée en déc.). Dans une contribution, le Conseil national consultatif des personnes handicapées déplorait l’oubli de ce milieu dit « ordinaire : si les deux [secteurs] ne sont pas transformés en même temps, la société a peu de chance d’évoluer en profondeur et de rendre le droit commun accessible » (CNCPH, Assemblée plénière du 25 oct. 2024, pp. 2 et 4). |
| ↑22 | V. spéc. mes pp. 1046 à 1053, en synthétisant ces pages assez denses comme suit, dans mon article précité publié deux ans plus tard : « « l’obligation scolaire s’appliquant à tous » – selon une autre formule de l’arrêt [Laruelle] de 2009 – a bien été un trompe-l’œil » (2019, p. 45, avec deux exemples dans la continuité de l’arrêt n° 318501 de 2011, Beaufils : CAA Marseille, 11 avr. 2014, Mme C., n° 12MA01767, cons. 2 ; TA Rennes, 17 mars 2016, n° 1302758, mis en ligne par Jean Vinçot (ASPERANSA) le 15 déc.). |
| ↑23 | V. la fin du premier paragraphe de cette introduction de soutenance (3 p. ; ajout le 17 déc. 2025 d’un exemple postérieur à 2017 : CAA Bordeaux, 12 mai 2020, n° 18BX00272). |
| ↑24 | La combinaison des droits « à l’éducation » et « à une prise en charge pluridisciplinaire » a été opérée par TA Paris, 15 juill. 2015 ; AJDA 2015, p. 2327, concl. Pierre Le Garzic (extraits), huit jugements, cons. 2 ou 3 ; CAA Bordeaux, 16 mai 2017, M. A. et Mme C., n° 15BX00309, cons. 3 et 4 (le premier allait toutefois disparaître en cassation : CE, 8 nov. 2019, M. A. et Mme C., n° 412440, rejetant à nouveau le recours des « parents de [Camille, qui] souhaitaient qu’elle reste à l’Institut régional des jeunes sourds », l’IRJS de Poitiers) ; CAA Paris, 10 juill. 2018, n° 17PA01993, cons. 4 et 5 ; TA Lille, 27 mars 2019, n° 1700462, cons. 15, et n° 1702046, cons. 9, jugements mis en ligne par Jean Vinçot le 30 avr. (avec ses suggestions aux parents) ; CAA Versailles, 21 oct. 2021, n° 19VE02418, cons. 4 et 5 ; TA Nantes, 26 août 2022, n° 1912479 (lexbase.fr) ; obs. louislefoyerdecostil.fr le 9 sept., cons. 7 (après avoir mentionné le droit à l’éducation au 4) ; CE Ord., 27 juill. 2023, Ministre de la santé et de la prévention, n° 476203, cons. 4 et 5 (en se bornant toutefois à citer l’article cité à la note suivante). |
| ↑25 | Alinéa 3 de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, ajouté par l’article 90 de la loi de 2005 (sans insérer l’expression « droit à », qui est le fait du Conseil d’État en 2011 : v. ma page 1047 en 2017). J’ajoute ici trois références dont la dernière aurait mérité de figurer dans ma thèse : TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2013, n° 1307736 ; François Béguin, « Affaire Amélie Loquet : l’État devra bien trouver un hébergement à une jeune handicapée », lemonde.fr les 24-28 ; à partir de cette affaire, avant de juger « nécessaire de faire évoluer l’article L. 246-1 afin qu’il couvre plus largement toutes les situations de handicap d’une certaine gravité », Denis Piveteau (avec Saïd Acef, François-Xavier Debrabant, Didier Jaffre et Antoine Perrin), « Zéro sans solution ». Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches, Tome 1 du Rapport du 10 juin 2014 (96 p.), pp. 7 et 10 (proposition soulignée dans le texte) ; présentant entretemps les « deux arrêts de principe [précités] (M. et Mme Laruelle du 8 avril 2009 et Mme Beaufils du 16 mai 2011) »), ce rapport fréquemment cité rappelait que « la réponse judiciaire ne rejoint pas toujours la « vraie vie » (…). Le contentieux indemnitaire n’apporte qu’une réponse tardive [avec,] de manière courante, cinq à six ans de procès (et de frais d’avocat) » (p. 8). |
| ↑26 | Marc Belpois, « École inclusive, vingt ans de lutte », Télérama 19 févr. 2025, n° 3919, p. 35, à partir d’« une riposte indignée – et sans nuance, le propre de notre époque » à une manifestation contre « l’inclusion systématique et forcée » et pour « la défense de l’enseignement spécialisé », organisée le 25 janvier 2024 « sous les fenêtres de la ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra ». |
| ↑27 | V. aussi ce communiqué de presse du 28 et les Résultats de l’enquête réalisée par l’IFOP du 21 au 27 juin 2024, pour le Collectif « Ma place c’est en classe » (ANPEA, APF France handicap, ASEI, Droit au savoir, Gapas, FCPE, FISAF, FNASEPH, Fédération PEEP, Fédération Générale des PEP, Trisomie 21 France, UNANIMES) ; comparer celle de 2025 résumée deux notes plus loin. |
| ↑28 | Marc Belpois, art. préc., 2025, pp. 36 et 37 : « Deux décennies plus tard, « sur le plan quantitatif, la réussite est indéniable », assure un rapport de la Cour des comptes publié en septembre dernier », écrit le journaliste avant de développer cette opposition entre approches chiffrées et qualitative ; page suivante, il note que ce texte souligne que « beaucoup d’orientations préconisées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) vers des établissements médico-sociaux « n’aboutissent pas [toujours], faute de places » » (v. en effet L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, 16 sept. 2024, 159 p., spéc. pp. 18 et 22 : la « mise en œuvre [de leurs] prescriptions » est donc, « d’un point de vue quantitatif, insuffisante » ; page 18, la citation exacte est : « De telles situations conduisent les écoles et les établissements scolaires, en raison de l’obligation de scolarisation qui incombe au ministère de l’[É]ducation nationale, à accueillir des élèves présentant des troubles face auxquels les intervenants éducatifs se sentent démunis »). |
| ↑29 | Cités page 36, Marc Belpois concluant à la suivante : « De toute évidence, la politique d’inclusion menée en France depuis vingt ans nécessite davantage de moyens matériels et humains. Mais également une véritable reconnaissance des difficultés des uns et des autres (…) » (la suite de cette note, complétée au cours de l’année, a été déplacée dans mon billet daté du 30 nov., publié le 22 déc.). |
| ↑30 | J’avais soigné ce billet, rédigé alors que mes travaux faisaient l’objet d’une évaluation par le CNU ; j’espérais naïvement qu’il soit lu et puisse démontrer ma volonté de diffuser mes résultats de recherche (v. supra les notes 13 et 14 ; cette conférence n’a par ailleurs malheureusement pas été filmée). La première note précise que ce texte reprenait des éléments exposés le jeudi 28 mars 2019 lors de « regards croisés » avec Sandrine Amaré, docteure en sciences de l’éducation et alors directrice pédagogique au CCAURA (quelques mois avant cette information d’Hélène Borie et Pierre Merle, « Dissolution du Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes », cnahes.org 15-29 janv. 2020) ; v. depuis « Faire l’apprentissage de la rencontre dans le cadre d’une coopération interprofessionnelle. Vers une culture en commun », La nouvelle revue – Éducation et société inclusives 2023/1, n° 95, p. 111 ; l’année précédente, avec Louis Bourgois, « Chapitre 8. La reconnaissance des savoirs expérientiels et professionnels dans la formation des travailleurs sociaux : quels effets de la co-formation sur la fonction de formateur dans une institution de formation en travail social ? », in Patrick Lechaux (dir.), Les défis de la formation des travailleurs sociaux, Champ social, 2022, p. 229 (extrait : « depuis une dizaine d’années émerge progressivement un nouveau type d’intervenants dans ces formations : l’usager des services, ou la « personne concernée » »). Plus largement et spécifiquement, Ève Gardien, « Qu’apportent les savoirs expérientiels à la recherche en sciences humaines et sociales », Vie sociale 2017/4, n° 20, p. 31 ; Cécile Philit Arletti, À chacun son savoir ? Recherche participative sur la reconnaissance des multiples expertises au sein d’un parcours d’accompagnement, Mémoire de Master 2 Sciences de l’éducation, Parcours Référent Handicap, Lyon 2 (2022-2023), soutenu le 5 sept. 2024 (137 p.), pp. 17 et s. |
| ↑31 | OG n° 4 sur le droit à l’éducation inclusive, 25 nov. 2016, citée dans ma thèse préc., en note de bas de page 1193 ; v. plus largement p. 798, en précisant que le Rapport initial du gouvernement français sur l’application de la CDPH avait été remis le 21 mars de la même année, soit avec retard comme le remarqueront Benoît Eyraud et Arnaud Béal, « Le processus d’ancrage territorial des droits humains : l’exemple de la convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées », Annales de géographie 2021/1, n° 737, p. 86, spéc. p. 101 (étude visant surtout l’article 12) ; précitées, les Observations finales du Comité datent du 4 oct. 2021 (§§ 50-51 concernant l’article 24, en mentionnant « particulièrement les enfants autistes et ceux ayant une trisomie 21 », les « roms, demandeurs d’asile, réfugiés ou en situation irrégulière » et les « personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle ou un handicap intellectuel »). |
| ↑32 | Traité « adopté à Marrakech, le 27 juin 2013, par la Conférence diplomatique pour la conclusion d’un traité visant à faciliter l’accès des déficients visuels et des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées » (wipo.int). |
| ↑33 | Union Mondiale des Aveugles (UMA, worldblindunion.org). |
| ↑34 | CJUE G.C., 14 févr. 2017, avis 3/15, reproduisant son Préambule au § 8, en y renvoyant aussi au § 65 (le résumant, Margaux Bierme, « Compétence exclusive de l’Union européenne pour conclure le traité de Marrakech », ceje.ch le 9 mars). |
| ↑35 | Conseil de l’Union européenne, décision (UE) 2018/254 du 15 février (eur-lex.europa.eu le 6 nov., y renvoyant en précisant que la ratification « a suivi le 12 octobre » ; le 1er selon wipo.int, avec une entrée en vigueur au 1er janv. 2019 ; ce lien officiel dénombre 100 « membres » au 29 mai 2025). Ce traité international ne doit pas être confondu avec le « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » ; une réponse du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères rappelle qu’il a quant à lui « été adopté le 10 décembre 2018 à Marrakech et définitivement endossé par une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU le 19 décembre 2018 » (JO Sénat 25 avr. 2019, p. 2280). Claire Rodier remarquait alors que, « du fait de l’hystérie conspirationniste confortée par les exagérations des gouvernements souverainistes qui s’est déclenchée contre le pacte, les ONG se retrouvent à défendre un texte à l’égard duquel elles sont très critiques » (entretien avec, par Nicolas Truong, « Le « pacte de Marrakech » n’impose aucune obligation à la France », Le Monde 18 déc. 2018, p. 22) ; à propos du « dernier rapport biennal du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres » (présenté le 5 déc. 2024), v. « Pacte mondial sur les migrations : un rapport des Nations Unies souligne l’urgence d’une gouvernance fondée sur les droits », ituc-csi.org 14 janv. 2025 (renvoyant à « une déclaration commune avec d’autres syndicats mondiaux » |
| ↑36 | TA Paris, 21 mai 2024, Assoc. Accompagner, Promouvoir, Intégrer les Déficients Visuels (apiDV), n° 2209142/1-3 ; Lettre de jurisprudence du tribunal administratif de Paris sept. 2024, n° 68, p. 20 ; concl. Vincent Guiader (8 p.), spéc. p. 5, le rapporteur public notant en premier lieu que les parties lui semblent s’égarer « un temps dans un débat sur le statut de la société Index éducation, l’éditeur du logiciel Pronote » ; « ce qui importe, c’est la qualification des organismes qui [l’utilisent, soit] des milliers d’EPLE de l’enseignement secondaire » (« environ 10 000 selon l’association requérante », d’après le considérant 7 du jugement, selon lequel elle « démontre par des éléments suffisamment circonstanciés que [c]e service de communication au public en ligne (…) ne respecte pas les obligations prévues par le IV de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 ; annulation – pour « erreur manifeste d’appréciation » – de « la décision implicite de refus » de la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, remontant à 2022). En second lieu et « au vu du transfert de compétence opéré au profit de l’ARCOM depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2023-859 du 6 septembre », il proposait de l’enjoindre à « mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue » (par les articles précité et 8 du décret n° 2019-768 du 24 juill.) dans un délai de deux mois ; le tribunal optera pour trois « à compter de la notification du présent jugement », sans « assortir cette injonction d’une astreinte » (cons. 9). « Il est évidemment très probable que l’ARCOM – une entité indépendante – souligne à son tour les carences et qu’elle formule des injonctions pour les combler », commentait « Édouard Bédarrides, entrepreneur, membre d’Intérêt à Agir » (interviewé avec Pierre Marragou, président d’apiDV, par Yann Gourvennec, visionarymarketing.com 11 oct., avec le communiqué de presse publié le 2 septembre par les « deux associations à l’origine du recours », dont est membre « Hervé Rihal, professeur émérite de droit public à l’Université d’Angers ». En juin 2022, à partir de la 54ème min., il communiquait sur la question ; remerciant Erwann Robbe et Élise Rouillé pour leur aide, v. son texte « Le droit face à l’inaccessibilité des applications logicielles de vie scolaire », in Pascale Bertoni, Olivia Bui-Xuan et Raphaël Matta-Duvignau (dir.), Le droit à l’éducation, mare & martin, 2024, p. 151, spéc. pp. 152-153 : « il convient que chacun comprenne que l’inaccessibilité numérique est aussi gênante pour les déficients visuels qu’une marche pour les personnes atteintes d’un handicap moteur »). Sans apporter plus de précisions à ce propos, ce jugement est évoqué par Anne-Aël Durand, « Handicap : sur Internet, l’accessibilité numérique est médiocre », Le Monde 1er juill. 2025, p. 10, recensant de la part de l’ARCOM, en 2024, « 583 vérifications de sites, et 22 « interventions » à la suite de signalements, sans amende ». |
| ↑37 | TA Rennes Ord., 5 août 2022, n° 2203615 (dalloz.fr) : selon le compte rendu des observations à l’audience du 2, le requérant précisait notamment « les spécificités qu’il compte apporter au mode d’instruction pour tenir compte du handicap visuel de son fils D qui est évolutif. Il admet[tait cependant] qu’il est préférable, s’il y a un risque que le régime scolaire change en cours d’année après la décision au fond du tribunal, que ce soit pour revenir vers l’instruction à la maison au bout de quelques mois, plutôt que de passer de celle-ci à une scolarisation en cours d’année ». Estimant au considérant 4 qu’il n’expliquait pas « en quoi cette atteinte pourrait perturber durablement son enfant », le juge des référés rejetait son référé-suspension pour défaut d’urgence, tout en envisageant qu’il lui soit donné raison en octobre, soit « quelques semaines » après la rentrée de septembre, « la requête en annulation étant inscrite au rôle de l’audience du tribunal du 29 » (c’est ce qui s’est passé lors du jugement n° 2203596 du 10 octobre (v. dalloz.fr, cons. 8) – joint avec le n° 2203614 (visant également l’ordonnance rendue le 15 juill. 2022, n° 2203597). |
| ↑38 | V. déjà les pages du Rapport Hugues/Portier signalées dans mon billet du 29 sept. 2024 (spéc. à la note 22). |
| ↑39 | Outre l’ordonnance précitée, v. déjà celle rendue quelques semaines plus tôt par la juge des référés Mme Ach : TA Dijon Ord., 12 juill. 2022, n° 2201657 et 2201757 (doctrine.fr), rejetant également pour défaut d’urgence une demande de suspension d’un refus d’IEF pour un enfant de trois ans ; ses parents faisaient « état de son hypersensibilité, d’une suspicion de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de leur volonté de lui permettre d’évoluer à son rythme au moyen de la pédagogie Montessori » (cons. 9) ; absence d’« erreur manifeste d’appréciation » selon le jugement au fond du 13 avr. 2023, n° 2201658 et 2201758 (dalloz.fr, cons. 12). |
| ↑40 | Jean-François de Montgolfier, p. 5 (sur 7) des concl. sur CE, 6 févr. 2024, Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, n° 476988 et 487634 ; LIJMEN mai 2024, n° 230, après s’être montré sensible au « combat – administratif certes mais épuisant – que des parents doivent mener ». Annulant l’ordonnance du 8 août 2023, n° 2305118, en ce que « la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit » en retenant un « défaut d’urgence », le Conseil d’État ne donnait toutefois pas raison aux parents qui refusaient « de scolariser, dans un délai de quinze jours, leur fille A…, née en 2013, souffrant de troubles de l’attention et de l’apprentissage, et leur fils B…, né en 2016, atteint d’une surdité bilatérale sévère, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, sous peine de poursuites pénales » (cons. 9 et 7 de la seconde décision préc.) ; en effet, réglant « l’affaire au titre de la procédure de référé engagée », il balayait d’un revers de main les moyens invoqués contre les décisions du DASEN de l’Isère qui, le 1er juin 2023, les avaient mis en demeure (cons. 10, 11 et 12). |
| ↑41 | V. son témoignage recueilli par Dolores Mazzola, « Les enfants hors normes n’ont plus de place en France, ils dérangent et coûtent cher, c’est une triste réalité », france3-regions.franceinfo.fr 8 oct. 2024 (v. plus récemment Guillaume Sockeel, « Ardèche : Elle se bat pour que sa fille trouve une structure adaptée », cheriefmvalleedurhone.fr 10 avr. 2025). |
| ↑42 | V. mon billet du 17 février 2024 et « Organisation des pôles cliniques », ch-dromevivarais.fr, avec une carte situant Montéléger à équidistance de Tournon-sur-Rhône et Dieulefit : « L’École de Beauvallon accueille environ 70 enfants en structure ITEP et SESSAD » (wikipedia.org au 23 oct. 2024, rappelant qu’elle a été « fondée en 1929 » par Marguerite Soubeyran, à propos de laquelle v. ma première illustration le 30 avril 2020 ; ajout le 29 oct. 2025 d’un renvoi à la page consacrée au château du même nom, au 17 mai : il le doit à un ancien juge et député de l’Ardèche, et héberge un institut médico-éducatif à Saint-Barthélemy-Grozon – entre Alboussière et Lamastre –, géré par la Fédération des Œuvres Laïques [action-sociale.folardeche.org/ime]). |
| ↑43 | Dolores Mazzola (à partir du reportage de Ozlem Unal et Hugo Chapelon), « « On met ces enfants hors normes au placard, il n’y a pas assez de structures » : Gabrielle, malvoyante et hyperactive, privée d’établissement scolaire », france3-regions.francetvinfo.fr 26 mars 2025 : « Quid de la prise en charge de son hyperactivité dans ces structures ? (…) « Elle va régresser dans un IME (Institut médico-éducatif). Ce n’est pas sa place », assure » Sylvie, qui « aimerait que sa fille soit prise en charge par « Les Primevères ». Cet établissement lyonnais pour déficients visuels est complet. Face au manque de places, Gabrielle [était] sur liste d’attente. Sa famille attend[ait] une réponse pour cette fin du mois de mars » ; je n’ai pas trouvé d’article postérieur qui permette de savoir si cette médiatisation, qui n’est pas donnée à tout le monde, a été efficace. Avant de préciser que « Gabrielle ne souffre d’aucune déficience intellectuelle » (v. supra la note 21), il comprenait une autre citation, développée dans ma note relative aux fondations Perce-Neige et Un ptit truc en plus. |
| ↑44 | Note DAJ A1 n° 2018-007 du 5 janv. 2018 ; LIJMEN mai 2018, n° 202 (en s’appuyant sur TA Pau, 5 oct. 2017, n° 1600287 ; LIJMEN nov. 2017, n° 200). |
| ↑45 | V. mon billet (et la chronique) sous CAA Nantes, 15 mai 2018, n° 16NT02951, le 30 sept. |
| ↑46 | Raphaël Chambon, concl. sur CE Sect., 20 nov. 2020, Ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 422248 (24 p.), spéc. p. 9, avant de noter que les solutions de 2011 « ont naturellement été remarquées par les associations de défense des personnes handicapées et sont parfois présentées comme ayant fixé l’interprétation à retenir des dispositions en vigueur » ; et de citer « par exemple » en note une décision rendue l’année suivante par le Défenseur des droits (DDD ; v. ma thèse, 2017, pp. 1129 et 1204), puis de préciser entre parenthèses qu’« il ressort des conclusions de Rémi Keller qu’était en cause essentiellement l’accompagnement à la cantine pendant la pause méridienne et durant la garderie organisée avant ou après la classe mais les décisions ne le précisent nullement et leur rédaction est de portée très générale ». |
| ↑47 | Concl. préc., pp. 4 et 3 (souligné dans le texte), avec la loi de finances pour 2014 (n° 2013-1278 du 29 déc.) ; v. aussi le décret n° 2014-724 du 27 juin, mentionné en 2017 dans ma note de bas de page 1202, n° 3547, avant de citer le jugement rendu dans cette affaire par le TA Rennes le 30 juin 2016, n° 1600150). |
| ↑48 | Concl. préc., pp. 17-18 et 19 (14 ; souligné dans le texte) ; correction de la parenthèse précédente le 29 oct. 2025, en précisant que le rapporteur public citait alors le 1° du III de l’art. L. 245-1 du CASF, avant de résumer le 2° en note, elle-même rédigée à partir du 3° de l’art. L. 245-3 : les charges « [l]iées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport » et auxquelles la PCH peut se trouver affectée, n’empêchent pas de la cumuler avec le complément de l’AEEH prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. |
| ↑49 | Concl. préc., p. 16 (souligné dans le texte) ; ajout les 17 et 22 décembre 2025 d’un arrêt postérieur à la jurisprudence ici présentée, et qui lui résistait sur ce point : « Les dispositions de l’article L. 216-1 précité ne sauraient décharger l’État de ses obligations en la matière, dès lors que la restauration scolaire ne constitue pas une activité éducative, sportive ou culturelle à leur sens. Au demeurant, si l’organisation matérielle de la restauration scolaire relève de la compétence des communes, départements ou régions, elle ne se confond pas avec l’accès adapté à ce service pour les élèves en situation de handicap, lequel relève de la responsabilité de l’État » (CAA Nancy, 2 févr. 2021, n° 18NC03259, cons. 11-12, répondant « au ministre » dont l’argumentation était rappelée au 6 in fine). Listant plusieurs fautes à propos d’un enfant qui, « né le 3 avril 2011, est porteur d’une trisomie 21 », et aurait dû être accompagné « par un auxiliaire de vie scolaire individuel (AVSI) sur tout le temps scolaire pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2016 » (cons. 1 et 5), cet arrêt est par ailleurs décevant, d’une part au considérant 7 : d’abord en ce qu’il persiste à parler d’« accueil à temps complet », alors même qu’il reconnaît immédiatement que ce ne fût pas le cas ; ensuite en ce qu’il semble en revenir opportunément à une approche formelle du principe d’égalité pour relativiser « les absences pour raisons de santé de l’enseignante de l’enfant » ; enfin en n’expliquant pas la négation qu’« il aurait été imposé aux requérants, en méconnaissance de ses modalités d’accueil, de ne pas amener leur fils à son école les après-midi » (mais pourquoi donc ne l’auraient-ils pas fait, s’ils n’avaient pas été découragé de le faire ?) ; au cons. 9, d’autre part, la CAA de Nancy rejette la demande indemnitaire des parents concernant « l’absence de place disponible au sein du SESSAD Le Tremplin, vers lequel la CDPAH du Bas-Rhin les avait orientés, et dont a résulté leur attente », en considérant qu’il serait aux parents de compléter la liste des structures à contacter impérativement (il est vrai que cette liste était limitée à ce seul Service d’éducation spéciale et de soins à domicile). Intervenant lors d’un colloque à Lyon 3 cette année-là, l’un des vice-présidents du tribunal administratif de Grenoble envisageait, au regard du considérant 10 de l’arrêt de Section préc. (20 nov. 2020, n° 422248), que « l’abstention de l’État à se rapprocher de la commune pour assurer la continuité de l’aide apportée » soit considérée comme fautive (Vincent L’Hôte, « La responsabilité de l’État du fait de l’absence de scolarisation des enfants handicapés », in Jérôme Travard (dir.), La protection des droits fondamentaux par le recours en responsabilité, mare & martin, 2023, p. 139, spéc. pp. 150 et 146). |
| ↑50 | Alors que le rapporteur public laissait envisager une position médiane, consistant soit à ne pas répondre à cette question qui ne lui était pas posée, soit à « étendre la responsabilité de l’État s’agissant de l’accompagnement humain des élèves handicapés à la seule pause méridienne, dès lors qu’un service de restauration ou des activités sont organisés pendant cette pause bien entendu » (concl. préc., p. 15, avant d’envisager qu’il soit jugé « qu’il appartient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les activités périscolaires en cause, dans l’acception large du terme, sont ou non, dans les circonstances de chaque espèce, de nature à garantir l’effectivité du droit à l’éducation de l’élève handicapé. Mais cette approche casuistique aurait l’inconvénient majeur de conduire à une solution peu lisible alors que votre décision est très attendue par tous les acteurs et cela nous paraît peu opportun »). |
| ↑51 | CE Sect., 20 nov. 2020 préc., spéc. les cons. (1,) 9-10 et 11 (cités dans cette réponse ministérielle publiée au JO Sénat 19 mai 2022, p. 2709) et, pour l’arrêt de renvoi de la CAA Nantes, rendu entretemps le 15 février, n° 20NT03661, mêmes considérants (avant toutefois de juger, aux 12 à 17, que la « décision ne devait être annulée qu’en tant qu’elle laisse aux seuls parents de Sama Maxo le soin de se rapprocher de la commune de Bruz pour organiser l’accompagnement de leur enfant lors des temps d’accueil ou des activités périscolaires »). |
| ↑52 | Tania Robieu, « 20 ans de la loi Handicap : Élisabeth Borne dévoile de nouvelles mesures pour une école inclusive », vousnousils.fr 18 févr. 2025 : « 2 000 AESH supplémentaires ainsi que leur prise en charge financière sur le temps de la pause méridienne. La ministre a aussi annoncé sur son compte X l’accélération de la création des pôles d’appui à la scolarité, avec 500 nouveaux pôles en septembre 2025, afin d’atteindre 3 000 pôles en 2027 » ; Sandra Ktourza, « Comité National de Suivi de l’École Inclusive : ni AESH, ni profs », le 25, suite au CNSEI de la veille, avec le « mécontentement sur X » du collectif AESH en action. Lundi 5 mai, la rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l’éducation Julie Delpech, porteuse de la PPL visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers, saluait l’engagement pris par les ministres de l’éducation nationale et du handicap, qui coprésident ce « lieu d’impulsion de la politique d’inclusion scolaire[,] de réunir ce comité tous les six mois » (assemblee-nationale.fr : le CNSEI « a pâti, depuis sa création en 2019, du manque de régularité de ses réunions ») ; les AESH étaient abordés lors de la discussion générale ouverte par Anaïs Belouassa-Cherifi (v. déjà l’intervention de François Ruffin le 11 mars et ma note AESH, créée en déc.). |
| ↑53 | Décret n° 2025-137 du 14 févr. relatif à l’intervention des accompagnants des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, JORF du 16 ; LIJMEN mai 2025, n° 235, précisant qu’il complète l’article 1er du décret du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des AESH, après que la loi du 27 mai « visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne a transféré à l’État la rémunération des [AESH] assurant cet accompagnement pendant la pause méridienne, auparavant prise en charge par les collectivités territoriales ». |
| ↑54 | PPL visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers, modifié par le Sénat le 19 juin 2025, art. 1er ter (je souligne). |
| ↑55 | Concl. préc., pp. 26 et 13, avant une longue note commençant comme suit : « La lecture des textes faite par la cour peut par ailleurs sembler trouver quelque appui dans la décision n° 2003-471 DC du 24 avril » (v. toutefois mes pp. 1097-1098 et 1103-1104). |
| ↑56 | Comparer Béatrice Boissard, « Conventions internationales et le droit de l’éducation », in Pascale Bertoni et Raphaël Matta-Duvignau (dir.), Dictionnaire critique préc., 2021, p. 186, spéc. p. 188 : « Le PIDESC et la CIDE font passer le droit à l’école de droit « mou » à celui de droit positif, contraignant, comportant des obligations pour l’État » (v. cependant sa note de bas de page 190, citant à propos de cette dernière Convention quelques-unes des références répertoriées dans ma thèse en notes de bas de page 1157, n° 3264 et 3265 ; relatives à l’absence d’effet direct de ses dispositions, selon le juge administratif, elles figurent à la suite de développements rappelant la faiblesse des critiques tournées contre l’affirmation des droits dits « sociaux », pp. 1146 et s.). |
| ↑57 | Concl. préc., pp. 23-24, en citant CE, 4 juill. 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, n° 341533 (v. en 2017 ma [note de bas de] page 1184 [n° 3442]) et CEDH, 23 févr. 2016, Çam c. Turquie, n° 51500/08 (v. mes pp. 872, 982 et 1161). |
| ↑58 | Le 31 décembre 2023, j’avais opéré un rapide renvoi vers mon billet signalant cette annulation de CAA Lyon, 8 nov. 2018, n° 16LY04217, par CE, 19 juill. 2022, n° 428311 ; j’ajoute ici les conclusions de Raphaël Chambon (11 p.) et les observations de Raphaël Matta-Duvignau (entretien avec, par Yann Le Foll, lexbase.fr oct. pour La lettre juridique n° 921 du 20). |
| ↑59 | Concl. préc., p. 4, avec cette précision à cet égard : « Depuis janvier 2016, les établissements et services pour personnes en situation de handicap doivent conclure avec l’ARS un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens [CPOM. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)] leur alloue chaque année les crédits nécessaires à leur fonctionnement, par l’intermédiaire des ARS » ; « écarter par principe [cette] responsabilité de l’État » au motif que l’ARS n’a « pas le pouvoir d’imposer à un établissement médico-social la prise en charge d’une personne (…), ce serait potentiellement réduire à peu de chose, s’agissant de la scolarisation hors du milieu ordinaire, la portée de [cette] jurisprudence pourtant si exigeante en apparence » (à propos de l’arrêt Laruelle, v. supra les notes 13 et 19). |
| ↑60 | Concl. préc., pp. 4-5 : « faute présumée de l’État, charge à ce dernier, le cas échéant, d’engager une action récursoire contre les personnes ayant concouru au préjudice, par exemple l’établissement médico-social désigné par la commission ayant de manière fautive refusé d’accueillir l’enfant handicapé. On peut rapprocher une telle solution de celle adoptée en matière de DALO ». À partir des travaux qui « portent surtout sur des droits de solidarités (ou droits-créances) [v. supra la note 13] tels que le droit au logement [opposable] et le droit à l’éducation », Xavier Dupré de Boulois pousse la comparaison en percevant « une forme de hiérarchisation des victimes », au profit des personnes en situation de handicap (rapport de synthèse préc., juin 2021 ; mare & martin, 2023 ; RDLF 2024 chron., n° 82) ; auparavant, il cite toutefois à la note 52 un arrêt rendu moins d’un mois avant celui ici commenté, qui illustre que l’analyse selon laquelle la jurisprudence repose sur « une obligation de résultat plutôt qu’une simple obligation de moyen (…) n’est pas dénuée d’ambiguïté » : à propos d’un enfant souffrant de TDA/H (v. supra les notes 15 et 39), « né le 16 janvier 2003, dont les parents sont séparés depuis 2004 », le recours de son père est rejeté après analyse d’une situation due « en particulier à l’attitude de [s]a mère » ; parce que son absence de scolarisation « au titre de l’année 2015/2016 (…) n’est pas la conséquence d’un refus des services de l’éducation nationale de l’accueillir en milieu ordinaire ou de l’absence de place dans un établissement spécialisé », la responsabilité de l’État ne saurait être engagée pour faute. Au lieu de s’en tenir à l’affirmation que ce régime est exclusif « de la responsabilité sans faute », la CAA de Nancy croit bon d’écrire dans ce contexte que « l’État est tenu à une obligation de résultat concernant la mise en œuvre du droit à l’éducation » (23 juin 2020, n° 18NC02607, cons. 1 et 13 à 16)… |
| ↑61 | Concl. préc., p. 10 ; dans le même sens, Vincent L’Hôte doutait qu’il soit « acceptable que des parents soient obligés de prendre contact avec parfois plus d’une dizaine d’établissements » (communication de 2021 préc., publiée sous la direction de Jérôme Travard en 2023, p. 150 ; texte parcouru le 13 nov. 2025, cité le 22 déc.). Dans un article publié quelques mois après le 11 février, Mathilde Goanec rappelle qu’« il arrive encore fréquemment que les parents n’entament pas les démarches, car dépassés ou en difficulté pour accepter la situation de leur enfant » (« Handicap à l’école : « Nous sommes tous désarmés » », Mediapart 17 juin). |
| ↑62 | Concl. préc., p. 6, appliquant à l’espèce ce qui allait devenir un considérant de principe, avec cette formule reprise mot pour mot au cons. 5 : « la responsabilité de l’État doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité » ; au considérant suivant, le Conseil d’État ne reprenait toutefois pas l’« erreur de droit » mais optait pour une erreur de qualification juridique des faits (QJF) : « En en déduisant que les dommages invoqués trouvaient leur cause exclusive dans le comportement des parents de cet enfant, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce qui lui étaient soumis » (cons. 6). |
| ↑63 | CE, 19 juill. 2022, n° 428311, cons. 11, avant de statuer, « par l’effet dévolutif de l’appel », « sur l’étendue de la réparation » (cons. 12 à 15 : « l’absence de scolarisation de l’enfant E… C… pendant la période mentionnée courant du 9 septembre 2011 au 8 janvier 2013 a causé à cet enfant un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence » ; concernant aussi ses parents et sœurs, le Conseil d’État parvient à une « somme globale de 27 000 euros » ; au cons. 14, conformément aux conclusions page 11, il estime cependant qu’« il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice patrimonial allégué s’agissant de E… C…, tiré de ce qu’il a été privé de la possibilité d’élever son niveau de formation pendant la période en cause, soit établi »). |
| ↑64 | La Déferlante févr. 2023, n° 9, p. 88, spéc. pp. 90-91 : « Quand j’étais enfant, mon neuropédiatre disait à mes parents que je ne pourrais jamais apprendre la syntaxe ni le calcul. Si mes parents avaient écouté cette parole d’autorité – car parole médicale –, ils auraient délaissé les activités d’éveil, ne m’auraient pas scolarisée, et je n’aurais effectivement pas appris à écrire et à compter, confirmant ainsi l’imaginaire du médecin ». Plus loin, elle évoque l’une de ses « performances [dans le domaine des Arts] ». |
| ↑65 | Le 22 janvier 2015, son premier billet s’intitulait « La prise en charge du handicap par l’Éducation nationale » ; v. aussi « De la masturbation et autres considérations sexuelles », 24 févr. 2015 : « Le débat sur l’assistance sexuelle est important, voire nécessaire, car il rend pensable ce qui est demeuré impensé », mais il a « tendance à parler de la question sexuelle en des termes de besoin, évacuant ainsi la question du désir » au risque «, à terme, de médicaliser la sexualité. (…) La légende du prince charmant peut s’appliquer au vécu handicapé (…) : l’image de passivité est commune [et l]’activité du valide ou de l’homme va permettre l’exploration d’un corps passif qui se méconnaît » ; « que faire de l’appropriation de soi et du corps dans tout cela ? » (plus récemment, « Coup de gueule à propos de l’inclusion », 11 juin 2022 ; « Quand je serai grande, tout ira mieux », 2 juill. 2025) ; en lien avec le deuxième texte, Pascale Ribes, « Assistance sexuelle : qu’attendons-nous pour essayer ? », liberation.fr 5 sept. 2025 – à propos d(e la présidente d)’APF France handicap, v. mon billet daté du 30 nov., publié le 22 déc. |

