
« Commémorer les événements[1] ayant secoué la France gaulliste il y aura bientôt cinquante ans ? L’hypothèse [avait pu circuler, fin 2017,] dans l’entourage du Président »[2]. Un an plus tard, la France macroniste se trouvait confrontée aux manifestations des « gilets jaunes » ; selon les chercheurs Sebastian Roché et Fabien Jobard, le « nombre d’interpellations » et celui des blessés sont « sans précédent depuis Mai 68 »[3].
D’autres liens peuvent être établis[4]. Les 30 et 31 octobre, et pour s’en tenir à cette manifestation… scientifique, un colloque portait sur le moment 68 à Lyon en milieu scolaire, universitaire et éducatif ; l’une des contributions présentées dans le Grand amphithéâtre de l’Université Lumière Lyon 2 concernait sur ce « moment 68 »[5] à la faculté de médecine[6].
Le 10 décembre, un commentaire du décret n° 2018-838 a été publié : l’ancien recteur d’académie Bernard Toulemonde y rappelle qu’une « rupture intervient en 1968 ; le recteur perd la présidence du conseil de l’université [et] devient chancelier des universités, une fonction de contrôle administratif et juridique »[7].
Lors du colloque précité, et dans le prolongement d’un autre (en 2011[8]), Jérôme Aust est revenu sur l’« application de la loi Faure[9] à Lyon ». Il y a maintenant plus de cinquante ans, le droit « à l’instruction » était (seulement) revendiqué, comme en témoigne la photographie insérée au seuil de ce billet ; cette banderole, je l’avais déjà signalée en actualisant celui du 10 avril, jour du 170ème anniversaire de la naissance d’Hubertine Auclert.
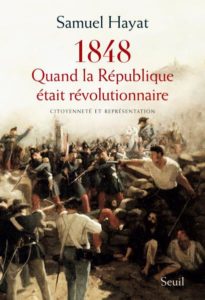
En cette année 1848, une conception révolutionnaire de la République la veut « démocratique et sociale avec le droit au travail »[10] ; après avoir cité l’essai sur l’illusion de Clément Rosset (1939-2018), Samuel Hayat rappelle qu’« une Assemblée a bien été élue au suffrage universel le 23 avril 1848, elle a proclamé la République le 4 mai, et pourtant elle s’est trouvée, deux mois plus tard, à devoir faire face à une insurrection faite au nom de la République, c’est-à-dire au nom du régime lui-même, ou plutôt de son double. Là est toute la puissance de l’idée de République, en 1848 »[11].
Michèle Riot-Sarcey note qu’alors, « la Révolution de 1789 est à la fois proche et lointaine (…). On se souvient non pas des tensions qu’a engendrées l’évènement et dont l’essentiel est réinterprété en fonction des besoins, des nécessités ou des opinions, mais du rôle qu’ont joué les « gens du peuple » – les anonymes, comme l’écrit Lazare Carnot »[12]. Ce dernier avait participé à l’affirmation du « droit à l’instruction » en 1793, lequel se retrouve proclamé par le premier projet de Constitution en 1848 (19 juin) ; comme je le montre dans ma thèse, ce droit ne figure en revanche pas dans le Préambule de la Constitution du 4 novembre 1848 (pas plus que dans celle des 3 et 4 septembre 1791 et dans la DDHC adoptée deux ans plus tôt)[13].
Quand la République était révolutionnaire, il s’agissait « de donner une visibilité aux clivages sociaux », en les réduisant cependant à « la question de classe »[14]. C’est notamment pourquoi, quand bien même cette occasion de consécration constitutionnelle du « droit à l’instruction » n’aurait-elle pas été manquée, rien n’assurait qu’il soit reconnu de la même manière aux garçons et aux filles[15].

« 1948. L’universalisation des droits de l’homme », tel est le titre de l’une des entrées de l’Histoire mondiale de la France, ainsi que je le rappelle dans mon portrait de René Cassin, actualisé ce jour. Dzovinar Kévonian était – avec Danièle Lochak et Emmanuel Naquet – l’invitée d’Emmanuel Laurentin et Séverine Liatard lors d’une des quatre émissions consacrées par La Fabrique de l’histoire à ce 70e anniversaire de la DUDH. Cette série se clôt en retraçant « l’ascension politique » d’Eleanor Roosevelt : à propos de cette dernière, de la ségrégation raciale – évoquée à la fin – et du droit « à l’éducation » (préinscrit à l’article 26), v. mon billet du 27 mars, in memoriam Linda Brown (et mes développements pp. 725 et s.).
Ainsi qu’a pu le faire observer Mireille Delmas-Marty « en elle-même, la déclaration n’est pas contraignante pour les États qui l’ont signée » mais, compte tenu du « nombre de dispositifs que cette déclaration a engendré, y compris toute une série de textes qui, eux, sont contraignants », le « bilan, 70 ans plus tard, (…) est impressionnant »[16].
Il s’agissait, en « ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, [de s’efforcer], par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés » ; à ce préambule fait écho celui de la Convention européenne du 4 novembre 1950, qui fait immédiatement référence à la DUDH[17]. Après une tentative de consécration sélective de son article 26, le droit « à l’instruction » s’est trouvé affirmé dans le premier protocole additionnel[18] ; à partir de ce texte de 1952, la Cour européenne l’a qualifié de « fondamental » en 1976[19].
En France, la mixité (« sexuelle ») est généralisée dans les établissements publics par trois décrets du 28 décembre de cette année-là[20]. Encourageant « une histoire « par le bas » de la mixité », Odile Roynette rappelle que pour « accéder, au cours des années 1920, aux bastions masculins de l’université, l’une en médecine et l’autre en philosophie », il a fallu à « Françoise Dolto comme Simone de Beauvoir (nées toutes deux en 1908) (…) batailler contre leur milieu d’origine, bourgeois, catholique et conservateur dans les deux cas, et notamment contre leur mère qui envisageait avec horreur la perspective d’un contact répété de leur fille avec des hommes avant le mariage »[21].
« Des principes et des hommes », titrait le supplément Idées du journal Le Monde, en page 2, le 8 décembre 2018 en publiant un entretien de Valentine Zuber avec Anne Chemin ; le même jour, le quotidien rapportait l’appel de Michelle Bachelet, la haut-commissaire de l’ONU, à « résister au recul des droits humains »[22]. Au nom d’Amnesty International, dont il est secrétaire général depuis le mois d’août, Kumi Naidoo invite à « nous attacher à [leur concrétisation] pour le plus grand nombre »[23], autrement dit pour tout·e·s.
[1] v. M. Riot-Sarcey (entretien avec, par Julie Clarini), « À quoi sert le passé ? », Le Monde Idées 30 juin 2018, p. 5, à propos « de ce qui fut appelé, par incapacité de penser la spécificité des formes de révoltes plurielles, « les événements de 1968 » ».
[2] C. Belaich, « Mai 68 : Macron ne s’interdit rien », Libération.fr 5 nov. 2017
[3] V. respectivement S. Roché, « Le dispositif policier hors norme signale la faiblesse de l’Etat », Le Monde 11 déc. 2018, p. 22 et F. Jobard (entretien avec, par M.-O. Bherer), « Face aux “gilets jaunes”, l’action répressive est considérable », Ibid. 21 déc. 2018, p. 20, en ligne, « le bilan » de ce dernier visant les « dommages » liés aux « interventions policières » ; selon Laurent Mucchielli, ce sont « probablement environ 5 000 personnes qui ont été interpellées » entre le 17 novembre et le 15 décembre (Theconversation.com 17-18 déc. 2018).
[4] V. ainsi, au détour de mon billet sur le numerus clausus.
[5] Une « expression initiée par Michelle Zancarini-Fournel », comme le rappelait l’appel à communication ; Le Moment 68, une histoire contestée, tel est le titre de son livre publié au Seuil lors du quarantième anniversaire (v. aussi J. Clarini, « Etudiants et ouvriers ont-ils fait la jonction ? », Le Monde Idées 17 mars 2018, p. 5). L’historienne a conclu le colloque, le 31 octobre.
[6] Plusieurs années avant le colloque, Bastien Doudaine avait rédigé un commentaire d’un « tract, édité et distribué par des étudiants en médecine de Lyon », publié sur le site de L’Atelier numérique de l’histoire.
[7] B. Toulemonde, « Du recteur d’hier au recteur de demain ? », AJDA 2018, p. 2393, spéc. p. 2399 (en renvoyant à la contribution de Didier Truchet au dossier publié par la même revue le 4 juin, intitulé « Mai 68 et le droit administratif », pp. 1074 et s. V. aussi, à Nanterre, le 22, « 1968 et les facultés de droit » ; ) avant de terminer sur une autre réforme – de vingt-six à treize académies ? (v. mon billet du 3 août 2018) –, laquelle n’est pas sans susciter des inquiétudes comme en témoigne cette question écrite de M. Bonhomme (JO Sénat du 13 déc. ; v. le 3 janv., à partir de la réponse ministérielle).
[8] v. B. Poucet et D. Valence (dir.), La loi Faure. Réformer l’université après 1968, PUR, 2016, pp. et 19 et 167
[9] Ma thèse cherchant à se focaliser sur le « droit à » des élèves et étudiant.e.s, cette loi contient peu de mentions : v. pp. 116, 121, 1013 – en note de bas de page n° 2370 – et 1018-1019 ; v. l’étude d’Emmanuel-Pie Guiselin (« L’Université faurienne, cinquante ans après la loi d’orientation », RFDA 2018, p. 715) et l’approche synthétique de Laure Endrizzi, « 1968-2018 : 50 ans de réforme à l’université », Édubref 22 oct. 2018
[10] S. Hayat (entretien avec, par M. Semo), « En février 1848, le peuple célébrait la République, en juin, c’était la guerre civile », Libération.fr 16 janv. 2015, rappelant qu’il s’agit de « la révolution oubliée », en référence implicite à l’ouvrage de Maurizio Gribaudi et Michèle Riot-Sarcey (La Découverte, 2008, rééd. 2009). Dans le pdf de la thèse de Samuel Hayat, « Au nom du peuple français ». La représentation politique en question autour de la révolution de 1848 en France (soutenue à Paris VIII en 2011, 702 p.), à l’entrée « droit à », celui « au travail » apparaît à de nombreuses reprises ; en lien avec « l’éducation » ou « l’instruction », v. pp. 183, 290 et 610-611 (comme « droits sociaux »). V. ses développements intitulés « Républicaniser le pays », pp. 278 à 283, en citant les noms de George Sand et d’« Hippolyte Carnot, ministre provisoire de l’Instruction publique et des Cultes » (pp. 129-130 de sa version publiée, 1848. Quand la République était révolutionnaire. Citoyenneté et représentation, Seuil, 2014 ; à propos de la première, v. mon portrait de Flora Tristan ; concernant le second, v. ma note de bas de page 279, n° 1712 – s’agissant de la « liberté de l’enseignement » – et, surtout, mes pp. 661 à 666, spéc. 664-665 où je tisse un lien entre sa pensée et le droit positif contemporain plutôt qu’avec celui des années 1880).
[11] S. Hayat, ouvr. préc., 2014, p. 24 ; italiques de l’auteur, qui fait observer page 13 que « les termes « Seconde République » ou « Deuxième République » sont étrangers au vocabulaire de 1848, ce genre de dénomination ne se répandant que plus tard, durant le Second Empire et surtout sous la Troisième République ».
[12] M. Riot-Sarcey, Le procès de la liberté. Une histoire souterraine du XIXe siècle en France, La Découverte, 2016, p. 102 ; à propos de Lazare Carnot, v. ma note de bas de page 635, n° 32 (page 650 pour le renvoi).
[13] V. respectivement pp. 648 et s. ; 631 et s. V. aussi à l’occasion de deux de mes conclusions, pp. 1183 et 1214
[14] S. Hayat, « Les Gilets jaunes et la question démocratique », 24 déc. 2018
[15] La fin de cette formule est reprise de mon résumé à la RDLF 2018, thèse n° 10
[16] M. Delmas-Marty (entretien avec, par R. Bourgois), « 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce qui manque c’est le mode d’emploi », AOC 8 déc. 2018, quelques lignes avant de remarquer qu’elle « a fonctionné en faveur des peuples colonisés » ; plus loin encore figure la phrase retenue pour titrer, la suite étant : « comment faire pour concilier l’universel et le pluriel ? ».
[17] V. ma page 955, ouvrant des développements sur l’enrichissement interprétatif réalisé par la Cour européenne (de la Convention par des sources onusiennes).
[18] V. mes pp. 801 et s.
[19] CEDH, 7 déc. 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, n° 5095/71, 5920/72 et 5926/72, § 50 ; v. ma page 827, avec la note n° 1224 ; contrairement à ce qu’affirment Jean-Pierre Camby, Tanneguy Larzul et Jean-Éric Schoettl dans le dernier AJDA de l’année, la « jurisprudence » de la Cour ne reconnaît pas « un droit fondamental des parents » (2018, n° 44, p. 2486, spéc. p. 2491, en citant ce § 50) ; affaiblissant leur plaidoyer (« Instruction obligatoire : pour un principe fondamental reconnu par les lois de la République »), les auteurs reprennent la position des défenseurs de l’instruction à domicile (v. ainsi mes pp. 828 et 853, avec les références citées). Sans pouvoir en faire la démonstration ici, j’estime pour ma part que le « droit à l’éducation » est tout à fait apte à constituer un motif de restriction suffisant des autres droits (et libertés), en ce compris parentaux.
Ajouts au 20 octobre 2020 : près de deux ans après la publication de ce billet, et une vingtaine de jours après l’annonce du principe de la scolarisation obligatoire en droit français, j’ajoute ici plusieurs références :
- Bernard Toulemonde, cité par Marie Piquemal, « Fin de l’éducation à domicile : peu d’élèves concernés, mais un vrai débat », liberation.fr le 2 (quant à Jean-Paul Delahaye, ses références à « l’intérêt supérieur de l’enfant » et au « droit des enfants à l’instruction » apparaissent toutes les deux anachroniques ; le fondement de la loi Ferry était la liberté de conscience, raison pour laquelle elle fait l’objet de développements spécifiques dans la première partie de ma thèse, comme je l’explique page 59 de ma thèse (2017). V. le texte d’André D. Robert et Jean-Yves Seguy (2015), cité dans mon billet du 29 novembre, spéc. les §§ 22 et 62, en conclusion – avec toutefois une référence ambiguë au terme « droit », au paragraphe suivant ; v. évent. mes pp. 639-640) ;
- celles de mon billet du 26 mars, en précisant qu’il aurait pu/dû comprendre un renvoi à des citations de François Luchaire, via mes notes de bas de page 1031 et 1100, n° 2481 et 2896 ;
- enfin et surtout à l’arrêt Wunderlich c. Allemagne, n° 18925/15 (rendu par la CEDH le 10 janv. 2019, définitif au 24 juin ; v. en français le Communiqué de presse du Greffier, ne liant pas la Cour, 3 p.). Dans le pdf de ma thèse (2017), entrer le nom de l’affaire conduit à quelques résultats, not. des citations des Observations écrites soumises à la Cour par le directeur de l’ONG European Centre for Law and Justice, Grégor Puppinck (elles sont évoquées dans l’arrêt, aux §§ 5 et 41 in fine).

- Je pensais avoir déjà signalé cet arrêt ; le faire si tardivement permet de citer largement un article à propos de « l’ECLJ, qui bénéficie également d’un statut d’ONG accréditée aux Nations unies (ONU) », et « n’est qu’une filiale européenne d’un groupe américain dont elle reprend le nom : l’American Center for Law and Justice (ACLJ) ». Il s’agit d’« une structure créée en 1990 par l’un des chefs de file du conservatisme chrétien américain, Pat Robertson », depuis lors « aux mains d’une autre famille tout aussi influente : les Sekulow », qui avaient « déjà fondé en 1988 une autre ONG, Christian Advocates Serving Evangelism (CASE) » ; « Outre la succursale européenne, il existe une branche « slave » (Slavic Center for Law and Justice), destinée à agir en Europe de l’Est, qui noue des liens étroits avec les conservateurs hongrois et soutient le président russe Vladimir Poutine dans sa lutte contre la « propagande homosexuelle ». L’ACLJ est également présente et active en Afrique. Sa filiale locale, l’African Center for Law and Justice, est ainsi intervenue très activement au Zimbabwe au début des années 2000 pour que l’homosexualité y demeure un crime » (Samuel Laurent, « Des proches de Donald Trump au secours de La Manif pour tous », Le Monde 4 mars 2020, p. 15 ; dans le même quotidien, v. aussi le 24 févr., pp. 14-15 : dans leur papier titré « Europe de l’Est. La guerre du genre est déclarée », Jean-Baptiste Chastand, Anne-Françoise Hivert et Jakub Iwaniuk s’arrêtaient notamment sur « l’institut Ordo Iuris, spécialisé dans la promotion des « valeurs catholiques » par le droit, qui est à la manœuvre [en Pologne, en particulier contre l’avortement] » ; « Cette organisation, membre du réseau européen de catholiques radicaux Agenda Europe », est également mentionnée dans l’affaire préc., l’arrêt citant cette tierce-intervention).
- Peu de temps après l’arrêt de la Cour, le Tribunal fédéral suisse s’est positionné concernant Bâle-Ville (22 août 2019, 2C_1005/2018) : selon un décryptage paru dans la presse, cette « décision précise que le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale (article 13 de la Constitution fédérale) ne confère pas (…) un droit à suivre des cours privés à domicile. Certes, cette disposition, qui trouve son pendant dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, article 8), englobe aussi le droit des parents [d’]éduquer leurs enfants. Mais la Cour européenne des droits de l’homme également estime dans sa jurisprudence qu’aucun droit à l’enseignement privé à domicile ne peut être déduit de l’article 8 de la CEDH [j’ajoute qu’il ne peut l’être non plus du « droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques », prévu par la seconde phrase du premier protocole additionnel – ratifié par la France, mais non la Suisse]. Constatant qu’aucun traité international n’accorde un tel droit, le Tribunal fédéral ajoute qu’il n’y a pas lieu d’accorder des droits plus étendus en vertu de la Constitution fédérale. Il en découle que même des réglementations cantonales très restrictives en matière de « homeschooling » ne violent pas le droit au respect de la vie privée et familiale » (« L’école à domicile n’est pas un droit constitutionnel », lematin.ch 16 sept. 2019).
[20] Et non « à partir » de (juillet) 1975 avec la loi dite Haby, comme l’affirme à trois reprises Odile Roynette dans un article récent – par ailleurs stimulant, lui aussi –, « La mixité : une révolution en danger ? », L’Histoire janv. 2019, n° 455, p. 13 ; v. mon billet du 24 avr. sur (le droit à) « l’éducation à la sexualité » et, plus spécialement à propos la contribution juridique que je signale dans mon résumé de thèse préc. – dans le prolongement des travaux centrés sur l’histoire de la mixité (« sexuelle ») –, mes pp. 74-75, 92 à 98 (697 à 703 et 706-707 à propos de Paul Robin), 792-793 et, surtout, 987 à 1001, où je cite la loi du 10 juillet 1989, dite Jospin : elle est à l’origine de l’article L. 121-1, qui prévoyait initialement – lors de la codification, en 2000 – que les « écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur (…) contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes ». Cette « obligation légale », qui aura bientôt trente ans, est rappelée par la vice-présidente de Mnémosyne, réagissant aux programmes d’Histoire envisagés pour la rentrée 2019 : elle « n’a pas été consultée par le Conseil supérieur des programmes [CSP], ni aucune autre association travaillant sur l’égalité hommes-femmes » (Cécile Beghin (entretien avec, par Jean-Baptiste de Montvalon), « Les femmes ne font-elles jamais l’histoire ? », Le Monde Idées 15 déc. 2018, p. 5 ; à partir de Marie Skłodowska-Curie, v. mon billet du 4 février).
[21] O. Roynette, art. préc. (je souligne).
[22] Citée par Marie Bourreau (à New York) et Rémy Ourdan, « Triste anniversaire pour les droits humains », Le Monde 8 déc. 2018, p. 2
[23] K. Naidoo, « Pas de liberté politique sans égalité sociale », Le Monde diplomatique déc. 2018, pp. 1 et 10-11 (avec aussi un texte de Claire Brisset, « Un long cheminement vers la dignité »).

